D’autres capitalismes
Beaucoup de diagnostics, de critiques sont formulées à l’occasion de la crise économique que nous connaissons concernant le fonctionnement du capitalisme à l’orée du XXIème, sous le seul dogmatisme survivant au communisme, l’unique libéralisme. Nimbé, nous devons le reconnaitre, d’un keynésianisme essentiellement au profit du financier.
Souvent, les propositions ne vont pas bien loin ou plus souvent ne sont qu’un « patch » sur un système dont les soubassements prennent leurs sources dans des formalisations de siècles passés. Cet article se propose donc de synthétiser des propositions glanées de çi de là (Alter eco, AJ Holbecq, auteur), pour essayer d’en faire, avouons-le, un peu de publicité.
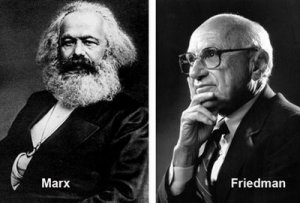
L’une des caractéristiques de l’organisation productive depuis quelques siècles est la bipolarisation capital-travail. La relation qui les lie de façon quasi-systématique est l’aliénation du fruit du travail contre salaire.
En retournant dans le monde tel que le voyaient les physiocrates, où l’agriculture est le secteur largement dominant, cela permettait au détenteur du capital, à savoir le paysan propriétaire, de s’approprier un fruit du travail de la nature en sus du journalier (moyennant incertitudes liés aux aléas des marchés, climatiques et sanitaires).
Pour condenser le propos, si le travailleur s’aliénait au XIXème le fruit de son travail contre salaire, au XXIème, il s’aliène également de plus en plus son travail, à terme, contre salaire, du moins dans toute tâche d’automatisation, voire pérenne.
Notez que si ce n’est dans les textes de loi, c’est au moins une justification forte d’un système d’assurance-chômage.
On peut en corollaire constater que tout travail n’est pas égal face au renouvellement des taches qu’il y a à accomplir. Si une telle rente du travail était reconnue, cela désinciterait sans doute, dans un objectif d’économie durable (et surtout du point de vue de l’auteur en respectant la loi du moindre emmerdement matériel), à la limitation abusive de durée de vie des produits, la rente (en fonction donc de la durée de vie du produit) se substituant à la vente.
Proposition de Dominique Perrin : l’égalité capital-travail au sein d’un statut d’entreprise
La proposition de Dominique Perrin (alter Eco Juillet-Août 2009 p112) est donc d’abolir le salariat. Il propose de : "...modifier le statut de l’entreprise : l’entreprise serait possédée par l’apporteur de capital (montant du capital apporté) ET par l’apporteur de travail (valeur du travail apporté = valeur de la rémunération du travail). A mesure de leur travail, les travailleurs deviendraient de plus en plus propriétaires de l’entreprise. Si les apporteurs de capitaux n’augmentent pas leur capital et/ou ne travaillent pas, leur part diminuerait à mesure que "s’use le capital...".
Proposition sociétale/distributiviste : la création-destruction monétaire autour du travail et son pendant la consommation
Si vous êtes arrivés jusque-là, bravo, le plus intéressant arrive.
Plus près de la crise actuelle et donc de la déconnexion finance-économie réelle à laquelle nous assistons, ébahis et surtout impuissants, souhaitant avec des mots à peine voilés la chute et la fin du système actuel, il existe un autre privilège du capital vis à vis du travail.
A peu près tout le monde sur Agoravox reconnait aujourd’hui que la création monétaire a lieu lors de l’investissement, lors de l’appropriation ou la formation de capital donc. Il existe bel et bien des prêts à la consommation, mais c’est, ouf, marginal. Dès lors, le privilège du capital est d’être la source de la monnaie. Ne dit-on pas que l’on ne prête qu’aux riches ?
La monnaie est une représentation subjective et approximative de la richesse créée. Tout un chacun, même notre repère libéral, reconnait que "seul le travail crée de la valeur", peu ou prou de la richesse. Dès lors, afin de respecter au plus près les efforts de tout un chacun à l’activité de création de richesses, la seule perspective honnête est de reconnaitre l’adéquation de la création monétaire autour du travail et sa destruction autour de la consommation. La création monétaire lors d’un investissement et la destruction monétaire lors du remboursement ne stipule pas que l’investissement prenne de la valeur en dormant, en exploitant autrui, ou en perde via amortissements quinquenaux. Mais très certainement, elle l’induit.
Dès lors, le détenteur de capital serait le même que le fournisseur de travail. Chaque travailleur ne défendrait plus son salaire mensuel, mais son capital mensuel, laissant bel et bien le broker de Wall Street ou de la City les bras ballants (du moins, n’ayons crainte, pour un temps).
Quelques éclaircissements pratiques :
- la création monétaire se doit d’induire une même destruction monétaire, à savoir que toute la production se doit d’être consommée. La sur-accumulation de stock dans un fonctionnement de marché doit réduire la rémunération de création monétaire lors du travail : et oui, le petit malin qui produit, se fait créer de la monnaie et ne vend rien doit bien se faire taper sur les doigts un jour ou l’autre. Le producteur (personnalité physique ou morale) peut dès lors s’allouer le revenu qu’il désire, tout en sachant qu’il est responsable de cette décision qui sera modulé en fonction de la vente du fruit de son travail.
S’il accumule du stock abusivement, sa création monétaire devra être limitée. D’ailleurs, celle-ci peut se faire uniquement si le stock est réellement vendu si l’on veut être sûr ;
- l’investissement, ou activité de production non consommable, pourrait se faire sur l’épargne des producteurs de biens consommables, ou tout simplement comme aujourd’hui, en allant voir le banquier.
- cette double source de création/destruction monétaire, autour des travail/consommation et de l’investissement, permet de limiter la propagation de crises à tout les secteurs de l’économie. C’est une forme de cloisonnement, par rapport au système actuel où la quantité de monnaie en circulation dépend essentiellement de la bonne santé de l’immobilier.
- un économiste français (source que l’on peut facilement retrouver) a démontré que les hauts revenus en 2006 (et donc les inégalités) étaient essentiellement concentrés autour de la création monétaire, les salaires de la finance étant autrement plus rémunérateurs que ceux victimes de la perpétuelle vindicte communiste, les patrons. En multipliant les sources (droit légitime des individus à être rémunérés pour leur travail) et les motifs (travail, investissement) de création/destruction monétaire , c’est une source d’inégalité et de propagation de crises qui s’effondre sur elle-même.
C’est l’une des propositions (très librement interprétée par l’auteur) retrouvés chez Marie-Jeanne Duboin ("mais d’où vient la monnaie ?") ou André-Jacques Holbecq (www.societal.org) dont je ne connais pas l’origine, mais qui mérite certainement autrement plus d’attention que les quelques lignes ci-dessus, tellement elle semble brillante, prometteuse, et plus certainement aux antipodes d’intérêts biens compris et de l’ordre bien établi.
En guise de conclusion
73 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









