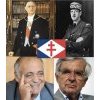C’est une des dernières lignes de défense des partisans de la monnaie unique européenne, peut être pas la dernière mais sans doute une des dernières : l’euro nous protègerait des dévaluations au sein de l’Europe. Une nouvelle ligne Maginot à enfoncer.
Fantasmes contre réalité
A écouter les défenseurs de l’euro, le retour aux monnaies nationales provoquerait une vague de dévaluations apocalyptiques, une sorte de retour à l’âge de pierre économique. C’est à peine s’ils n’évoquent pas les famines ou les guerres qui s’en suivraient. En fait, le procédé est assez habile car en affirmant que les dévaluations sont dangereuses, ils parent de facto la monnaie unique de l’avantage de les éviter, par définition. Il faut donc compléter
le bilan de l’euro.
Le problème est que le rétroviseur historique révèle une autre réalité. Dans les années 70 et 80, quand les pays européens procédaient régulièrement à des ajustements monétaires (réévaluations ou dévaluations), la croissance était beaucoup plus forte que dans le système de parité fixe de l’euro. C’est ainsi que selon les chiffres de l’OCDE la croissance de la France est passée de 2.3% par an à 1.5% des années 80 aux années 2000 (2 à 0.8% en Allemagne et de 2.6 à 0.5% en Italie).
Bref, les dévaluations n’ont jamais handicapé la croissance du continent européen. C’est bien la rigidité de l’euro qui créé les problèmes actuels. En outre, l’histoire économique montre bien que les dévaluations sont au contraire un procédé pour relancer la croissance. C’est comme cela que la Grande-Bretagne ou la Suède sont sortis de la récente crise économique. La baisse de la monnaie permet de relancer les exportations et pénalise les importations, favorisant la production locale et l’emploi.
Les dévaluations au service de la hausse des salaires
Mieux, en constatant que l’euro comme monnaie unique pousse à la compression des salaires en Allemagne (et bientôt partout ailleurs), on en arrive à la conclusion que les dévaluations rendent davantage possibles les hausses de salaires par rapport aux autres pays. En effet, dans un régime de changes ajustables, si un pays voit ses salaires progresser davantage que les voisins, à gain de productivité équivalent, il perd en compétitivité prix sur les coûts de production.
Néanmoins, il peut à tout moment effacer cette perte par une dévaluation, comme le faisaient les pays du Sud de l’Europe par rapport à l’Allemagne dans les années 70 ou 80. Au contraire, dans un système de change fixe comme l’est l’euro aujourd’hui, il n’y a plus la possibilité de dévaluer pour compenser des hausses de salaires supérieurs à celles des voisins. Résultat, le pays dont l’évolution des salaires est la plus faible gagne en compétitivité par rapport à ses voisins.
C’est le « modèle Allemand », où les salaires stagnent depuis près de 15 ans et la croissance depuis 10 ans. L’Allemagne l’a compris avant car elle avait les coûts les plus élevés de l’Europe à l’origine. Le problème est que si le modèle se généralise, les salaires seront poussés à la baisse, tout comme la croissance. Et il faut noter qu’alors, les gains de productivité ne peuvent plus être redistribués en partie aux salariés, pris dans une course au moins-disant salarial.
Le péril des dévaluations est un fantasme bien utile pour essayer de protéger l’euro. Mais dans la réalité, les dévaluations, si elles ne sont pas dénuées de conséquences négatives (renchérissement des importations…) ont également des vertus, et notamment celle de faciliter les hausses de salaires.