Get satisfaction ! Pour en finir avec le pouvoir d’achat
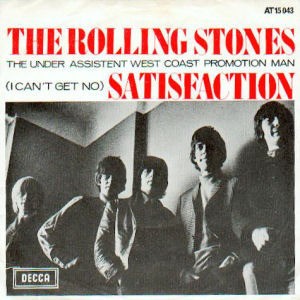
I. PRODUIRE, ACHETER
Le pouvoir d’achat n’a que récemment fait son apparition comme thème de société, introduit par un grand distributeur puis récupéré par les commentaires médiatiques et politiques. Depuis, peu d’analyses sur cet écran de fumée alors qu’un nouveau concept, le pouvoir de « satisfaction », sera esquissé dans ces lignes. Le lecteur avisé aura compris l’emploi des guillemets. Je ne suis pas satisfait de la notion de satisfaction. Alors je parle de « satisfaction ».
L’économie s’est toujours pensée comme la conjonction de choses produites et de biens échangés. Des multiples questions se sont posées sur les différents volets liés à la production et aux échanges. Pour produire, il faut investir, il faut un dispositif technique, que ce soit pour l’usine de haute technologie fabriquant des disques durs ou pour un agent de surface dont le savoir-faire est incontestable, même si ce type d’activité paraît plus abordable. L’économie est assurée par les entreprises privées dans un système libéral. Une entreprise emploie des travailleurs, rémunère les investisseurs, et doit faire des bénéfices, ne serait-ce que pour ne pas déposer le bilan. Les biens produits sont échangés au niveau d’une interface complexe mobilisant des transports, des systèmes de distribution, des vitrines de présentations à supports multiples, publicitaires notamment. L’échange est une transaction au cours de laquelle des biens sont échangés contre une quantité de monnaie qu’on appelle le prix ou bien la valeur d’échange. Celle-ci dépend de beaucoup de facteurs intrinsèques, coûts de production, transport, promotion ; mais aussi d’un ajustement qui, en fonction de l’offre et de la demande, module cette valeur d’échange.
Marx avait distingué une autre valeur, dite d’usage, autrement dit une valeur qui relève plus du qualitatif que du quantitatif. Comment déterminer l’utilité d’un bien durable comme un lit, un vélo, un appareil radio, un enregistrement sur CD, ou alors d’un bien à usage éphémère, par exemple la bouteille de champagne qui n’agit sur les papilles que le temps où les bulles restent en contact avec le palais (quoique, après il y a le souvenir), ou alors les vacances dans les îles. La valeur d’utilité est complexe, faisant entrer beaucoup de facteurs, ceux liés à la nature même du bien et ceux liés à la mise en usage du bien, avec une évidente implication de l’utilisateur. Un home cinéma ravira un cinéphile alors qu’un mélomane n’y trouvera aucun plaisir et lui préférera une chaîne haute fidélité. Un féru de cyclisme sur route n’aura cure d’un vélo d’appartement qui, lui, saura ravir une personne ayant peu d’expérience du vélo, mais souhaite faire quotidiennement un peu d’exercice. Alors que la valeur d’échange est purement objective, quantifié en valeur monétaire, la valeur d’usage est un mixte associant la nature de l’objet et ce qu’il apporte en termes de satisfaction, au sujet.
L’économie qui se veut scientifique n’accorde pas de place spéciale à la valeur d’usage. L’acquéreur d’un bien sur le marché ne compte qu’à concurrence du montant de la transaction effectuée. L’économiste se fout de l’usage d’un bien et du moment que la transaction a été effectuée, il importe peu qu’un appareil électrique reste dans son emballage ou qu’une automobile soit fracassée dans un platane. La somme des transactions permet de calculer le chiffre fétiche des politiques, la croissance. Quant à l’inflation, elle fut la bête noire des économistes et des politiques puisqu’elle mange l’épargne, autant qu’elle limite le pouvoir d’achat.
Venons-en à ce fameux pouvoir d’achat, en tête du box office des préoccupations des Français selon la presse qui ne cesse d’en parler et les politiques d’en faire un étendard permettant de prouver leur bonne volonté face aux désirs et difficultés que connaissent les Français. Le pouvoir d’achat est difficile à mesurer, contrairement à la croissance qui mesure l’augmentation du PIB sans pour autant donner une signification concrète en termes de retombées sur les ménages. La croissance est un chiffre qui nivelle la nature des biens et services produits. Tout y passe, y compris les accidents de la route, les longues maladies, etc. L’inflation est un chiffre qui est apparenté au pouvoir d’achat. Pour la calculer, les statisticiens sélectionnent un panel de produits censés représenter les achats les plus courants des consommateurs. Ce n’est jamais qu’une moyenne. La hausse de denrées moins soumises à la concurrence compense la baisse des prix pour les produits où une féroce compétition concourt à baisser les coûts de production, sans compter les effets de la mondialisation et la dynamique des pays émergents. La quantification du pouvoir d’achat implique un degré de complexité supplémentaire. Ce pouvoir quantifie le rapport entre la solvabilité des consommateurs et le prix des biens mis sur le marché. Grosso modo, il correspond à la moyenne des revenus disponibles divisé par la moyenne des valeurs d’échanges. On comprend que cet indice du pouvoir d’achat est complètement transparent vis-à-vis des disparités de revenus et des choix de consommation individuels. Ce chiffre prête à caution, encore plus que l’inflation du reste recalculée par des instances non gouvernementales. On connaît bien l’indice des prix mesuré par la CGT.
L’évaluation du pouvoir d’achat ne dit pas plus que le chiffre de la croissance. Il ne signifie rien excepté une donnée statistique qui, on le comprend aisément, fait pratiquement double emploi avec celui de la croissance puisque celle-ci est redistribué et que, si la croissance est positive, le pouvoir d’achat augmente d’année en année, ça c’est sûr. Pour le reste, les disparités sont criantes, dépendant non seulement des écarts de revenus, mais aussi de la part prise par des dépenses incompressibles, le logement, être locataire ou propriétaire, les transports si nécessaire, etc. A cela, on ajoutera la modulation de ce pouvoir par le jeu de l’épargne et du crédit. On peut différer dans le temps une partie de son pouvoir d’achat, taper sur l’épargne ou alors mettre de côté en vue d’un projet substantiel. En conclusion, le pouvoir d’achat semble plus relever de la subjectivité, d’un vécu ressenti, sans lien obligatoire avec les réalités, un peu comme l’insécurité. Il est des situations où les citoyens se sentent moins en sécurité alors que les chiffres indiquent le contraire. Et cette comparaison entre notion n’est pas fortuite car la baisse du pouvoir d’achat suscite inquiétudes et se ressent comme une forme d’insécurité. La part subjective est donc importante. Ensuite, il est vrai qu’individuellement, ceux dont le budget est moyen, voient très bien leurs dépenses se limiter, justement parce certains postes incompressibles augmentent, énergie, taxes locales, bientôt les denrées alimentaires. Et comme ce qui compte, ce sont les à côté, parfois le superflus, souvent les petits plaisirs que l’on s’offre et donnent du piment à la quotidienneté, alors si ce poste de dépense diminue, le moral baisse. Quant aux ménages les moins bien lotis, ce n’est pas le superflu, mais l’indispensable sur lequel il faut serrer et, là, ça devient déprimant, ce que l’on peut comprendre.
Cette notion de pouvoir d’achat n’apporte rien si ce n’est d’alimenter les propagandes politiques, les discussions de café et les propos de journalistes qui veulent se la jouer proximité, au plus près des Français. Les politiciens y voient manière à agir, s’attaquer au pouvoir d’achat comme on s’attaque à l’insécurité. On se souvient d’une époque où les faits divers de délinquance occupaient, trop selon certains, les écrans médiatiques. De nos jours, on verra se multiplier les reportages mettant en scène quelque ménage devant se serrer la ceinture, narrant un temps idyllique où Madame pouvait aller tous les mois chez le coiffeur et ainsi de suite...
II. LE POUVOIR DE « SATISFACTION »
Une chose paraît acquise, c’est le flou lié à cette notion de pouvoir d’achat tel qu’il est décliné comme un facteur ambiant de l’économie, placé dans les discours médiatiques et quantifié par des statistiques. Par contre, un ménage sait à peu près quel est son pouvoir d’achat, autrement dit, ce qu’il peut dépenser dans différents postes en fonction de ses revenus et qu’il dépense en fait. Le pouvoir d’achat est en fait équivalent à la somme des biens acquis, qu’on additionne en comptant chaque objet et qu’on mesure en termes de monnaie comme la somme des valeurs d’échanges investies dans les transactions. Par exemple, pour un ménage à quatre, sur un mois, 120 repas à domicile, 120 sur le lieu d’étude ou de travail, 10 séances de ciné, 100 litres d’essence, 5 livres, 30 quotidiens, deux pantalons, six chemises, une robe, etc. Somme dépensée par ce ménage, 1 500 euros, soit à peu près la différence entre le revenu du couple et les dépenses incompressibles, logement, impôts.
Voilà maintenant comment construire une notion nouvelle, celle du pouvoir de « satisfaction », en nous calquant sur la distinction entre valeurs d’échange et d’usage. Dans l’exemple ici proposé, la quantification du pouvoir d’achat de ce ménage est neutre. Elle n’indique rien excepté une recension d’objets et leur coût total. Cette configuration est à comparer avec la valeur d’échange. Maintenant, faisons entrer en ligne de compte la relation des membres de ce ménage face à ce qui est consommé. L’utilité des objets intervient, mais plus que l’utile, notion quelque peu obsolète (quoique), c’est la satisfaction qui indique le résultat subjectif lié à la consommation de biens et service. De ce point de vue, à pouvoir d’achat équivalent, le degré de « satisfaction » peut varier sensiblement d’un ménage à un autre, et surtout d’un individu à un autre. Ce constat vaut pour des objets identiques. Mais aussi, la modulation est prise en compte dans le contexte d’une philosophie de la consommation. Il est possible, à revenu égal, d’augmenter sa « satisfaction » si on choisit avec soin les biens acquis, et aussi si on fait un effort pour aller vers le produit qui, à « satisfaction » égale, est le moins cher.
Un autre volet se précise, faisant intervenir une fois de plus le sujet. L’homme est pris dans sa dimension désirante et volitive. Le degré de « satisfaction » dépend non seulement des biens consommés, mais de la possibilité d’avoir satisfait ses désirs. Et là, l’affaire se corse, impliquant la perturbation des désirs et affects par les médias et leur pub, ainsi que la nature envieuse de l’humain et, pour parler comme Freud, le principe de plaisir. Dans la notion de pouvoir de « satisfaction », la quantité de choses désirées intervient. Si bien qu’on peut augmenter son pouvoir de « satisfaction » en limitant ses desiderata, en jouant (Freud encore) sur le principe de réalité, autrement dit, la conscience d’avoir un budget limité.
Le pouvoir de « satisfaction » est l’indice qui implique l’intégralité du sujet consommateur. De plus, on comprend aisément que ce pouvoir est entre les mains de chacun, moyennant quelques conditions minimales de revenus. Il va de soi que les ménages en situation de pauvreté ou de précarité ne sont pas concernés. Il appartient à chacun de trouver cette sagesse prosaïque, inspirée par l’épicurisme, visant contrôler ses désirs, en y associant une sagesse stoïcienne inclinant à reconnaître que le pouvoir d’achat ne dépend pas de nous, et qu’il faut accepter la situation et œuvrer pour la part de choix et de désirs qu’on peut décliner personnellement et satisfaire. Enfin, il faut admettre qu’en certains cas, le pouvoir d’achat dépend de la personne, mais c’est le fait d’une minorité qui exerce une profession indépendante où le carnet est rempli et la marge de manœuvre possible, minorité à laquelle on ajoutera ceux qui sont salariés dans une entreprise, elle aussi au carnet rempli et qui peuvent faire des heures supplémentaires (comme le monsieur dans la pub il le raconte sur les ondes radiophoniques). Toute la subtilité de Sarkozy étant d’élargir le groupe des lauréats du travailler plus en qualifiant les salariés ayant engrangé des RTT, puis ceux qui ont accumulé des participations dans les entreprises. Mais attention, le père Noël ne passe pas deux fois.
Cette notion de pouvoir de « satisfaction » offre un tout autre recadrage sur cette question du pouvoir d’achat. La marge de manœuvre pour chacun y est étendue et dans le contexte actuel où les désirs sont insolvables par l’économie, il est préférable de pratiquer l’économie de ses désirs pour vivre plus sereinement en se contentant de limiter et choisir sa consommation, ce qui n’empêche pas d’accéder à des plaisirs, gorgées de bière et même plus, pour peu qu’on ait le don d’inventer sa vie et de vivre ses inventions.
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON











