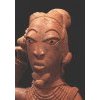L’Etat et les forces aveugles de l’économie (2)
Ce n’est donc ni chez Marx, ni chez Lénine que la Gauche a puisé son idolâtrie de l’État. Mais où donc ? Chez les théoriciens de l’État absolu…

Dans un précédent article, j’ai montré que jusqu’à la fin du XVIème siècle, en dehors de quelques voix isolées, la méfiance des lettrés à l’égard de l’État est générale. « Il faut se protéger de l’emprise du pouvoir ».
Deux grands théoriciens politiques ont alors inversé cette aversion traditionnelle à l’égard de l’État.
Jean Bodin, auteur des Six Livres de la république se fait le promoteur de la souveraineté de l’État. Il entend par là que l’autorité politique n’a de comptes à rendre à personne, et cela passe pour un grand « progrès » de dégager ainsi l’univers politique de la contrainte morale que fait peser sur lui la religion. Malgré les contradictions de la pensée de Bodin, voici le Politique enfin au moins potentiellement autonome, souverain ! Mais Jean Bodin offre encore le résumé d’une pensée qui lui est antérieure et qui a connu une efflorescence peu commune dans l’Europe du XVIème siècle.
Thomas Hobbes fera, lui, de façon plus marquée œuvre de pionnier en se fixant sur un thème central : l’État doit être souverain car la Société laissée à elle-même n’est rien d’autre que le règne des méchants. Homo homini lupus. Toute la pensée politique moderne découle de Hobbes qui opère la révolution copernicienne de la politique. Jusque là l’État politique avait tourné autour de la Société, organisée en elle-même grâce à la famille, à la collectivité locale, à la cité, etc. Désormais, c’est la Société qui va tourner autour de l’État, promoteur de son organisation « libre » et rationnelle… Jusqu’à cette époque, la loi fondamentale de la Société a été la solidarité ; elle est maintenant devenue la lutte de tous contre tous, dont les « marxistes » développeront une version allégée, la « lutte des classes ».
Cette révolution assumée par Thomas Hobbes a été vécue de deux manières différentes, qui sont à l’origine des deux grandes familles politiques depuis trois siècles, la Droite et la Gauche, lesquelles vont donner deux versions différentes.
Vu de droite, l’État est le représentant du bien commun, et ceci d’autant plus que le dicton de Hobbes, l’homme est un loup pour l’homme, n’est pas pour elle un simple constat mais un véritable mot d’ordre : plus l’homme sera un loup, plus l’État deviendra indispensable, le seul pôle possible de l’organisation sociale. Ordre, sécurité, propriété, mais aussi la religion, la famille et les organisations sociales, considérées non plus en elles-mêmes mais comme les meilleurs relais de l’autorité de l’État, les instruments de sa diffusion dans le corps social.
Ce que la droite voit dans le domaine de l’être, la gauche le projette dans celui du devoir être. Il est évident, dit-elle, que l’État est l’organisation des inégalités de la société, le produit d’une domination de classe, alors qu’il doit être la promotion de son organisation rationnelle, la seule raison qu’elle puisse revendiquer : le bien-être de tous.
L’origine de l’amour de la Gauche pour l’État se trouve ainsi, moyennant cette adaptation, chez le grand penseur absolutiste, le théoricien du Léviathan. Deux écoles de pensée vont amener la transition. D’abord les Lumières qui, sous la houlette de Diderot et Voltaire, culmineront dans une notion qui n’apparaîtra qu’au début du XIXème siècle mais qui est implicite à tous les développements politiques des hommes de l’Encyclopédie, le concept de despotisme éclairé.[1] Dans un second temps, c’est l’utopie fleurissant au début du XIXème siècle qui fournira le relais déterminant vers le Socialisme, qu’on a aussi baptisé socialisme utopique dans la mesure où il met au centre de son action un État rationnel utopique, le temps où les philosophes sont rois, qui est aussi le temps où l’organisation de la société fait le bonheur de tous.
C’est donc bien en vain que Karl Marx a tenté de décrocher les « révolutionnaires » de l’idolâtrie de l’État. Il voyait encore dans les prolétaires, cette lie de la société, rejetée de l’ordre social, et dans leur capacité à s’organiser contre le Léviathan, précisément parce qu’ils étaient tenus en dehors de Lui, un possible remède à la croissance de l’État absolu. Mais un des meilleurs lecteurs de Karl Marx a été Otto von Bismarck qui s’est fait le promoteur d’un État social dont le mot d’ordre principal est devenu au tournant du siècle, en France et en Angleterre comme en Allemagne, celui de la solidarité.[2] Et cet État de solidarité est par la vertu d’une longue guerre qui a permis de renverser tout ce qui restait d’organisations autonomes de la société qu’est né l’État-Providence, valeur incontestée dans laquelle se retrouvent la Gauche et la Droite, avec toujours la même inflexion particulière qui fait que pour l’une l’État est cette providence que pour l’autre il doit devenir.
Il faut encore établir une nuance, qui est présente déjà dans la pensée politique des Lumières : jamais nos hommes d’État revendiquant le bonheur de tous n’ont pu trancher entre deux voies de réalisation de cette utopie. On sent chez certains la mise en avant de l’action collective : c’est par la mobilisation de tous que va se construire ce bonheur collectif. Malheureusement, cette « mobilisation » porte parfois un autre nom, bien moins éclairé, celui de populisme. L’autre voie de réalisation est bien de dire qu’il faut construire ce bonheur de tous, y compris contre l’avis de la majorité, ce qui porte le nom de dictature. Mais que faire, répondent-ils, puisque les uns et les autres (surtout les plus faibles) sont menés par l’opium, hier de la religion, aujourd’hui de la consommation etc. Pas plus que les Lumières, la Gauche n’a pu se dépêtrer de ces contradictions qui la hantent encore.
@
Cette réflexion n’est pas sans relation avec la crise de la Dette que nous vivons actuellement. Depuis un siècle (août 1914) les États sont le seul moteur de la vie économique, quoique celle-ci continue à se réguler par les mécanismes de l’intérêt et la régulation de l’argent. Car dans ce système hybride, c’est l’action de l’État qui est déterminante, qui est le moteur final. Or c’est bien ce moteur qui est en panne !
Devant les premiers crachotements du moteur, les « libéraux » ont apporté il y a vingt ans une solution « miracle », dissoudre l’État ou du moins la plupart de ses fonctions ou « services » en sociétés commerciales soumises à la concurrence.[3] Mais que l’État soit gestionnaire de ces services ou qu’il en devienne le simple client, quelle différence ? Ce mouvement de « libéralisation » n’a donc fait que contribuer à l’explosion du moteur. Et c’est en fonction de cela que les keynésiens viennent aujourd’hui nous dire : c’est parce qu’on a retiré cette gestion à l’État que tout va mal ! Et de nous proposer comme seul remède à un siècle d’économie centrée sur le moteur de l’État … encore plus d’État !
Qu’on ne puisse plus voir d’autre remède à la crise que le remède dans le mal est bien le signe que nous traversons une crise historique que ne peuvent aborder ni la droite, qui propose de tuer le malade, ni la gauche, qui réclame l’extension de la maladie !
[1] Voir Jacques De Cock, Politique des lumières.
[2] Voir Maltagliati, D’août 14 à l’âge d’or de l’État, le chapitre Genèse de l’État providence.
[3] La revendication de « liberté » des libéraux est une sacrée hypocrisie. C’est la libre concurrence… sur les marchés d’État qu’ils demandent, après avoir, sous le couvert du libéralisme dominant au XIXème siècle, apporté leurs pierres à la construction du Léviathan, dont ils font semblant de découvrir soudainement qu’il prend toute la place… !
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON