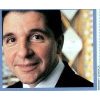La France, un grand parc nucléaire mais une électricité trop chère pour l’industrie !
Coup de chapeau aux politiciens. L’électricité devient chère dans le pays qui a la plus grande et la plus performante production d’électricité nucléaire par habitant au monde !
L’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité permet à EDF de fixer librement ses prix alors que les concurrents étrangers ne peuvent ni créer de nouvelles capacités de production en France, ni y acheminer de l’électricité à un meilleur prix. A court terme, les grandes usines chimiques, métallurgiques, papetières sont menacées. Le consensus politique pour reporter à 2008 les hausses de l’électricité vendue aux particuliers conduit à sacrifier sans débat 100 000 emplois déjà menacés.
De 1975 à 2000, l’industrie française est passée de 6 à 4 millions d’emplois. Mais pendant cette période, de très gros investissements ont créé ou modernisé des sites de production sidérurgique, de chimie, d’aluminium, de fonte, de papier ou de verre. Pour Pechiney, Sacilor, Saint-Gobain, Kimberly Clark, la France avait un avantage comparatif : le prix de l’électricité.
Depuis 2000, les destructions annuelles d’emplois industriels ont doublé par rapport à la période précédente . Entre 2000 et 2010, un emploi industriel sur quatre aura été supprimé. La cause principale du déclin de l’emploi dans les secteurs manufacturiers (cuir, textile, électronique, meuble, équipements automobiles et aéronautiques) n’est plus seulement l’avantage comparatif des pays à bas salaires. Il existe une nouvelle cause de délocalisation, la cherté de l’électricité pour l’industrie, alors même que l’électricité produite en France est la moins chère d’Europe de l’Ouest !
Les prix ont doublé depuis 2000. En 2006, de grands groupes internationaux comme Pechiney ou Stora Enso (papeteries) ferment leurs sites les moins productifs... en France, à Lannemezan (260 emplois) ou à Corbehem (600 emplois). Le président de Saint-Gobain annonce que ses nouveaux fours seront installés ailleurs à cause du prix de l’électricité. 70 000 emplois des grandes usines « électro-intensives », auxquels s’ajoutent les dizaines de milliers d’emplois indirects, sont délocalisables.
L’ouverture à la concurrence de la téléphonie fixe, au niveau international, national et local, a bénéficié aux consommateurs. La concurrence dans les services postaux express profite aux clients et a permis la création de grands opérateurs mondiaux, comme DHL - la poste allemande ou TNT - la poste néerlandaise.
Pour l’électricité, qu’avait la France à gagner avec la création d’un marché concurrentiel européen ? Le pays dispose d’un parc de centrales nucléaires (1 réacteur pour 1 million d’habitants contre 0,3 aux USA, le second pays nucléaire) qui produit l’électricité la moins chère d’Europe de l’Ouest. Le pouvoir politique national fixait les tarifs d’EDF. Dans le nouveau système, EDF vend son électricité au prix de son concurrent étranger le moins productif. Les grands clients français n’ont pas de fournisseurs alternatifs. L’appel d’offres des sept usines les plus consommatrices d’électricité de France a été infructueux faute de candidats. De plus, dans le nouveau système, les tarifs d’électricité connaissent des pics tarifaires (jusqu’à 100 euros le mégawatt au lieu de 30 en moyenne) qui étaient inconcevables auparavant. La volatilité des prix crée un marché spéculatif de l’électricité.
Dans l’ancien système, l’industriel était gagnant, dans le nouveau, c’est le trader. Le nouveau système crée un potentiel de spéculation sur les actions et sur les prix car la demande dépasse l’offre. Ce déséquilibre est structurel pour deux raisons : il est difficile d’installer des nouvelles centrales nucléaires pour maintenir la capacité de production (car des centrales sont arrêtées), ou pour l’augmenter. Il est aussi quasiment impossible de créer des réseaux aériens de transport d’électricité entre les pays européens, à cause de l’opposition des riverains ou des Verts.
Le marché européen de l’électricité n’est pas plus concurrentiel que quand il était national et dominé par un monopole public encadré. Le changement principal est que la mission des opérateurs nationaux (EDF, Enel, Endesa...) n’est plus d’assurer une fourniture d’électricité à long terme mais de générer des profits à court terme. Or, les industries consommatrices d’électricité sont des activités capitalistiques de long terme. Elles ne peuvent pas prospérer si le souci du long terme n’est pas partagé par les fournisseurs de l’électricité.
Le scénario actuel est catastrophique : dans le nouveau système, un industriel a intérêt à transférer ses capacités dans un pays à bas salaire, hors union européenne, où l’Etat a encore sa propre politique d’électricité. Les Français paieront plus cher l’électricité après avoir fait l’effort de financer la recherche et un parc nucléaire performant. Les Français paieront aussi les retraités d’EDF qui sont directement à leur charge dans le budget de l’Etat depuis deux ans. Les seuls gagnants de cette politique débile seront les opérateurs financiers qui spéculeront sur l’électricité et sur les actions des entreprises d’énergie.
L’heure est à la prise de conscience, à droite et à gauche, que ni la fusion GDF-Suez ni la renationalisation d’EDF ne traite le problème posé par le cadre issu des directives européennes créant un marché unique de l’électricité.
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON