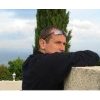Le budget 2006 : la grande fuite en avant ?
Année de mise en place de la LOLF*, le budget 2006 constitue la clé de voûte de la politique à venir jusqu’aux élections de 2007. Constellé de points d’ombre, déloyal ou courageux, ce budget est loin de faire l’unanimité. L’État peut-il encore se permettre de continuer longtemps sa fuite en avant ?
Au vu des échéances électorales proches, le gouvernement tente de faire passer la douloureuse pilule du budget 2006 à coup de cachets d’aspirine et de tours de magie. Il est nécessaire d’analyser plusieurs aspects concrets, qui montrent avec clarté la volonté d’un gouvernement qui, sous couvert de sincérité, ne sait plus quoi faire pour assurer sa pérennité, et plus encore, sa légitimité.
Aveuglement ou stratégie de conservation du pouvoir ? Une chose est certaine : avec un tel budget, la France est condamnée à une croissance molle, creusant les inégalités sociales :
1. Des recettes incontrôlées
- D’une part, le budget 2006 est constellé de tours de passe-passe dignes de la société tristement connue ENRON. Mais "Tout va bien madame la marquise !"
Des recettes exceptionnelles et autres soultes viennent compenser des déficits récurrents dans les budgets de fonctionnement. De plus, l’équilibre financier n’existant pas pour un déficit récurrent, et proportionnellement très fort par rapport aux recettes (-70 G€ soit 20% des recettes), n’incite pas à la confiance.
Les seuls intérêts de la dette représentent autant que les recettes de l’impôt sur le revenu !
Le pire, c’est que les dépenses de fonctionnement (hors investissements et enveloppes spéciales) ne sont même plus couvertes par les recettes.
En finances publiques (dont les lois et décrets sont régis par ceux-là mêmes qui ne les respectent pas), une telle situation s’appelle de la cavalerie.
La cavalerie consiste en une fuite en avant des dépenses et une récurrence du déficit, autrement dit, un creusement des pertes systématiques et irrémédiables en la situation.
Dans les collectivités territoriales, cette situation est impossible, car un redressement a automatiquement lieu.
En entreprises, c’est le dépôt de bilan, ou le programme de sauvetage à courte échéance.
Pour l’État, c’est un budget digne et durable ( !)
Il advient que l’État, représenté par les frères Grimm (M.Copé et M.Breton), propose de combler les trous par des enveloppes incroyables :
- 2 G€ de la Poste, EPIC en pleine mutation, et surtout connaissant de graves dettes.
- 11 G€ de la vente probable des sociétés d’autoroutes qui, outre qu’elles constituent une part du patrimoine français, rapportent à l’Etat 1 G€ environ de recettes récurrentes et assurées. Autrement dit, la vente de ces parts perce un nouveau trou dans la coque du bateau.
- 1 G€ de transferts astucieux de RFF vers l’État (on creuse dont le trou de RFF sous couvert de renflouer l’État).
Bien d’autres dispositifs existent ; ce qu’il faut retenir, c’est que l’État jette ses écrans de fumée pour le moment, mais il ne pourra plus le faire dans les années à venir.
- Le gouvernement table sur une croissance supérieure à celle de la zone euro (2,5%), qui plus est probablement difficile en année pré-électorale (année de réalisations des projets, donc de dépenses). Cette croissance n’est justifiée par aucun indicateur économique. De plus, la non-maîtrise à la fois des coûts de l’énergie et de la balance commerciale sont des éléments non négligeables, complètement occultés dans le budget.
- L’absence de recettes due au dégrèvements fiscaux : il s’agit d’une astuce très grossière. Au lieu de débloquer de l’argent pour agir, l’État fait le choix d’en ponctionner moins sur des secteurs très spécifiques, et étrangement très liés à son électorat.
D’une part, la multitude de dispositifs, que ce soit pour l’emploi ou pour le handicap, conduit à des trous sans fond, faute de recettes. Les contrats d’aide à l’emploi en sont un très bon exemple.
Financés à hauteur de 80% du salaire par l’État (eh oui), les CAE sont des contrats qui non seulement ne rapportent rien en recettes (pas de taxe patronale), mais en plus coûtent très cher à l’État. Il faut savoir que pour faire du chiffre dans l’emploi précaire -les CAE ne seront pas codifiés dans le code du travail, ce qui signifie leur abandon à terme- l’État dépense près de 10 000 €/an, par contrat aidé, et doit absorber un manque à gagner d’au moins autant.
Faites les calculs, on arrive très rapidement à des enjeux de plusieurs milliards d’euros, au vu des contrats conclus.
D’autre part, les dégrèvements sélectifs amputent très fortement les recettes.
-La baisse des recettes de l’impôt sur le revenu, du fait de l’abaissement des taux pour les salaires moyens, hauts et élevés (« bouclier fiscal »).
-La baisse des recettes issues de l’ISF, impôt qui touche principalement les millionnaires et laisse échapper d’importantes recettes, du fait des multiples niches fiscales. La fuite des agents de Bercy vers des postes de consultants en défiscalisation n’est pas près de cesser.
-La baisse des recettes issues des entreprises, du fait de la multitude des dispositifs visant à alléger les charges, bien que certaines mesures aient été souhaitables en ce sens. On pourra citer sur ce point les mécanismes d’allègement proposés par la CNSA, ou les fonds pour les prestations de compensation pour le handicap.
-La baisse de la taxe professionnelle (TP) va également jouer sur les budgets des régions.
- Les cadeaux indolores, tels que l’adoption d’un amendement exonérant de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 75% de la valeur des actions nominatives détenues dans leur entreprise par les salariés et dirigeants. Qui détient ce type d’actions ? Dans quelles entreprises ? Je vous laisse deviner à qui cela profite (encore), et surtout l’incidence de ce type d’amendement sur la croissance et la justice sociale.
A partir de ces éléments, il n’est pas surprenant de voir des recettes improbables. Certains pourraient dire que la dette n’est pas un problème, puisque les États-Unis en ont aussi une, énorme, et que cela ne les empêche pas d’avoir une forte croissance.
Certes, mais à moyen terme, il est certain que cela ne va en rien améliorer la situation des citoyens, surtout pas ceux de la classe moyenne (il n’y a qu’à voir ce que cela donne aux EU...) D’une part, les aides ne sont pas mieux gérées, et, d’autre part, les enveloppes cadeaux se multiplient pour les classes les plus aisées.
Quand on donne d’une main de l’argent, il faut bien le reprendre ailleurs...
2. Le défaussement de l’Etat sur les collectivités
Vous l’avez sans doute remarqué récemment, votre taxe d’habitation s’est envolée (de +3 à +15 % selon les communes et EPCI). Ce n’est pas la seule. La taxe foncière et les autres taxes locales n’arrêtent plus de monter. De même, les caisses (CAF, CPAM..) connaissent aussi des hausses des cotisations, sans parler de la CSG et autre CRDS...
Il s’agit de l’effet" décentralisation inachevée".
L’État se dédouane de ses responsabilités, et se défausse sur les collectivités, surtout sur celles qu’il pensait contrôler (les régions) en transférant la gestion des dispositifs lourds (RMI, formation professionnelle, transports ferroviaires...), sans pour autant les compenser financièrement. Les collectivités doivent donc payer, et par conséquent, les administrés.
Il advient que, pour le même service, il y a un dédoublement des structures, et donc une hausse mécanique des coûts.
Déconcentration et décentralisation ne se complètent pas, elles se superposent.
Moins de recettes pour l’État ? Oui, mais sûrement pas moins de recettes globales pour le secteur « public », et sûrement pas mieux réparties.
La faille sociale se creuse, elle se creuse quand on adopte ce type de budget.
3. Les dépenses : vers l’absence absolue de gestion
Si les recettes sont limitées, les dépenses conservent, quant à elles, toute leur amplitude, en coupant les financements des choses à faible valeur qu’utilisent les agents (fournitures et autres petites prestations), en diminuant le nombre de fonctionnaires (lesquels ?) sans pour autant agir sur la structure du système.
La crise du moment est structurelle, et non conjoncturelle.
L’absence de gestion rationnelle des dépenses lourdes ampute l’État et aggrave son absence de clairvoyance pour l’avenir.
On pourra citer dans ces dépenses le paiement de 6 à 7 échelons décisionnels (Europe, État, Région, Département, EPCI, (Cantons), Communes), d’un nombre incalculable d’associations dites d’intérêt public, d’une quantité de structures dédoublées (Conseil économique de l’État et Conseils économiques et sociaux régionaux ), d’un foisonnement de structures sédimentées (DATAR, Commissariat au plan) ou à vocation identique (Conservatoire du littoral, Conservatoire du patrimoine).
La page serait trop courte pour citer l’incroyable quantité de structures qui drainent, à force, les finances de l’État pour remplir un service qui pourrait tout aussi bien être géré par les collectivités elles-mêmes, ce qui diminuerait le nombre d’intervenants dans les consultations.
Je pourrais également citer les chambres consulaires (CCI, CCA), les ambassades, les préfectures etc. Tout cela a un coût. Deux statistiques :
La France est le pays le plus administré d’Europe.
La France est également le pays avec le plus d’associations par habitant.
Il va de soi que les structures se recoupant, elles se superposent et promettent des casquettes multiples à certains. De plus, le versement automatique et reconduit des aides aux associations permet à certaines d’entre elles de détenir des fortunes non négligeables, principalement via de l’argent public.
Là où seulement 6% du budget était voté (reconduction automatique des budgets majorés de l’inflation), la LOLF devrait pouvoir permettre d’engager de réels débats sur les dépenses majeures, telles que celles de l’éducation ou de l’armée.
Qu’en est-il ? Eh bien, rien ne se passe.
Le fait d’avoir un gouvernement qui passe par voie d’ordonnance et s’enferme dans sa tour d’ivoire n’incite pas à croire que la Ferrari puisse démarrer...
- Le caractère non sincère du budget des frères Grimm se traduit également par l’absence d’action sur la maîtrise des enveloppes. Prenons un exemple :
Le SYTRAL à Lyon distribue une somme à la société exploitante de transports en commun, Keolis, afin qu’elle puisse compléter les recettes de la clientèle (75% public, 25% recettes privées). Imaginons que 100 000 € soient confiés à un directeur de secteur pour gérer 4 lignes. A la fin de l’année, si l’enveloppe n’est engagée qu’à hauteur de 70 000 €, le reliquat n’est pas reversé au Sytral. Le reliquat est intégralement consommé, soit en dépenses supplémentaires, soit en primes pour les agents.
Ne serait-il pas possible de trouver un compromis, pour que certaines enveloppes incomplètes reviennent et ne soient pas consommées en tickets restaurants ou aides à l’association de foot locale ? Comment prévoir à l’euro près, si dans un sens on demande des rallonges, et si dans l’autre, tout reliquat est consommé : le système est déficitaire conceptuellement.
Du coup, toutes les dépenses sont amplifiées par un certain facteur, facteur qui pourrait être comblé par une gestion affinée de la distribution des enveloppes budgétaires.
Mais non.
- Le principe de non affectation d’une recette à une dépense est obsolète. Par exemple, il serait intéressant d’affecter une taxe sur les 4X4 aux actions de l’ADEME. Au lieu de cela, on préfère dans les budgets du « règne Chirac », affecter peu de moyens humains et énormément de moyens financiers pour aider les entreprises.
Il advient que l’ADEME, tout comme de nombreuses structures de ce type, vivotent, alors qu’elles distribuent des millions d’euros.
La liste des dépenses mal maîtrisées pourrait être longue, mais il s’agissait avant tout de présenter le principe d’un tel budget fondé sur un concept qui n’a jamais fait ses preuves.
Si les entreprises et les entrepreneurs gagnent de l’argent, alors ils le réinvestiront, et créeront de l’emploi.
Ce dogme de M.VGE s’est toujours avéré faux, ou incomplet, par le simple fait que le gain important d’argent n’entraîne pas forcément un réinvestissement, et donc pas forcément de l’emploi. De plus, l’absence de champ spatial occulte le fait que l’investissement peut se faire à l’étranger et peut ne bénéficier nullement au pays.
Pourquoi investir 1M € en France, quand ce même million peut en rapporter dix fois plus en Chine ou en Inde ?
4. Un cercle vicieux durable sans changements structurels
Le concept politique de base de M.Chirac et de tout son parti politique (UMP) est probablement fondé sur un concept qui était vrai dans les années 60 (concept véhiculé à travers les promotions de l’ENA que nous connaissons aujourd’hui). Cependant les choses ont changé, et ce concept est aujourd’hui erroné.
L’affectation de richesses aux plus aisés ne profite qu’à eux-mêmes, et à leur cercle restreint. La concentration de richesses n’engage pas forcément les investissements, et c’est parce que ces investissements manquent que l’emploi n’est pas là en France.
Sans projets, sans moyens financiers pour payer des hommes, il n’est pas possible de créer de l’emploi. Cela occasionne par la suite un manque à gagner pour les recettes de l’État, une absence récurrente de consommation, et plus encore un manque à gagner pour l’organe de production.
La perte de richesse, occasionnée par l’absence d’une partie de la population de là où elle devrait se trouver (vie active), engendre l’effet « main invisible » de Adam Smith, c’est-à-dire la répercussion d’une action sur trois ou quatre autres agents.
L’absence d’emploi, consécutive de la concentration de richesses et du sous-investissement, engendre une hausse des dépenses sociales de compensation. Cette hausse des dépenses sociales engendre une nécessaire hausse des prélèvements. Ceux-ci étant majoritairement réalisés sur la classe moyenne en proportion absolue de salaire (soit une forte valeur relative), ils engendrent un ralentissement de la consommation de cette classe, et un affaiblissement de son pouvoir d’achat.
La hausse des prélèvements ne peut que compenser le manque d’emplois, et donc de revenus, ce qui ne crée aucune richesse et entraîne le moteur d’une nation (sa classe moyenne) à se restreindre.
Ce système se répercutant d’année en année, le chômage augmente, les prélèvements augmentent eux-aussi, la classe moyenne est tirée vers le bas (ce qui l’écarte encore un peu plus de la classe aisée) et la croissance est atone. Le phénomène est accru par le poids de certaines fortes hausses sur les budgets des ménages : logement , énergie et taxes locales, en premier lieu.
Parallèlement l’État doit compenser des recettes de plus en plus réduites face à des dépenses en hausse, ce qui crée une dette, la creuse, et la renouvelle de manière récurrente. Pour compenser cette dette, l’État emprunte auprès de banques, puis auprès d’autres banques à des taux de moins en moins avantageux. L’intérêt de la dette ne fait que grever les finances, compromettre les investissements et engager des générations à combler la dette, sous peine de devoir dépendre des banquiers. Ces derniers jouissent d’une manne incroyable, qui leur permet d’engranger de substanciels bénéfices et de tirer la nappe à eux, sans en faire profiter l’ensemble de la nation.
Certaines autres classes de personnes (directeurs d’entreprises, entrepreneurs...) sont très fortement soutenues par les orientations fiscales, sans que leur soit demandée une contrepartie d’investissements qu’ils ne sont pas toujours à même d’engager.
Le système se fige alors dans un cercle vicieux, créant du chômage et de la précarité, pendant qu’une minorité s’isole du reste de la société et engrange sur des comptes et des moyens de placement de l’argent statique. Cet argent ne crée aucune richesse partagée, si ce n’est pour le banquier, l’assureur ou le propriétaire. La redistribution sociale étant inadaptée et ne portant pas sur la cause du système (l’investissement, l’éducation et l’emploi), le pays s’enfonce et s’immobilise dans la léthargie. De plus, il ne traite en rien les problémes humains et sociaux, particulièrement ceux liés à la méritocratie et à la reconnaissance du travail fait.
Ce cercle vicieux, c’est le nôtre, en 2005.
D’où ma conclusion simple, d’une France qui n’a pas changé depuis un siècle, du point de vue des mentalités :
France, orgueilleuse et généreuse, tu n’es bonne qu’avec tes ennemis.
La LOLF
LE BUDGET 2006 est, pour la première fois, organisé selon les règles de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 par la gauche et la droite. Jusqu’à présent, le budget était présenté par types de dépenses (fonctionnement, investissements...) Désormais, il est divisé en 34 missions (sécurité, justice enseignement scolaire...) qui peuvent relever de plusieurs ministères. Chacune de ces missions est découpée en programmes, il y en a 132 au total. Pour ces programmes, une stratégie est définie, qui conduit à sélectionner des objectifs. La réalisation de ces derniers sera mesurée par des indicateurs de performances
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON