Noter les noteurs
Au lieu de pleurnicher, les États devraient se moucher le nez, puis moucher les agences.
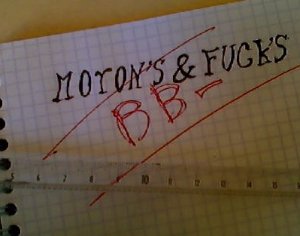
Les gouvernements seraient chagrins du pouvoir des agences de notation, auxquelles ils ont eux-mêmes confié les clés de leur destin comptable. En vérité, la souveraineté qui leur inspire des larmes, ils n’en veulent plus. Surtout, ils ne veulent plus de la responsabilité qui va avec, la pénible nécessité de justifier de leurs actes devant les piétailles de qui ils tiennent leur légitimité. L’autorité des agences de notation, en sa docte bêtise, les soulage du poids de la politique. Ils ne font que déférer à l’inévitable.
Voudraient-ils rétablir leur souveraineté contre les agences, pourtant, qu’ils le pourraient sans peine.
Ainsi, il ne tiendrait qu’aux États de retirer aux agences la mission de contrôler le taux de couverture des risques par les banques : privées de ce genre de sinécure, elles réussiraient un moment à se rendre nuisibles ailleurs, mais finiraient par manquer d’air.
Un autre moyen de se protéger d’elles, et de hâter leur fin, serait de les discréditer. Nul besoin pour cela de les calomnier. Y suffirait un observatoire constitué de par la volonté des États, ou de certains d’entre eux, et missionné pour évaluer et noter le travail des agences, de façon à signaler aux « marchés » l’inanité de la notation chaque fois qu’une ânerie aura échappé à l’incontinence de Moody’s, Standard & Poor’s ou Fitch.
Il faudrait aux États se garder d’être seuls à réduire par ce moyen le pouvoir des agences. Mais ils pourraient compter sur la foi de charbonnier de tous les acteurs économiques et de l’opinion publique dans les mesures quantifiées, qui est la religion des temps présents. Il n’est que de laisser tomber, même pas de jeter, un barème ou un classement dans le public pour qu’il suscite une adhésion enthousiaste des clercs et la crédulité des ouailles1. Le reste n’est qu’affaire de publicité (et les agences de notation, sexy comme des congrès de notaires, ne sont pas de bons acteurs de l’agit-prop’).
L’examen des critères de notation dont usent les agences constituerait un premier critère de notation des agences par cet observatoire. Il se décomposerait en autant de critères seconds qu’il serait utile et pertinent : étendue du périmètre étatique pris en considération ; la pertinence du périmètre dans le cas d’espèce ; prise en considération de la dette ou de l’épargne privée ; prise en considération de l’économie souterraine ; prise en considération des facteurs de fragilité ou de robustesse opaques à l’analyse comptable (népotisme, corruption, violence d’État, légitimité politique, culture nationale…) ; pluralité des approches ; caractère contradictoire de l’étude ; etc.
Un autre critère concernerait le tour de table des agences et de leurs équipes d’experts. Il se décomposerait en autant de critères seconds qu’il serait utile et pertinent : nationalité (degré de diversité) ; liens de subordination vis-à-vis d’un État ; liens avec tel ou tel secteur économique ; liens avec des emprunteurs ou bailleurs internationaux (marché obligataire…) ; niveau de compétence ; pluralité des compétences ; etc.
Chaque notation particulière produite par une agence serait en outre passée au tamis d’une grille d’opportunité, selon des critères prescrits (visant à saisir le degré de fragilité des marchés).
L’ensemble s’apprécierait au vu d’une note rappelant les exploits passés de l’agence considérée et l’impact de ses notations.
Il faudrait beaucoup de mauvaise volonté de la part des observateurs, même pétris d’indulgence, pour que les officines privées new-yorkaises monomaniaques qui terrorisent le monde s’en sortent souvent avec beaucoup mieux qu’un « BB– » propre à susciter une indifférence polie.
Tout simplement parce que l’analyse financière, si elle peut produire des effets (surtout entre des mains irresponsables), ne produit pas de connaissance. Elle n’éclaire que le pied dont elle écrase ce qu’elle prétend connaître.
Les Vingt-Sept pourraient mettre sur pied un outil de notation des agences de notation en deux mois. Par défaut de concurrent (Washington n’oserait jamais en jeter un autre dans les jambes des trois vieilles biques déjà citées, et Pékin manquerait d’alliés de bonne réputation pour en bricoler un), il ne tarderait pas à s’imposer à l’échelon mondial.
Ils ne l’ont pas fait, et la faute en revient particulièrement à Bruxelles, qui a préféré amuser la galerie avec un pistolet en bois.
1. Témoin le « classement de Shanghaï », dont la plupart des politiques et des économistes préfèrent ignorer qu’il n’a de valeur que dans le plan de formation de la jeune nomenclature issue du PCC et en fonction d’objectifs d’intelligence économique définis par ses instances dirigeantes : l’idée que la réussite économique de la Chine accrédite ledit classement comme exportable et transposable dans l’univers entier ressortit à la pensée magique. On classe aussi les marques ou les joueurs de tennis. Ca facilite la composition des tableaux des tournois, ou ça engraisse des cabinets de consultance (comme on dit de voyance), qui auraient bien tort d’avoir des scrupules.
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









