Pour une réforme du mode de financement de la Sécurité sociale
Depuis plusieurs dizaines d’années, les réformes successives du financement de la Sécurité sociale, en vue de faire face à l’augmentation des dépenses, ont généralement consisté à majorer les taux de cotisations ou à rogner sur les diverses prestations ou avantages servis.
Si le système de cotisations sur salaires a relativement bien fonctionné pendant les « Trente Glorieuses », il a atteint aujourd’hui ses limites. Il devient urgent d’engager une véritable réforme du mode de financement du régime général, comme d’ailleurs de l’ensemble des autres régimes, en faisant appel dorénavant à la solidarité nationale pour financer toutes les prestations universelles.
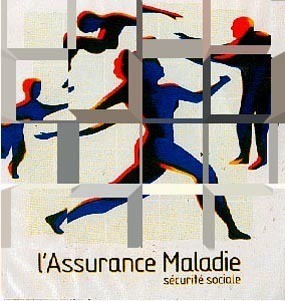
Depuis de très nombreuses années, les réformes de
l’assurance maladie ont conduit à des baisses répétées des taux de
remboursement, voire même au déremboursement complet de nombreux médicaments ou
à la création de divers « forfaits », à la charge de chaque patient.
Depuis un décret de juillet 2006 notamment, alors que
l’assurance maladie prenait totalement en charge tous les actes médicaux dits
"lourds", une participation de l’assuré de 18 euros est maintenant
prévue pour les actes suivants :
- Tous les actes affectés à la nomenclature générale des
actes professionnels d’un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d’un tarif égal
ou supérieur à 91 € ;
- L’ensemble des frais intervenant pendant une période
d’hospitalisation inférieure à 31 jours consécutifs au cours de laquelle est
effectué un acte thérapeutique ou diagnostique affecté du même coefficient ou
au même tarif que visés ci-dessus ainsi que pour les frais intervenant au cours
d’une hospitalisation consécutive à cette première hospitalisation et en lien
direct avec elle.
Ce forfait s’ajoute à ceux déjà existants comme le forfait
de séjour hospitalier, la retenue d’un euro par feuille des soins, le
dépassement d’honoraires non remboursable ou encore le nouveau projet de
forfait annuel des dépenses personnelles d’assurance maladie.
En ce qui concerne la branche vieillesse, les réformes des
retraites Balladur en 1993 et Fillon en 2003, ont conduit à une baisse sensible
du montant des pensions en modifiant principalement, pour l’une le nombre d’années
de référence pour le calcul de la pension (des dix meilleures années aux vingt-cinq
meilleures), et pour l’autre le nombre d’années pour avoir une pension au taux
plein (de 37,5 années à quarante années puis quarante et un et quarante-deux années).
Malgré toutes ces mesures, le déficit du régime général de
la Sécurité sociale s’élevait fin 2006 à 9,7 milliards d’euros, répartis de la façon
suivante par branche :
- Maladie : 6 milliards €
- Vieillesse : 2,4 milliards €
- Famille : 1,3 milliard €
Pour faire face à ce déficit chronique, Michel Rocard avait
en son temps créé la CSG et une assiette de cotisations un peu plus large,
mettant à contribution l’ensemble des revenus des personnes physiques (revenus
salariaux, revenus de remplacement, revenus financiers).
Mais la CSG repose encore fortement sur les salaires et
reste un prélèvement « proportionnel », donc injuste parce que ne taxant pas les
foyers fiscaux selon leur faculté contributive, comme peut le faire l’impôt
progressif sur les revenus. De plus, la part des salaires dans la richesse produite
chaque année a baissé de 10 points ces trente dernières années, ce qui accentue
encore un peu plus les problèmes de financement.
Les différentes prestations maladie ou familiales étant
accessibles à tous les citoyens, salariés ou pas, le principe de solidarité
nationale exigerait que soit mis à contribution l’ensemble des revenus des
personnes physiques et que l’actuelle CSG soit fusionnée avec l’impôt
progressif sur le revenu. Cela s’inscrirait dans une autre logique de
financement à la fois plus juste et plus conséquent et présenterait en outre
plusieurs avantages :
- La création d’un impôt citoyen sur le revenu simplifié et
lisible, destiné à financer les prestations universelles selon la faculté
contributive de chacun et faisant appel à la progressivité de l’impôt ;
- Un traitement identique pour tous les citoyens, quel que
soit le statut de chacun : actifs, retraités, salariés du secteur privé,
fonctionnaires, artisans, commerçants, professions libérales, chefs
d’entreprises, etc. ;
- Une augmentation sensible du salaire net par l’arrêt de la
hausse des taux de cotisations ;
- le règlement du problème du déficit du régime général et
des autres régimes.
Dans le cas particulier de la branche vieillesse, il semble
toutefois difficile d’abandonner totalement les cotisations sur salaires car la
retraite est basée avant tout sur le salaire perçu. Aux cotisations sur
salaires actuelles pourrait donc venir se greffer une partie de ce nouveau
financement. Un tel financement mixte existe déjà plus ou moins pour les
régimes spéciaux de retraite, notamment ceux des gaziers, cheminots, agents de
la RATP, financés à plus de 60% par des subventions de l’Etat.
Les cotisations patronales
Le problème de l’étroitesse de l’assiette salariale se pose
également pour les cotisations des entreprises, dites cotisations patronales.
C’est ainsi que les entreprises à fort taux de main-d’œuvre, avec une forte
masse salariale mais une faible valeur ajoutée, se trouvent pénalisées par
rapport à celles ayant une faible masse salariale mais une haute valeur
ajoutée.
Le remplacement des cotisations patronales par une
contribution sur la valeur ajoutée serait la mesure la plus appropriée et
équivaudrait à la création d’une « CSG entreprise ». Cette proposition fut
explorée à plusieurs reprises au travers de divers rapports commandés, par le
passé, aussi bien par Alain Juppé que par Lionel Jospin, Premiers ministres.
Un tel changement d’assiette des cotisations patronales
serait une véritable révolution. Il reviendrait pour la première fois à inclure
les profits d’exploitation des entreprises dans l’assiette de financement de la
Sécurité sociale, notamment les entreprises ayant « ajusté à la baisse » leur
masse salariale, notamment à l’occasion de restructurations ou délocalisations.
La « CSG entreprise » aurait également des effets bénéfiques
sur l’emploi des PME, souvent étranglées par les contraintes imposées par les
« donneurs d’ordre ».
Plusieurs syndicats sont, pour cette raison, favorables à
cette nouvelle assiette qui serait de surcroît beaucoup plus stable que
l’assiette salaire. Il n’est pas anodin que la confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME) et l’Union patronale artisanale (UPA) y
soient particulièrement favorables, à la différence du MEDEF.
La CSG entreprise serait aussi facile à mettre en place.
Elle existe en effet déjà en germe dans l’actuelle contribution sociale de
solidarité sur les sociétés (C3S), assise sur la valeur ajoutée, mais dont le
taux est très faible. Pour réaliser le basculement total des cotisations
patronales vers cette CSG entreprise, il suffirait de supprimer les cotisations
patronales et leur substituer une C3S dont le taux serait à peu près multiplié
par quarante par rapport à son taux actuel.
Les exonérations de charges concernant les employeurs
Une réforme en profondeur du financement de la Sécurité
sociale ne peut ignorer également le problème des exonérations de charges
accordées indistinctement aux entreprises. Ces baisses de charges qui coûtent
plus de 20 milliards d’euros, chaque année au budget de l’Etat, n’ont jamais
suscité les créations d’emplois annoncées.
La situation financière des entreprises est cependant
hétérogène et une réforme des cotisations patronales devrait par conséquent
favoriser exclusivement les entreprises fortement créatrices d’emplois et ne
délocalisant pas.
La dette de l’Etat
Dans une note de janvier 2007, l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale (Acoss), indiquait que la dette de l’Etat, vis-à-vis du seul régime général, aurait atteint 5,9 milliards d’euros à la fin 2006,
soit un milliard d’euros de plus qu’un an auparavant, cette nouvelle
augmentation étant liée principalement à :
- Des exonérations de cotisations que l’Etat s’était engagé
à prendre à sa charge : contrats d’apprentissage et de professionnalisation,
exonérations dans les DOM, etc. (700 millions €) ;
- Des prestations sociales versées pour le compte ou prises
en charge par l’Etat sans que les budgets votés suffisent à couvrir la dépense
(400 millions en 2006 pour l’AME et l’API).
Particularité de la France dans ce domaine comme dans
beaucoup d’autres, cette dette n’apparaît ni dans le déficit budgétaire (les
sommes n’étant pas effectivement versées par l’Etat), ni dans le déficit de la
Sécurité sociale (qui, elle, intègre ses créances dans ses comptes). Les coûts
de trésorerie associés à la dette ont de plus représenté 160 millions d’euros
en 2006 !
Aujourd’hui, une vraie réforme du mode de financement de la Sécurité sociale suppose d’en finir avec les « réformettes » à courte vue et
exige de considérer que les cotisations assises sur les salaires ne permettent
plus à elles seules de faire face aux besoins des différentes branches,
maladie, famille et vieillesse.
Mais, c’est avant tout un « choix de société » qu’il convient
de faire, encore faut-il en avoir la volonté politique en décidant de faire
appel dorénavant à la solidarité nationale et donc à l’impôt plutôt qu’à une
nouvelle ponction sur les seuls salaires et/ou à une baisse du montant des
prestations.
Faute d’une répartition plus juste du financement, ce serait
encore sur les ménages et les revenus du travail que pèserait le fardeau de la
solidarité...
Ces propositions sont inspirées en partie par M. Liem Hoang-Ngoc, professeur à l’université Paris-I
18 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










