Quand la misère chasse la pauvreté
C’est le titre du livre[1] écrit par Majid Rahnema, ancien diplomate et ancien ministre iranien, qui se consacre depuis plus de vingt ans aux problèmes de la pauvreté.
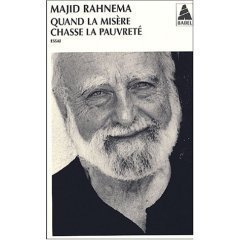
Une phrase du synopsis m’a interloqué : « La propagation généralisée de la misère et de l’indigence est un scandale évidemment inadmissible, surtout dans les sociétés parfaitement à même de l’éviter [...] Mais ce n’est pas en augmentant la puissance de la machine à créer des biens et des produits matériels que ce scandale prendra fin, car la machine mise en action à cet effet est la même qui fabrique systématiquement la misère. »
Pour deux raisons :
-
tout d’abord, étant Français éduqué et formé à l’école occidentale, de surcroît de formation commerciale, je suis de fait (le terme est significatif), "un pur produit du système". Je me souviens avoir entendu depuis toujours que le capitalisme est "le moins pire" des systèmes et le seul capable d’engendrer la richesse des peuples.
-
De plus le caractère provoquant de ces propos résulte du fait que le capitalisme s’est bâti il y a deux siècles sur le postulat suivant : « Les richesses engendrées vont éradiquer la pauvreté. »
Or si le capitalisme a permis pendant longtemps à l’Occident de prospérer et d’asseoir sa domination sur le reste du monde, il semblerait que depuis quelques années, il crée davantage de déséquilibres, et de misère, que de prospérité partagée, au Nord comme au Sud !
L’originalité de ce livre réside dans son approche, aux antipodes des critiques habituelles de l’économie de marché.
Ainsi la première partie intitulée « Archéologie de la pauvreté » est une ode à la pauvreté dans toute sa noblesse, d’un point de vue historique, culturel ou spirituel. On (re)découvre que la pauvreté est une composante majeure de l’histoire de l’humanité, toutes sociétés confondues, et que la misère de masse n’existait pas dans les sociétés archaïques et de subsistance.
La deuxième partie intitulée « La grande rupture : les misères modernes à l’assaut de la pauvreté » nous apprend que la société productiviste est créatrice de misère car :
-
elle génère de la rareté
-
elle détruit le lien social
-
elle stigmatise le pauvre et détruit son « temple intérieur »
Cette seconde partie aborde également la logique de l’aide au développement qui est la suite logique, et de fait biaisée, des conséquences négatives engendrées par la société productiviste, pour conclure sur la nécessité de la simplicité volontaire, ou d’une pauvreté réinventée...
Mais l’objet de cet article est d’insister sur un thème central qui apparaît comme le grand paradoxe de nos sociétés (dites) modernes :
Comment nos sociétés modernes génèrent-elles de la misère ?
Pour bien comprendre la difficulté d’admettre ce fait, il convient de remonter aux sources mêmes de l’ère industrielle. A cette époque, l’auteur nous dit : « Les perspectives ouvertes par la Révolution industrielle étaient si exaltantes que pendant longtemps, beaucoup ont cru avoir trouvé la solution à la plupart des problèmes de société. »
Et même si les intellectuels de l’époque se rendirent très vite compte de la paupérisation croissante que générait la "machine productiviste", l’économie productiviste fut d’emblée perçue à la fois par la droite et par la gauche comme « le couronnement de milliers d’années d’évolution du génie humain ».
L’économie moderne était (et elle l’est toujours) la réponse à la nécessité, et malgré quelques incidences négatives sur certaines couches de la population, toute critique sur le système productiviste était taxée de « romantisme irresponsable ».
L’auteur nous apprend que deux des prétentions majeures de ce système ont été acceptées sans réserve :
-
l’économie moderne est la science et l’art de transformer la rareté en abondance
-
elle seule apporte une réponse valable et réaliste à la question de la pauvreté
Deux mythes y sont également sous-jacents : le mythe de la rareté et le mythe de l’abondance.
Pourquoi la société productiviste est source de rareté
L’exemple des sociétés de subsistance
Dans les sociétés vernaculaires, la rareté n’existait pas, le monde créé étant source d’abondance. Il pouvait bien y avoir quelques mauvaises récoltes, mais lorsque c’était le cas, le déséquilibre était corrigé par un surplus d’ingéniosité, de vertu ou de solidarité.
Ces sociétés étaient conscientes que si une part de la rareté est matérielle, une autre part dépend de la perception qu’a chacun de ses besoins et de leur satisfaction. La rareté a historiquement permis à des sociétés de subsistance de bâtir des modèles d’autosuffisance, et d’ingéniosité, par exemple la sélection d’espèces le plus à même de produire sous des latitudes données. Enfin, même si certains besoins n’étaient pas satisfaits, en aucun cas ces manques ne devenaient intolérables.
Comment une société de l’abondance crée la rareté
L’auteur nous explique que toute l’ambiguïté du système productiviste réside dans le fait qu’il est une formidable machine à produire des biens en quantités, mais toujours plus, ce qui engendre l’impossibilité pour chacun d’accéder à tous les biens, et donc crée l’effet de rareté.
Le fait est que personne n’est vraiment responsable de cet état de fait, puisque la finalité de l’appareil de production est de produire, et de rationaliser : on rationalise les matières premières, les besoins, les ventes, la production...
De plus, chaque entité, organisme, société, institution, rationalise chacun de son côté, sans tenir compte des conséquences que cela peut générer, le système global formant un tout qui n’est pas maîtrisable. Enfin, chacun participe à ce système en tant que consommateur, par ses envies, l’insatisfaction permanente étant également propre à l’être humain...
Le problème de la faim dans le monde résulte de la même logique de rationalisation de la production à une échelle globale. Certains pays sont plus à même que d’autres de produire des cultures d’exportation en utilisant les semences et intrants de transnationales, au détriment de leurs cultures vivrières et de leur indépendance. Une fois ce système accepté par les dirigeants de ces pays, qui n’y perdent pas, eux, alors les populations se trouvent contraintes d’accepter ce système et ses dépendances.
Société de consommation et fabrication de la rareté
Aujourd’hui, dans nos sociétés modernes, les populations n’ont plus les moyens économiques, sociaux ou culturels de faire face aux nouveaux besoins créés. Elles sont d’une part dépossédées des moyens qui leur auraient permis de faire face, et d’autre part soumises à une intense propagande (publicitaire), génératrice de besoins et de dépendances. Ces besoins incessants sont une source permanente d’insatisfactions, de frustrations et de discorde sociale...
Dans les pays du Tiers monde, le prolongement de ce système productiviste s’est traduit, dans le meilleur des cas, par une logique de développement, les populations locales ayant l’espoir d’une vie meilleure, dans le pire des cas, par le fondamentalisme, qui se fonde sur son rejet de l’argent et de la corruption et sa focalisation religieuse.
Les ruptures et mutations engendrées par la société productiviste
La société a cessé d’être perçue comme un corps social constitué de membres : elle est devenue une somme d’individualités au service d’un vaste appareil de production.
D’autre part, dans la même logique « économiciste », la classe dominante a refusé de voir dans la pauvreté un problème autre qu’économique. Or l’auteur nous explique que le critère économique était un critère, mais pas moins grave que l’incapacité pour cette main-d’œuvre spécialisée et instrumentalisée d’exercer son métier d’origine ou son rôle dans la communauté. De plus, les pauvres se sont trouvés exclus de fait de cette société où tout bien, besoin et personne se mesurait à sa valeur financière.
Le sujet humain est devenu, au fur et à mesure que le système productiviste se développait, un élément du système, dont ses besoins créés puis satisfaits par l’appareil de production faisaient partie. Dans ce sens : « Besoins et consommation apparaissent comme une extension organisée des forces productives. »
Enfin la société productiviste a entraîné la marchandisation de l’humain, comme main-d’œuvre salariée, puis des valeurs, le terme lui-même ayant acquis une connotation marchande.
Comment la société productiviste génère la misère
L’auteur parle tout d’abord de pauvreté moderne, qui touche les laissés-pour-compte d’un système qui est parfaitement capable de satisfaire les besoins essentiels de l’ensemble des populations. De plus, personne n’est à l’abri de la pauvreté ou de la précarité.
Mais la vraie misère provient lorsque la personne concernée est affectée durablement dans « son temple intérieur » par les effets négatifs extérieurs, d’un point de vue physique ou moral.
Elle peut résulter de conséquences purement économiques sur sa santé par exemple, mais également des effets secondaires engendrés par nos sociétés productivistes : perte de confiance en soi, perte de repères, isolement, frustrations, perte de sens du fait de la perte du lien social...
Il insiste enfin sur le fait que bien que les discours de nos sociétés démocratiques prônent des droits égaux pour tous, les inégalités d’êtres humains réduits à de simples valeurs marchandes tendent à s’accroître toujours davantage. Nos sociétés tendent de fait vers toujours moins de démocratie, avec des hiérarchies toujours plus difficiles à combattre...
David Carayol
http://europemondi.hautetfort.com/
[1] Quand la misère chasse la pauvreté, Majid Rahnema, Fayard / Actes Sud, octobre 2004.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









