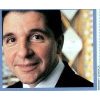Trés haut débit, pour quels nouveaux usages collectifs ?
Les annonces politiques en faveur des infrastructures très haut débit se succèdent. Mais les annonces pour mieux satisfaire, via Internet, les besoins d’éducation, de travail, de santé, de citoyenneté sont rares.
La plus riche des collectivités locales, le Conseil général des Hauts-de-Seine, prépare la création d’un réseau de fibres optiques jusqu’au domicile. La forte densité de ce département est un atout, car elle limite la longueur de fibres à déployer. De plus, les réseaux installés pour les entreprises rapprochent des particuliers. De son côté, le maire de Paris a annoncé le soutien à de nouveaux projets très haut débit. Est-ce utile, alors que les Parisiens bénéficient déjà du haut débit le plus étendu et le moins cher de France ?
La rentabilité de réseaux très haut débit n’est pas démontrée. Le raccordement d’un ménage urbain coûte 2000 euros. Pour maintenir la proportion vertueuse actuelle entre immobilisations et chiffres d’affaires, il faudrait qu’un ménage paie 700 euros par an à son opérateur ! Faute d’investisseur privé, la création de réseaux capillaires devient un enjeu d’aides publiques via les marchés de travaux publics. Le génie civil compte pour les deux tiers des investissements nécessaires. Les entreprises de génie civil, candidates à la création de réseaux très haut débit, n’y voient-elles pas un moyen de s’assurer l’exclusivité de marchés locaux, pour plusieurs années ?
C’est le développement des usages collectifs qui rentabiliserait sans subvention l’investissement en très haut débit. Mais les collectivités locales les plus riches ne sont pas les plus exemplaires. Ainsi, les services administratifs de la ville de Paris produisent à l’heure taylorienne. En 2005, le million de bulletins de paie, édités par la mairie chaque année, étaient vérifiés feuille par feuille par 40 personnes !
Les financements d’infrastructures haut débit qui ne sont pas accompagnés de nouveaux usages sont des gouffres. A Pau, Europe, région et ville ont dépensé 35 millions d’euros dans un réseau de fibre optique qui n’aurait séduit que 1000 utilisateurs. Le Conseil général du Rhône déplore que les communes et les écoles boudent son réseau construit pour 150 millions d’euros. En France, quelques services publics sont accessibles sur Internet mais sans l’ interactivité que permet le haut débit, et sans réorganisation de la production administrative. Combien de mairies, de commissariats de police, d’hôpitaux utilisent l’image, le son, la vidéo ? L’Etat et les élus locaux, pour la plupart, se satisfont de la dématérialisation de l’administration existante. Ils déclarent faire de la e-éducation en équipant les écoles en haut débit et de la e-santé avec la télémédecine. Les investissements en équipement sont décidés sans grand souci d’évaluation des usages des outils et avec de chiches moyens d’accompagnement. Le secteur associatif, aux moyens précaires, tente de combler le fossé numérique entre l’élite urbaine et les populations des quartiers et zones rurales écartés de l’accès à Internet.
Les innovations dans les télécommunications produisent des modes : mode du « portail » , de la « borne interactive », du haut débit, de la voix sur IP, de l’ADSL et aujourd’hui du THD (très haut débit). Ces modes réduisent la révolution numérique à la puissance des réseaux et à leur financement.
La course au très haut débit éloigne de l’humain qui devrait être le premier horizon de l’utilisation d’Internet haut débit dans le secteur public.
La leçon des grands projets fondés sur des technologies nouvelles et des montagnes d’aides publiques devrait servir au développement de la société de l’information : pas d’infrastructure sans usage ! Pas d’investissements matériels sans changement de l’organisation ! Pas d’équipement public innovant, sans réorganisation des services. Les grands succès sur Internet, du peer to peer aux blogs, prouvent qu’il n’y a pas de réseaux numériques sans réseaux humains.
Les usages nouveaux permis par le DSL sont loin d’avoir été explorés pour permettre à tout un chacun de devenir davantage acteur de sa formation, de sa santé, des décisions locales, de sa consommation.
Les usages marchands sont porteurs de l’effet de réseaux qui financera partiellement l’implantation du très haut débit. Ne revient-il pas à la sphère publique d’impulser la réinvention des services d’éducation, de mobilité, de travail, de santé, de famille, de citoyenneté ? La révolution numérique est aussi dans les usages collectifs !
Avec le concours de Florence Durand- Tornare, fondatrice de l’association Villes-internet
3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON