Vers un nouveau capitalisme
C’est le titre du dernier livre de Muhammad Yunus, l’inventeur du micro-crédit et Prix Nobel de la Paix 2006. Il y aurait beaucoup à dire sur cet ouvrage riche et foisonnant, qui est à la fois un plaidoyer ambitieux et convaincant pour le développement des « social business », mais aussi une sorte de point d’étape d’une aventure collective exceptionnelle. J’en propose ici une lecture personnelle, mettant en relief les éléments m’ayant plus particulièrement intéressé.
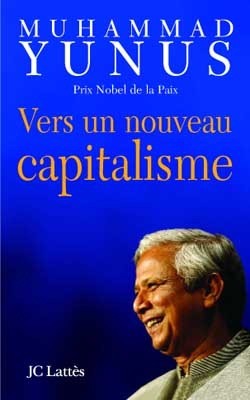
M. Yunus est un ardent défenseur du capitalisme et du marché : il y voit une source de dynamisme, d’efficacité, de liberté, de créativité, d’innovation pouvant permettre aux pauvres de se réapproprier leur destin et de développer leur niveau de vie et celui de leurs familles.
Mais il est en même temps très lucide sur les conséquences sociales et écologiques du système économique actuel : aggravation des inégalités, périls écologiques (le Bangladesh est gravement menacé par la montée des eaux dûe au réchauffement climatique), exclusion sociale au Sud comme au Nord,...
Il se prononce donc assez classiquement pour un libéralisme régulé, mais il formule aussi une critique très intéressante de la logique actuelle de fonctionnement du capitalisme : « Le capitalisme a une vue étroite de la nature humaine : il suppose que les hommes sont des êtres unidimensionnels qui recherchent exclusivement la maximisation du profit. (...) La théorie du libre marché souffre d’une défaillance de conceptualisation, d’une incapacité à saisir l’essence même de l’humain. (...)
Notre théorie économique a créé un monde unidimensionnel peuplé par ceux qui se consacrent au jeu de la concurrence et pour qui la victoire ne se mesure qu’à l’aune du profit. Et comme cette théorie nous a convaincus que la recherche du profit constituait le meilleur moyen d’apporter le bonheur à l’espèce humaine, nous imitons avec enthousiasme la théorie en nous efforçant de nous transformer en êtres unidimensionnels. Et le monde d’aujourd’hui est si fasciné par le succès du capitalisme qu’il n’ose pas mettre en doute le système sous-jacent à la théorie économique. La réalité est néanmoins très différente de la théorie. Les individus ne sont pas des entités unidimensionnelles ; ils sont passionnément multidimensionnels. Leurs émotions, leurs croyances, leurs priorités, leurs motifs peuvent être comparés aux millions de nuances que sont susceptibles de produire les trois couleurs primaires. (...)
Le succès de la Grameen Bank s’est appuyé sur la volonté de reconnaître et d’honorer les motivations dépassant le cadre économique. Les être humains ne sont pas simplement des travailleurs, des consommateurs, ou même des entrepreneurs. Ce sont aussi des parents, des enfants, des amis, des voisins et des citoyens. Ils s’inquiètent pour leur famille. Ils se soucient de leur communauté. Ils se préoccupent beaucoup de leur réputation et de leurs relations avec les autres. Pour les banquiers classiques, ces questions humaines n’existent pas. Mais elles sont au cœur de ce qu’entreprend la Grameen Bank. »
Rappelons qu’à la base, M. Yunus est un professeur d’économie qui, dans les années 70, n’en pouvait plus d’enseigner d’élégantes théories économiques alors que la pauvreté et la famine ravageaient son pays...
La vision de Yunus de la pauvreté est aussi logiquement multidimensionnelle et ne se limite pas à une vision strictement économique. Pour définir la pauvreté, la Grameen Bank (GB) a établi une liste de 12 critères qui portent sur le niveau de revenu mais aussi sur les conditions de logement, d’alimentation, d’éducation ou de santé.
Yunus dénonce également quelques autres « angles morts » de la théorie économique orthodoxe comme les hypothèses de rareté de la capacité d’entreprendre ou encore de non-différentiation entre hommes et femmes (les femmes jouent un rôle primordial dans la GB).
Ainsi, pour Yunus le capitalisme tel qu’il fonctionne aujourd’hui ne sait absolument pas répondre aux problèmes sociaux et écologiques actuels, et les instruments existants (pouvoirs publics, institutions internationales comme la Banque Mondiale, action caritative et humanitaire) sont utiles mais ont montré leurs limites.
Mais il ne jette pas le bébé capitaliste avec l’eau du bain des entreprises... Il propose au contraire d’utiliser les vertus du marché (efficacité, dynamisme, innovation, développement...) pour l’appliquer à la résolution des problèmes sociaux et écologiques persistants. C’est ce qu’il appelle les « social business ».
Développer les social business
M. Yunus définit les « social business » (SB) comme des entreprises ayant des objectifs sociaux ou écologiques. Il en distingue deux types :
Celles qui appartiennent à des investisseurs ou propriétaires, mais à qui elles ne reversent rien au-delà du remboursement de leur mise initiale (pas de dividendes). Les profits sont réinvestis dans le projet. Les investisseurs sont donc ici motivés par l’impact social non par la maximisation du profit.
C’est le cas par exemple de Grameen Danone, joint-venture montée entre les deux entreprises pour « réduire la pauvreté grâce à un modèle économique de proximité permettant d’apporter quotidiennement des éléments nutritifs aux pauvres »1.
Celles qui appartiennent aux pauvres, à qui elles s’adressent. Le bénéfice social vient ici du mode d’appartenance. Les dividendes peuvent être versés aux propriétaires (les pauvres).
La GB en est un exemple. Dans le livre, M. Yunus retrace aussi l’incroyable histoire de cette entreprise, née il y a près de trente ans dans le village de Jobra et à l’origine du « micro-crédit » qui touche aujourd’hui plus de 100 millions de personnes dans le monde2.
Les deux peuvent se combiner. A partir de l’expérience de la GB, Yunus et ses équipes ont lancé plus de vingt nouvelles SB (dont certaines sont décrites dans le livre), dans des domaines très variés : élevage de poissons et de bétail, agriculture, alimentation, santé, éducation, textile, énergies renouvelables, finance, high-tech, télécom, Internet... avec à chaque fois un impact social significatif.
Le SB fonctionne comme une entreprise classique : il a des produits, des services, des marchés, des charges et des recettes. Mais le principe de maximisation du profit est remplacé par celui de maximisation du bénéfice social.
Pour Yunus, Les SB permettent de combler les carences des outils existants (qui demeurent selon lui indispensables dans certains contextes) : apporter de l’efficacité et de la flexibilité là où la puissance publique pêche par bureaucratie ou par inertie ; apporter de la pérennité et de l’autonomie là ou les ONG sont souvent dépendantes de leurs financeurs et sont fragilisées ; apporter du réalisme et de l’innovation là où les institutions internationales sont enfermées dans des grilles de lecture inadaptées et dans le conformisme à la doxa dominante.
Les SB ne pourront pas se développer sans un environnement favorable. Pour Yunus, cela nécessite la mobilisation complémentaire de différents types d’acteurs.
Les pouvoirs publics peuvent y contribuer par une définition claire et stricte de ce qui est (ou n’est pas) SB, pour permettre une reconnaissance institutionnelle et éviter les abus, dérives et récupérations. Ils peuvent également créer des avantages fiscaux spécifiques aux SB ainsi que des exonérations fiscales pour ceux qui investissent dans les SB.
M. Yunus appelle également de ses vœux la création d’un véritable écosystème économique des SB : avec un « Social Wall Street Journal », un « Dow Jones Social », une bourse sociale, des fonds d’investissement et autres outils de financements dédiés ; des comptabilités, indicateurs, évaluations, contrôles, certifications spécifiques... Bref, tout ce que l’on trouve dans le business « classique », à la différence majeure que la mesure de la réussite n’est pas la maximisation du profit mais celle du bénéfice social.
Et en France, alors ?
Un regret : Yunus présente les SB comme une nouveauté et se focalise sur les expériences Grameen alors qu’elles existent depuis longtemps dans beaucoup de pays d’Europe et d’Amérique (Nord ou Sud). Il parle très brièvement du mouvement coopératif à qui il reproche de trop se concentrer sur l’intérêt collectif des membres de la coopérative et pas sur l’intérêt général ou celui des pauvres.
En France, l’idée des SB renvoie aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. On retrouve d’ailleurs les deux types de SB décrits par Yunus : celles qui ont un objectif social et ne reversent pas ou peu de dividendes (entreprises associatives d’utilité sociale, entreprises d’insertion, entreprises adaptées...), celles qui appartiennent à leurs clients (mutuelles, coopératives de consommateurs, et de manière un peu différente, les Scic), même si il est vrai que leurs clients ne sont pas spécifiquement pauvres.
Les exonérations fiscales souhaitées par Yunus existent en France pour les personnes soumises à l’ISF qui investissent dans des entreprises d’insertion.
Yunus met aussi en avant un modèle économique de péréquation (prix de marché pour les personnes aisées, prix bas pour les pauvres), qui est au cœur de nombreuses entreprises de l’économie sociale (par exemple dans le tourisme associatif).
On pourrait continuer la liste des similarités. Il y a bien sûr des différences : le dividende n’est généralement pas nul (lorsqu’il s’agit d’entreprises de type SA, SARL) mais il est limité et plafonné. Les modèles économiques des entreprises sociales intègrent aussi souvent une part plus ou moins forte de subventions publiques, mais ce point est à nuancer, car ces « subventions », sont en fait des prestations déguisées.
Elles pourraient en effet très bien prendre la forme d’un contrat pour un service rendu. Par exemple, dans une entreprise d’insertion dont le modèle économique est composé à 80 % de vente de biens et services et à 20 % d’aides au poste, ces 20 % pourraient être transformés en une prestation vendue aux pouvoirs publics au titre de la lutte contre l’exclusion. Une réflexion est d’ailleurs engagée au ce sens (évolution vers une offre de services) au niveau des pouvoirs publics en lien avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique.
Une vision ambiguë de la « maximisation des profits »
M. Yunus a une lecture critique de la RSE (responsabilité sociale des entreprises). Pour lui, la mission des entreprises « classiques » étant de maximiser leur profit, la RSE est au mieux mineur (marginale) au pire cosmétique : la recherche du profit maximum ne peut être combinée avec la recherche de bénéfices sociaux ou écologiques maximum.
Il ne croît pas aux solutions hybrides : « Dans le monde réel, il sera très difficile de gérer des entreprises ayant des objectifs conflictuels. Les dirigeants de ces entreprises hybrides glisseront progressivement vers l’objectif de maximisation du profit, quel que soit la manière dont la mission de l’entreprise aura été conçue. (...) Sur quelle base sera-t-il jugé : celle de l’argent qu’il fait gagner aux investisseurs ou celle de l’objectif social qu’il remplit ? Pour compliquer les choses, l’environnement actuel des affaires est concentré sur la maximisation du profit. Toutes les techniques de gestion ont été conçues dans cet esprit. (...) Cela signifie que les objectifs sociaux poursuivis par les dirigeants seront mis de côté lorsqu’ils entreront en conflit avec l’objectif de maximisation du profit ».
En effet, on ne peut a priori que lui donner raison. Mais, ce constat peut être nuancé, voire contesté à deux niveaux.
D’abord, M. Yunus profite grandement des stratégies de RSE. Son partenariat avec Danone (et plus récemment avec Veolia) s’inscrit bien dans ce cadre. Qui plus est, la multiplication des partenariats avec les multinationales (donc le cadre de leur politique de RSE) est une des voies qu’il préconise pour développer les SB. Il propose aussi, concernant la mesure de l’impact social, de s’appuyer sur les travaux issus de la RSE, comme ceux de la GRI (Global Reporting Initiative).
Ainsi, même dans un système mu uniquement par la logique du profit maximum, la RSE créé des marges de manœuvre non négligeables pour le développement des SB.
Ensuite, l’idée que les entreprises « classiques » doivent maximiser leur profit à tout prix est certes une réalité très actuelle, mais pas une loi immuable, tombée du ciel ou d’ordre divin. Elle résulte de choix politiques nationaux et internationaux, opérés de manière volontaire, depuis les années 70.
Et sur ce point, M. Yunus est ambigü et même contradictoire : pendant la majeure partie du livre, il ne trouve rien à redire à ce comportement qu’il voit comme une donnée exogène, invariante et incontestable : « Si vous êtes une entreprise maximisant son profit, votre travail est de gagner de l’argent et nul ne vous reprochera de ne pas vous soucier d’objectifs sociaux. »
Mais vers la fin, son discours change et il dresse un véritable réquisitoire contre la maximisation du profit : « Les entreprises des pays développés maximisent leurs profits, les ressources sont gaspillées, l’environnement est pillé et les générations futures doivent s’attendre à un avenir morose. A mesure que la philosophie capitaliste se répand, les nations en développement connaissent une croissance de leurs propres classes d’hommes d’affaires qui s’emploient à maximiser leurs profits, tout comme le font leurs modèles d’Amérique du Nord et d’Europe. Il en résulte que des centaines de milliers de personnes sont malades et meurent prématurément à cause de la pollution, et que le problème du changement climatique s’approche rapidement du point de non-retour. (...) Lorsque le profit est la seule priorité, nous oublions l’environnement, la santé publique et la soutenabilité de la croissance. Une seule question nous semble légitime : comment acheter et vendre plus de biens et comment réaliser un taux de profit supérieur à celui de l’année dernière ? Que ces biens soient vraiment nécessaires et bénéfiques aux individus est considéré comme hors de propos. »
Mon sentiment, à la lecture de l’ouvrage, est que M. Yunus parie qu’un développement significatif des SB va par contagion modifier la vision de l’entreprise « classique » et la décentrer d’une vision monodimensionnelle centrée sur le profit. Le développement des ES pourrait ainsi amener les entreprises (et le système économique) à reconsidérer leur rapport au profit, et à remettre en cause le dogme de la recherche permanente du profit maximum.
La foi en l’Homme
Ce qui est admirable chez Yunus, c’est son inclinaison constante, et même son obsession, à toujours chercher à révéler et exprimer le meilleur des gens, qu’ils soient pauvres, riches, grandes entreprises, pouvoirs publics, banquiers... et qui plus est, à l’exprimer de manière concrète, dans l’action, dans l’initiative, dans la création. M. Yunus croit en l’Homme et le prouve !
« L’un des traits les plus solidement ancrés chez les êtres humains consiste à vouloir faire du bien à d’autres gens. C’est un aspect de la nature humaine que le monde des affaires ignore complètement. Le social-business satisfait cette aspiration : c’est ce que les gens trouvent enthousiasmant ».
Ce regard humaniste est particulièrement affirmé quand il est porté sur les pauvres : « Je vois les pauvres comme des bonsaïs. Quand on plante les meilleures semences du plus grand des arbres dans un pot de quinze centimètres de profondeur, on obtient une réplique parfaite de cet arbre - mais elle n’est haute que de quelques centimètres. Il n’y a rien de mauvais dans les semences : c’est le sol dans lequel elles ont été plantées qui pose problème.
Les pauvres sont des hommes-bonsaïs. Rien dans leur origine ne pose problème. Mais la société ne leur a jamais donné ce dont ils avaient besoin pour grandir. Pour sortir de la pauvreté, les pauvres n’ont besoin que d’un environnement favorable. Lorsqu’ils seront autorisés à libérer leur énergie et leur créativité, la pauvreté disparaîtra très vite. (...)Le micro-crédit allume le moteur économique des individus rejetés par la société. »
Changer les représentations
Pour finir, une question en forme de boutade : Yunus est-il de droite ou de gauche ? Cette question n’est jamais abordée dans le livre. On pourrait dire qu’il est de gauche pour la volonté de transformation sociale et la volonté d’impliquer constamment les personnes (démocratie participative...). On pourrait aussi dire qu’il est de droite pour son souci de développer la responsabilité et l’initiative personnelle ainsi que pour son goût du marché et du capitalisme.
Bien évidemment, il transcende totalement ce clivage... Son action est universelle. Le combat fondamental de Yunus est un combat sur les représentations et les grilles de lecture : « L’esprit humain est le vrai champ de bataille sur lequel nous devrions nous concentrer ».
M. Yunus et ses équipes transforment la vision sur les pauvres : les pauvres ne sont plus pauvres « parce qu’ils ne savent rien faire » mais parce qu’on ne leur a pas donné les moyens de libérer leur potentiel, de révéler leur créativité. Ils transforment la vision du crédit (proposé sans garantie à la GB). Ils transforment la vision de l’aide au développement. Ils transforment la vision du marché et de l’entreprise qui peuvent être des outils puissants et efficaces au service du progrès humain. Ils transforment notre vision du Bangladesh. Ils transforment le Bangladesh.
Yunus est à la fois un profond réformiste et un ardent révolutionnaire. Ce qui le rend exceptionnel. Il y a aussi quelque chose de réconfortant à constater qu’un des mouvements les plus importants de régénération du capitalisme vient d’un des pays le plus pauvre et le plus en difficulté du monde...
Notes
(1) Le premier produit commercialisé est Shokti Doi (« le yaourt pour être fort »), yaourt destiné aux enfants pauvres des villages, spécialement conçu pour améliorer leur santé et pour être économiquement accessible. Le modèle de production et de distribution de Grameen Danone cherche à impliquer les populations locales en amont (fermiers locaux), dans la production (emplois dans l’usine locale) et en aval (distribution par les « Grameen Ladies »). Yunus raconte dans le détail cette « success story », de la première rencontre avec Franck Riboud, PDG de Danone à l’ouverture de l’usine avec Zidane comme invité d’honneur.
(2) La Grameen Bank appartient à 94 % à ses emprunteurs, accorde des prêts à 7 millions de pauvres dont 97 % de femmes dans 78 000 villages du Bangladesh. Le taux de remboursement est de 98,6 % et 64 % de ceux qui ont emprunté à GB pendant au moins cinq ans ont dépassé le seuil de pauvreté... Depuis sa création, la GB a accordé un montant cumulé de 6 milliards de $ en prêt. Elle n’a plus recours aux dons depuis 1994.
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









