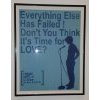De la France à l’Europe : les enjeux de la Défense
La puissance n'est pas qu'une question de mégatonnes mais plutôt d'excédents de trésorerie qui confèrent des marges de manoeuvre politiques à ceux qui les détiennent, états, organisations ou groupes. Dans ce contexte, sur fond de compétition pour l'appropriation des matières premières, la défense de la France ne peut se concevoir en dehors d'un cadre européen et le facteur militaire doit être remis à sa juste place pour éviter les aventures coûteuses qui ont marqué la période écoulée depuis la fin de la guerre froide.
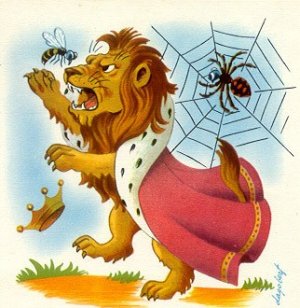
La fameuse boutade de Clémenceau « La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires » prend un relief tout particulier à l’aulne des conflits récents, qu’il s’agisse de l’Irak, l’Afghanistan, la Libye ou la Syrie. Les enseignements de ces conflits, et en particulier du conflit libyen, apportent des éléments qui soulèvent d'ores et déjà des interrogations et qui permettront, dans un deuxième temps, d’alimenter les réflexions et de définir les stratégies des décennies à venir, lorsque les données auront été triées, les variables mises en équation et les conclusions conceptualisées. C’est un travail de longue haleine qui pourra être mené à la condition qu’une ressource suffisante y soit consacrée tant par les états-majors que par la société civile. La pause opérationnelle qui se profile, avec le retrait d’Afghanistan, devrait permettre aux militaires de s’y consacrer. Reste à savoir si la société civile prendra sa part des travaux.
La période qui a suivi la fin de la guerre froide, et dans laquelle nous sommes actuellement, est une période ambigüe parce que la puissance ne se mesure désormais plus uniquement en mégatonne et parce que les attributs de la puissance sont plus variés qu’ils ne l’ont jamais été. Une organisation terroriste planétaire a pu s’attaquer aux USA, des agences de notations ont mis la Grèce à genou, des attaques informatiques ont paralysé une usine d’enrichissement de l’uranium en Iran... Sur le plan militaire, la réflexion doctrinale est restée dominée par le postulat plein de bon sens qu’une bataille se gagne sur le terrain, comment pourrait-il en être autrement ? L’infanterie y gagna certaines de ses lettres de noblesse, tout au moins sur le plan théorique car dans les faits, les résultats n’ont jamais été à la hauteur des espérances. La doctrine COINS (« counter-insurgency ») et ses avatars qui consistent principalement à tenir le terrain, le quadriller, patrouiller, se sont révélés extrêmement coûteux et au final peu probants. Les militaires peuvent légitimement se plaindre de l’inconstance des politiques qui ne savent pas s’engager sur le long terme et les politiques peuvent tout aussi bien s’émouvoir des coûts pharaoniques des plans de batailles concoctés par les militaires. Ainsi, pour un coût initial estimé par les planificateurs militaires à 60 milliards de dollar, la guerre d’Irak aurait coûté, en 2008, 3.000 milliards de dollars. Pourquoi une telle dérive ? Pour le comprendre, il faut étudier le déroulement d’une intervention.
Schématiquement, une intervention peut être décomposée en trois phases :
- Une première phase qui correspond à la situation intenable à laquelle il convient de mettre un terme. Il peut s’agir de renverser un dictateur, de remplacer un gouvernement qui soutient le terrorisme, de mettre fin à une guerre civile, de défendre un groupe ethnique, de maintenir l’accès à certaines ressources ou d’intervenir pour toutes ces raisons à la fois. La puissance qui entend modifier la situation rassemble ses alliés naturels ou contraints, recherche l’aval du conseil de sécurité de l’ONU et prépare l’action proprement dite. L’obtention d’une décision du conseil est souvent un obstacle à toute intervention. Ceux qui étaient déjà nés se souviennent certainement de sa résolution 84 condamnant l’offensive de la Corée du Nord contre la Corée du Sud en 1950 et ouvrant la voie à une action occidentale. Les autres, comme moi, auront certainement appris à l’école que cette résolution n’aura été possible que parce que l’URSS pratiquait la politique de la chaise vide en pensant que cela valait usage de son droit de véto. Avec 10 pays membres dont 5 permanents dotés d’un droit de véto, le conseil de sécurité est souvent paralysé par des intérêts divergents et ses résolutions sont parfois adoptées … par malentendu comme le montre cet exemple. Bien sûr, il est toujours possible de « guerroyer » sans résolution. Ce fut le cas en 2003 lors de l’invasion de l’Irak par les Etats Unis, lorsque la France menaça d’utiliser son veto. Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU, déclara cette guerre illégale mais le fait que les américains la considéraient comme légitime suffisait pour que d’autres pays leur emboitent le pas. On retrouve dans ce comportement l’un des principes immanents à l’âme américaines, défendus en son temps par Abraham LINCOLN lorsqu’il écrivit : << Des mesures non constitutionnelles peuvent devenir légitimes quand elles sont indispensables >>. Plus prosaïquement, cette invasion montre également que l’hyperpuissance a tous les droits tant que personne n’est assez fort pour s’y opposer.
- La deuxième phase est l’intervention proprement dite. Elle comprend normalement, mais ce n’est pas obligatoire, une phase militaire. Il s’agit, par l’application de forces de toutes natures (diplomatiques, culturelles, médiatiques, financières, militaires…), de modifier une situation. Les militaires ont élaboré toute une méthodologie sur l’emploi de la force. La métaphore avec la mécanique de Newton permet de bien comprendre leur procédé : il s’agit de trouver un centre de gravité sur lequel toutes les forces se concentreront pour modifier les équilibres et basculer vers une nouvelle situation, l’état final recherché. Ecrit de la sorte, cela ne signifie pas grand-chose mais le procédé a au moins le mérite d’exister et de permettre à des officiers provenant d’horizons très différents de coopérer pour élaborer un plan de bataille. Toutefois, le principal problème des militaires a souvent été de ne voir qu’une partie de l’objectif, renverser l’ennemi, oubliant au passage qu’il convenait de remplacer le système en place par un autre. Ainsi, les américains démantelèrent-ils l’armée de Saddam Hussein après leur victoire lors de la seconde guerre d’Irak, laissant un vide sécuritaire qui profita largement aux mouvances déstabilisatrices. Emploi modéré, au plus juste, de la force militaire et concentration des efforts sur les vulnérabilités de l’adversaire pour obtenir au plus vite un basculement de situation, permettant de recréer un nouvel équilibre souhaité, telle devait être la ligne directrice d’une intervention. Dans la pratique, cette belle théorie résiste rarement aux faits car la réalité est trop complexe pour le modèle et certaines vulnérabilités ne peuvent tout simplement pas être frappées à une position précise ou sur un lapse de temps réduit. Le soutien d’un peuple à une guérilla, par exemple, est une vulnérabilité qui exige une action sur le très long terme pour être exploitée.
- La troisième phase est celle de la transition. Pour prendre une métaphore pastorale, après avoir éliminé les mauvaises herbes, labouré le champ, mis de l’engrais et planté la petite graine, il s’agit ici de confier sa protection et son entretien à un groupe digne de confiance. Mais cette phase se prépare en amont : il est essentiel lors de la première et deuxième phase de ce souvenir des exigences de la troisième car l’une des situations habituelles, in fine, est de se retrouver sans aucune force locale capable de prendre le relai. La guerre peut générer un vide ou une impasse (a « stalemate »), à l’instar de ce qui s’est passé en Afghanistan où aucun groupe « acceptable » n’est capable de prendre le relai de la coalition occidentale. A l’inverse, cette situation a pu être évitée en Libye parce que les forces d’opposition à Kadhafi ont combattu sur le terrain et y ont acquis légitimité et force. Les « coups de pouce » de l’OTAN ont suffi à lui donner l’avantage sans pour autant dévaloriser son action par une implication trop voyante, ce qui fut le gage d’une phase de transition harmonieuse.
Cette introduction un peu longue des différentes phases d’une intervention était néanmoins nécessaire pour bien comprendre les enseignements des conflits actuels. Sauf dans de rares cas, cette chronologie des interventions qui peut être qualifiée de « classique », ne dépasse pas la première phase. Comme écrit précédemment, les droits de veto au conseil de sécurité sont détenus par des pays qui ont le plus souvent des intérêts divergents. Lorsque la phase deux est atteinte, il est encore plus rare que les efforts puissent être maintenus au bon niveau jusqu’à l’obtention des résultats escomptés. Certains officiers qui ont été déployés en Afghanistan affirment qu’avec 100.000, 200.000 ou 500.000 soldats de plus (chacun a son appréciation personnelle), la guerre était gagnée… ils ont certainement raison mais quel pays peux soutenir un tel effort sur le long terme ? La vérité est que la compétition économique interdit de dépenser de l’argent sans espoir de retour sur investissement. Le magazine Slate, reprenant certains titres de la presse anglo-saxonne, titrait sur le naufrage de l’économie grecque dont l’origine remonterait à … 2004 et la facture des JO, évaluée à 20 milliards d’euros, dont le poids sur la dette fut fatal. En 2008, Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, évalua le coût de la guerre d’Irak à 3.000 milliards de dollar. Si la Grèce a succombé à une dette de 20 milliards d’euros, que serait-il advenu d’un pays ou même d’une coalition ayant dépensé 3.000 milliards de dollars ? La vérité est qu’aucun autre pays, aucune coalition, à part les états unis, ne peut soutenir un tel effort. Emetteur de la monnaie de référence mondiale, les USA possèdent le privilège de pouvoir faire tourner la planche à billet sans que les dollars émis ne reviennent jamais au pays. Et en admettant que la phase 3 ait été atteinte, il reste encore à installer durablement un groupe capable de protéger et développer les acquis et d’éviter que la situation ne bascule vers un nouvel équilibre non désiré. La situation Irakienne illustre toute la complexité de cette phase qui coute encore très cher aux Etats Unis. En fait, le principal enseignement des conflits actuels est que la situation est beaucoup plus simple lorsque l’intervention vient de l’intérieur.
Et c’est là que se situe le tournant actuel. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un tournant stratégique mais plutôt de la prise en compte d’une vérité, connue de longue date, après la folle période exploratoire ouverte par la fin de la guerre froide. D’une certaine façon, le conflit libyen a marqué la fin de cette période même si certains - en particulier militaires - feignent de ne pas le voir. Les puissances « réalistes » ont pris acte des incertitudes du schéma classique d’intervention, trop peu fiable pour la défense de leurs intérêts. La projection de force est coûteuse et la projection de puissance est le plus souvent bloquée par le conseil de sécurité. Mais il est une autre puissance dont il ne faut pas sous-estimer les effets : la puissance financière. Celle-là, plus discrète, n’exige pas de résolution du conseil de sécurité. Elle peut ouvrir des portes totalement étanches aux autres puissances en bousculant les équilibres par l’injection massive de capitaux destinés à soutenir une cause et l’aider à prendre l’avantage. Rien de fondamentalement nouveau puisque la puissance financière des USA avait déjà permis à l’Europe de combattre le fascisme durant la première guerre mondiale et les activités de la CIA se sont toujours largement appuyées sur cette puissance pour lutter contre le communisme. Mais ce qui est inédit, c’est l’arrivée de nouveaux acteurs qui détiennent des excédents de trésoreries leur permettant de jouer un rôle sur une scène autrefois réservée aux puissances militaires. L’action du Qatar en Libye et en Syrie souligne cette réalité qu’il convient de prendre en compte. Et que penser des groupes multinationaux dont la puissance est très supérieure à celle de certains états ? Wall Mart, géant américain de la distribution, brasse un chiffre d’affaire supérieur au PIB de l’Iran ; le chiffre d’affaire de Total est supérieur au PIB de la Roumanie.
Toutes ces données permettent de rappeler quelques évidences qui ont peut-être été perdue de vue :
-
Il n’y a pas de puissance, de quelque nature qu’elle soit, sans une économie solide. Même si la Tanzanie veut s’offrir un porte-avions pour défendre ses intérêts, elle ne le peut pas !
-
Les aventures coûteuses peuvent entrainer un décrochage économique qui in fine aura des répercussions sur la puissance du « déclassé ». La puissance reste d’autant plus élevée qu’on ne s’en sert pas…
-
Modifier une situation, lors d’une intervention militaire, exige le déploiement d’un nombre important de soldats sur une longue durée.
-
Déployer des forces sur un territoire étranger coûte très cher. Ce coût est directement proportionnel à la durée du déploiement et au volume de forces déployées.
La conclusion, à ce stade, est que l’usage de la force ne devrait être envisagé que si l’intervention peut être rapidement bouclée, c’est-à-dire si les conditions de la phase 3 de transition (voir supra) sont déjà en place dès la phase 1. Dans le cas contraire, il sera préférable de faire usage des autres attributs de la puissance pour créer des conditions plus favorables à l’emploi de la force. En particulier, la présence d’un groupe capable de prendre rapidement le relai est la condition obligatoire avant tout engagement de forces. Comme ce groupe doit être suffisamment fort, l’intervention sera forcément limitée (Si ce n’est pas le cas, c’est que le groupe n’était pas assez fort et que les conditions initiales d’une phase 3 n’étaient pas réunies !). L’intervention peut revêtir plusieurs formes : il peut s’agir d’une aide financière, d’une action diplomatique, de soutiens (logistiques, médical…), de livraison d’armes et de munitions, de la fourniture d’appui (en particulier aérien), de la destruction de capacités permettant de rétablir l’équilibre entre les belligérants, d’imposition d’une zone d’interdiction... Ainsi, la France n’a eu qu’à donner un « coup de pouce » à Alassane Ouattara pour qu’il puisse prendre le pouvoir en côte d’Ivoire. En Libye, une intervention limitée, sans déploiement de troupe au sol, a suffi pour rétablir l’équilibre entre les belligérants et permettre aux forces d’opposition de renverser le pouvoir en place. La situation en Somalie est à ce titre beaucoup plus complexe et les conditions d’une phase 3 ne sont pas encore réunies, ce qui condamne par avance toute intervention à la stagnation et in fine à l’échec. Les actions sur ce pays devraient se limiter à la préparation d’un groupe capable, à terme, de prendre le pouvoir. La multitude d’acteurs au Yémen rend l’issue d’une intervention aléatoire. Quant à la Syrie, nul ne sait si les forces d’oppositions sont en mesure de remporter la partie et de s’imposer durablement et dans ces conditions, la stratégie de soutien mise en œuvre, pour ce qu’on en sait d’après les médias, par le Qatar et l’Arabie Saoudite, semble la meilleure. Vladimir Poutine a bien perçu le danger de la « projection de finance » : il a fait voter une loi fédérale qui qualifie d’ « agent de l’étrange » les ONG Russe exerçant des activités politiques et bénéficiant d'un financement étranger. Le jour où certains pays ou organisations viendront soutenir la sédition des banlieues françaises, il se pourrait que la France considère cette mesure avec davantage de circonspection.
Ainsi, la puissance financière serait l’ultime étalon de la puissance et elle permettrait de comparer sur une même échelle graduée en dollar les états, les groupes, les individus, les organisations, les criminels et les ONG. Et de même que la puissance militaire ne peut rien sans l’intelligence qui identifie les centres de gravité d’un système et ses vulnérabilités critiques afin d’y faire porter sa pression, la puissance financière doit s’astreindre à une telle discipline pour que ses efforts puissent être couronnés de succès. Dans le livre « confession of an economic hit man », John Perkins explique comment les Etats Unis sont parvenus à imposer leurs règles aux pays du tiers monde riche en matières premières par un usage approprié de la dette. Il s’agissait à n’en point douter d’un plan de bataille économique construit comme une campagne militaire. La lecture forte instructive de cet ouvrage, écrit de façon plaisante, suscite immanquablement une comparaison avec ce qui se passe actuellement en Europe : l’Europe fait-elle l’objet d’un plan d’attaque concerté ?
Cette digression sur l’Europe permet d’enchainer sur la situation française. Quelle place pour la France dans ce nouvel environnement ? Sur la « scène internationale » La France n’est finalement qu’un acteur qui doit défendre ses intérêts, au même titre que Wal Mart, Al Qaida, Greenpeace, Amnesty International, les USA... La défense même de ces intérêts n’est pas un concept qui va de soi car ils peuvent être difficiles à identifier. Ainsi, la France peut être en conflit d’intérêt avec TOTAL, entreprise française, qui est également un acteur à part entière sur la scène internationale. En fait, le problème est insoluble tant les intérêts sont imbriqués. Un tableur Excel à qui l’on soumettrait le problème émettrait un message d’erreur de type « Avertissement de référence circulaire ». Les citoyens n’ont pas les mêmes intérêts que les entreprises, les hommes politiques n’ont pas les mêmes intérêts que les citoyens et tous les citoyens au sein d’une nation n’ont pas les mêmes intérêts - c’est là le principe de la démocratie ; comment, dans ces conditions, définir l’intérêt commun ? La solution est mise en place depuis longtemps et elle est loin d’être démocratique, n’en déplaise à ceux qui entendent donner des leçons au reste du monde : en France comme dans la majorité des pays dits démocratiques, les groupes de lobby utilisent leur puissance financière pour peser sur les décisions. Et encore ne s’agit-il que de la face la plus visible, officielle, de l’exercice du pouvoir. Ces groupes de lobby peuvent aussi bien défendre les intérêts des français que ceux d’étrangers, comme on a pu le constater lors des scandales de l’industrie du Tabac ou de l’industrie pharmaceutique. Malgré son économie encore florissante, la France semble bien fragile pour faire face aux dangers qui la guette. Le veto au conseil de sécurité de l’ONU ? La seule fois ou la France a menacé de s’en servir, les américains ont conduit leur guerre sans l’aval de l’ONU puis lui ont fait payer chèrement ce non alignement. Cinquième économie mondiale ? L’état est tellement endetté qu’une appréciation défavorable de la part des agences de notation anglo-saxonnes ruinerait le fragile équilibre budgétaire et précipiterai le pays dans une crise sans précédent. Puissance militaire ? Que peut réellement la France, seule, avec les carences capacitaires résultant des plans de lissage budgétaires successifs destinés à freiner l’expansion de la dette ? Creuset d’intégration ? Les émeutes des banlieues ont montré que la cohésion même de la France semble désormais une fragilité qui pourrait être facilement attaquée. Quelques livraisons d’armes et des subventions correctement orientées pourraient avoir des effets désastreux sur certains secteurs de l’économie, dont le tourisme.
Plutôt que de fanfaronner, il serait peut-être temps de prendre conscience de tout cela et de penser la défense différemment. A ce titre, le défilé du 14 juillet donne une image erronée de ce qu’est désormais la défense et participe au confinement des français dans leur ignorance de ces questions. Mais de façon réaliste, il parait difficile pour un pays de la dimension de la France de se mesurer aux grandes puissances face aux défis qui se profilent et en particulier ceux relatifs à la compétition pour l’approvisionnement en matières premières, simple problème d’échelle. Que peut-elle face à des géants comme la Chine ou les USA qui abreuvent les pays fournisseurs en subventions ? En dehors du cadre européen, point de salut, et cela deviendra d’autant plus vrai que les tensions sur les ressources s’accentueront. De là à imaginer que la crise économique actuelle fait partie d’un plan concerté destiné à détruire l’Europe en faisant usage de la puissance financière, il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas, faute de preuves, mais force est de constater que cette destruction profiterait à certains pays. La défense Européenne, rempart contre les attaques, vecteur des ambitions européenne, devrait être globale pour être efficace, comporter tous les instruments de la puissance : financière, diplomatique, monétaire, culturelles, militaires, industrielle, agricole. Kadhafi aussi avait rapidement compris qu’il n’aurait aucune liberté sans autonomie agricole, d’où ses grands programmes d’irrigation. Cette défense devrait s’attacher à défendre la cohésion de l’Europe contre les attaques des autres acteurs, surtout financiers. Elle devrait ensuite défendre les intérêts européens en cherchant, par l’usage coordonné de ses instruments de puissance, à générer partout dans le monde des situations conformes à ses intérêts, y compris par des actions constantes et à très long terme, ce qui exige une organisation administrative particulière. Enfin, il faudrait que l’instrument militaire, qui n’est que l’un des vecteur de cette puissance, soit développé de façon coordonnée dans un premier temps, puis centralisé lorsque l’intégration politique pourrait être réalisée, afin que les trous capacitaires ne bloquent pas la capacités d’action de l’Europe lorsque les conditions d’une intervention militaires seraient remplies. Il reste certes du chemin mais l’affirmation de principes telle que le caractère global de la défense, la cohésion européenne face aux attaques extérieures, la coordination intra-européenne des efforts de défense, la création partout dans le monde de situations conformes aux intérêts européens (qui doivent être définis) sont de nature à préserver un futur qui en l’état, s’avère peu radieux.
3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON