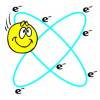José Barroso, dernier des Medici ?
L’Union européenne en 2008 serait-elle dans la situation de l’Eglise à la veille de la Contre-Réforme ? Quand la Foi déserte une institution...

En 1523, Giulio di Giuliano de Medici est élu Pape, prenant le nom de Clément VII. L’Eglise dont il hérite est riche et puissante, la Basilique Saint-Pierre, en construction, éblouit toute l’Europe. Cependant, la montée de l’alphabétisation et le défi du protestantisme minent sa légitimité en profondeur. Esthète cultivé et fin diplomate, Clément VII ne perçoit pourtant pas la nécessité de remettre en cause l’institution dont il hérite. C’est donc son successeur, Paul III qui, convoquant le Concile de Trente, initie la Contre-Réforme.
La Contre-Réforme met fin au trafic d’indulgences et aux abus les plus criants de l’Eglise, mais laisse à l’Inquisition et à la censure le soin de faire taire les oppositions, négligeant de redéfinir en profondeur le rôle de l’Eglise et son rapport au monde. Pendant les quatre siècles qui suivent, celle-ci s’épuise dans des combats d’arrière-garde : contre la révolution copernicienne, la démocratie, le darwinisme, le feminisme. Ce n’est qu’au XXe siècle que, de guerre lasse, renoncant, pour l’essentiel, à son pouvoir séculier et à son magistère scientifique, elle renoue par là même un rapport apaisé avec la société au sein de laquelle elle évolue.
En 2008, comme l’Eglise au XVIe siècle, l’Europe institutionnelle vacille. Son budget continue de croître (129 milliards d’euros en 2008) et son administration d’administrer, mais la foi qui animait la « construction européenne » à ses débuts, et qui lui conférait sa légitimité et sa force motrice, a cédé la place à un ressentiment sourd. Le Traité de Rome voulait instituer une « union toujours plus étroite » entre les peuples, mais les peuples ne souhaitent plus cette union.
Aussi, au pesant lyrisme des discours officiels sur l’Europe, succèdent les vitupérations et les récriminations de ses archiprêtres. Le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, n’hésite pas à désigner ainsi les coupables de l’echec du référendum irlandais : « des ennemis (…) puissants (…), qui sont dotés de moyens financiers tout à fait importants, qui viennent non pas d’Europe mais de l’autre côté de l’Atlantique ». Une réthorique réminiscente d’une époque qu’on aurait préféré oublier. Plus explicite, Elisabeth Guigou, ex-ministre chargée des Affaires européennes se déclare « scandalisée, car dans ce pays (l’Irlande), c’est la presse Murdoch qui a fait campagne pour le "non" ». La cause est entendue, quand les peuples européens votent « mal », c’est de la faute des Américains, forcément… Faire campagne pour le « non » est scandaleux, seul le « oui » ayant légitimité à s’exprimer. Le dramaturge allemand Bertold Brecht ironisait : « Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple ».
Lors de sa création il y a bientôt 10 ans, l’Euro devait inaugurer une ère de plein emploi et doper la croissance de l’Europe. Francfort, qui accueille la Banque centrale européenne, allait dépasser Londres pour devenir la première place financière européenne, et les Britanniques finiraient par reconnaître leur erreur et supplier humblement l’Eurozone de les accueillir en son sein. Las ! La réalité ne s’étant pas conformée à ces audacieuses prévisions, un autre discours s’est imposé : certes, l’Euro n’a pas rempli toutes ses promesses, mais « imaginez quelles crises nous aurions subies si on n’avait pas l’Euro » ! Oui, imaginons : les « Gracques », collectif de hauts fonctionnaires de centre-gauche, conçoivent ainsi une histoire contrefactuelle dans laquelle la France n’aurait pas adopté l’Euro : « Les taux d’intérêt sont au-dessus de 10% (…) La consommation et le pouvoir d’achat s’effondrent (…) le déficit (budgetaire) atteint 7% du PIB ». Diable ! Ne manque dans cette description que l’explication du rapport de cause à effet entre le maintien du Franc et cette apocalypse économique. Pourquoi et comment les pays européens qui ne font pas partie de la zone Euro (Grande-Bretagne, Suisse, Danemark, Suède…) y ont-ils échappé ?
Enfin, pour les derniers récalcitrants au discours pro-européen, reste l’argument suprême : la guerre. Ainsi Margot Wallstrom, vice-présidente de la Commission européenne, commémorant en mai 2005, en pleine campagne référendaire sur la constitution (en France et aux Pays-Bas), la libération du ghetto juif de Terezin en République Tchèque : « Certains aujourd’hui voudraient abolir l’idée supranationale. Ils voudraient que l’Union européenne en revienne à la façon purement intergouvernementale de travailler. Je dis que ces gens devraient venir à Terezin et constater ce à quoi cette méthode aboutit ». Plus explicite encore, Helmut Kohl, ancien chancelier d’Allemagne, déclarait en 1996 que « l’intégration européenne est une question de guerre et de paix au XXIe siècle ». Dans le droit fil de cette tradition, le clip du gouvernement irlandais en faveur du Traité de Lisbonne débute sur des images d’archive de la Seconde Guerre mondiale. Comment éviter le retour de la guerre ? En votant « oui » au Traité de Lisbonne, bien sûr !
Et de fait, l’Union européenne est née de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, c’est l’Etat-nation qui est tenu pour responsable des tragédies du continent. Il est au mieux une survivance archaïque du XIXe siècle, au pire un proto-fascisme, et l’Europe doit l’abolir. Construisons un Etat supranational européen, et les nations se dissoudront et s’amalgameront dans les « Etats-Unis d’Europe ». Les peuples sont-ils rétifs ? Trois ou quatre générations suffiront à les convertir.
La négation de l’idée nationale n’était pas particulière à l’Europe de l’Ouest, elle était aussi un des piliers de l’idéologie communiste et justifiait l’existence de l’URSS et du Pacte de Varsovie.
Aujourd’hui, l’histoire a invalidé cette vision. Loin de disparaître, l’Etat-nation triomphe. Loin de menacer la démocratie, il en est le cadre indispensable. Sitôt que les peuples d’Europe de l’Est eurent recouvré leur liberté, leur priorité fut de recréer les Etats-nations dont ils avaient été privés. L’Europe de l’Ouest n’est plus en reste : il n’est pas necessaire pour les fonctionnaires bruxellois de l’Union européenne de chercher bien loin pour voir agoniser un Etat multinational, pourtant vieux de près de 180 ans… La coexistence des Wallons et des Flamands au sein d’un même Etat devait favoriser l’entente entre ces deux peuples, elle alimente au contraire l’acrimonie et la défiance. L’Europe découvre qu’il n’y a pas de democratie sans « demos », c’est-à-dire sans un peuple qui se perçoit comme tel. Le Parlement européen à beau être élu au suffrage universel direct, il ne sera jamais pour autant un organe démocratique. Faute de représenter un « peuple » européen dont la concrétisation se fera toujours attendre, il n’emporte ni l’adhésion ni l’identification des électeurs, et les élections européennes ne seront jamais qu’une addition de référendums nationaux.
Les arguments quelque peu hystériques des « pro-européens », qui font plus appel à l’autorité qu’à la logique, ont de quoi décourager les meilleures volontés. Et pourtant, il existe un réel besoin d’institutions supranationales européennes : pour harmoniser les normes techniques, pour gérer les ressources communes telles que la mer et les fleuves, pour encadrer les entreprises multinationales, ou pour régler les conflits de voisinage. De telles institutions sont fréquentes entre pays voisins : l’Amérique du Sud a le Mercosur, l’Amérique du Nord a l’ALENA, l’Asie du Sud-Est a l’ASEAN. Aucune d’entre elles ne prétend cependant incarner un Etat supranational.
La vocation initiale de la Communauté économique européenne, devenue Union européenne, était d’être l’embryon d’un Etat, avec ses attributs et ses symboles : drapeau, hymne, devise officielle. Il est temps aujourd’hui de reconnaître que cette voie est une impasse. L’Union européenne doit se faire humble, et se résoudre à être non pas un Etat supranational, mais l’organisme de tutelle d’agences techniques aux objectifs circonscrits, de même que l’Organisation des Nations-Unies rassemble des agences telles que l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). C’est à ce prix qu’elle renouera des rapports harmonieux avec les citoyens qu’elle est censée représenter, mais qu’elle ne comprend plus.
M. Barroso, homme de conviction et d’ouverture, saura-t-il mener à bien cette transformation ? Ou bien sera-t-il le dernier des Medici, ébloui par les derniers feux de l’institution qu’il préside, et laissant à son successeur la charge de gérer un long déclin ?
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON