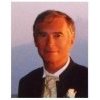La Genèse de l’Europe,
« Tous les peuples se couvrent de honte lorsque l’on se réfère à une société de philosophes si merveilleusement exemplaires : celle des premiers maîtres en Grèce, Thalès, Anaximandre, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite, et Socrate. Tous ces hommes sont taillés tout d’une pièce et dans le même roc. Une stricte nécessité régit le lien qui unit leur pensée et leur caractère. Toute convention leur est étrangère, car la classe des philosophes et des savants n’existait pas à l’époque. Ils sont tous, dans leur grandiose solitude, les seuls qui, en ce temps-là, aient vécu pour la seule connaissance. Tous possèdent cette vigoureuse énergie des anciens par quoi ils surpassent toute leur postérité, l’énergie de trouver leur forme propre, et d’en poursuivre, grâce à la métamorphose, l’achèvement dans son plus infime détail et dans son ampleur la plus grande. » Frédérick Nietzsche - La philosophie à l’époque tragique des grecs.
La fresque de Raphaël, (Chapelle Sixtine) près de 8 mètres de long et 6 mètres de haut, allégorie à la fois ludique et didactique d’un immense livre ouvert sur près de 24 siècles.
Érigé comme un diadème fastueux, au sommet d’une couronne architecturale, les deux protagonistes, progéniture majestueuse de Socrate : Platon et par filiation Aristote.
Platon, l’index droit orienté dans la verticalité idéale et céleste, rationnel déductif, figure de proue d’un certain christianisme paganisé à venir, Aristote, main droite ouverte apaisante, épousant l’horizontalité terrestre, l’immanence, l’induction empirique, la réalité de la matière. Les deux héros traversant une haie d’honneur d’élèves et de successeurs potentiels. Ils scelleront, de leur brillante influence, le développement des systèmes éducatifs, politiques et religieux.
Socrate, (-470/-399 av. Jésus), l’un des créateurs de la philosophie morale et politique. Passeur, d’esprit orientaliste, parlait mais n’écrivait point. Premier accoucheur d’âme connu, philosophe et thérapeute avant la lettre. Vient clore un long processus génésiaque introduit par les philosophes de la nature, les « physiologues ». Chronologie, synchronisation et synchronicité président à la destinée de l’humanité. Les présocratiques ont vu le jour avec les ioniens qui eurent pour chef de file Thalès, la pensée en forme de chrysalide « tout est en un ». Suivirent les pythagoriciens au vocable évocateur, puis les éléates avec Parménide, tous partageant des idées extravagantes sur l’origine de la matrice de toutes choses, des esprits déistes libres, empreints de religiosité, des penseurs de la nature. (physiologues) Poussés par des axiomes métaphysiques, dont l’origine est une intuition d’ordre mystique, comme divine. Dans un même temps, Lao-Tseu, Confucius, Moïse et tant d’autres inconnus s’émerveillèrent, peut être dans une concertation secrète et commune sans parole sur toute la surface de la terre. L’auditoire de Socrate, même partiellement identifié, contient en germe les formes de développement aujourd’hui actualisées. Balbutiement d’histoire universelle. J’adjoindrai la temporalité aux grands précurseurs et piliers de notre monde.
Alcibiade, une étoile de première grandeur de la Grèce éternelle. Métamorphose somptueuse du mythe à l’idéal créateur de toutes réalités. Arts et lettres, politique, stratégie conquête et puissance. Demi-dieu incarné sorti de l’antre d’Homère, constellation entre voie lactée et trou noir somptueux. Ainsi naissent les complexités humaines exceptionnelles que seul l’imaginaire inspiré ose appréhender.
Antisthène, suivit d’un seul disciple qu’il châtia entre tous, Diogène, sa caricature. Attentif aux conseils de Socrate, pratiquant la frugalité et l’endurance stoïcienne, le mépris des hommes selon Héraclite, on accepte mieux qu’il fut aussi préalablement l’élève de Gorgias. Il professait que « seul le plaisir lié à l’effort et résultant d’une ascèse personnelle peut contribuer au bonheur ». Diogène son acteur tragi-comique, histrion inconditionnel, chante vaillamment ses louanges sur l’agora, par tous les temps et jusqu’à la fin des temps.
Alexandre le grand, assiste à la prestation allégorique de Socrate, son précepteur fut néanmoins Aristote. L’on ne connaît pas vraiment l’enseignement que lui prodigua Aristote, qu’eut-il fait ce bel âtre de « la métaphysique » et de « la poétique de l’âme » ? Il retint et adapta à sa nature belliciste exceptionnelle, le savoir empirique de son illustre et génial maître et protecteur Aristote.
L’homme a ses secrets démons. La notoriété d’Alexandre peut s’expliquer par sa volonté de conquête de l'ensemble du monde connu. L’énergie qu’il déploya fut si grande que l’illusion s’incarna réellement jusqu’au bout de la terre et bien au-delà. Au pays fondateur des mythes, des légendes et des récits homériques, cette aspiration au gigantisme prit tout son sens.
Il n’eut pas le temps d’atteindre la maturité et ne put se remémorer les conseils d’Aristote que d’ailleurs il ne respecta pas.
« Souviens-toi que les jours passent sur toute chose, estompent les actions, effacent les œuvres et font mourir le souvenir, à l’exception de ce qui fut gravé dans le cœur des hommes par l’amour et qu’ils transmettent de génération en génération. »
Gorgias, la rhétorique, amorale et neutre, abysse de potentialité qui fascine ou effraye, c’est une question d’éthique. Ainsi plus que jamais l’homme est libre et responsable. La vérité fragilisée s’abandonne à la force du langage. Le pouvoir sur les esprits, effet d’argumentation, émotions stimulées, le rythme et les effets sonores. Panthéon des avocats et des hommes politiques. Les justes qui l’expérimentèrent sincèrement furent souvent assassinés (Aristote, Jésus, Jaurès, Zola et Nietzsche, lui inconsciemment, par décompensation mutique...et tellement d’autres). Dans la mystification, les iniques prospèrent. Gorgias, charismatique, d’une intelligence brillante, enfante toujours des génies et des monstres sympatiques. La subjectivité humaine est reine de toute éternité.
Épicure, le plaisir minimal et la non-souffrance, (l’ataraxie) aborde l’angoisse métaphysique de l’homme, en prônant une philosophie de la non-pensée de la mort. « Si l’esprit n’est plus, il ne peut donc avoir peur, la mort n’est donc rien pour nous. » Extraits de sa délicate lettre à Ménécée « Qu’on ne remette pas à plus tard, parce qu’on est jeune, la pratique de la philosophie et qu’on ne se lasse pas de philosopher, quand on est vieux. En effet, il n’est, pour personne, ni trop tôt ni trop tard, lorsqu’il s’agit de veiller à la santé de son âme. » « Aussi le jeune homme doit-il, comme le vieillard, philosopher : de la sorte, le second, tout en vieillissant, rajeunira grâce aux biens du passé, parce qu’il leur vouera de la gratitude, et le premier sera dans le même temps jeune et fort avancé en âge, parce qu’il ne craindra pas l’avenir. »
Averroès, captivé par Pythagore, réaffirma son penchant aristotélicien pour les concepts empiriques qui s’appréhendent scientifiquement. Ce médecin médiéval arabe de culture polyvalente juriste et philosophe évolua allègrement entre la loi coranique et la philosophie humaniste. Sa déconvenue dans sa confrontation au malékisme, le plaça sur les chemins de l’exil. Il devint un solide et crédible porte parole de la connaissance. Sa vie fut désormais consacrée à Aristote, il accomplit le travail salutaire de passeur, auprès d’un occident plombé par le Saint empire romain germanique endoctriné et verrouillé par le Vatican. Puriste, il chercha l’authenticité du sens originel des écrits et des êtres humains. Les lumières de la révélation accessibles à l’intellect actif l’inclinèrent à séparer la raison et la foi. L’influence du philosophe arabe fut importante dans les écoles médiévales souvent hostiles, sous l’autorité d’un Thomas d’Aquin plus soucieux des doctrines pauliniennes obscurantistes et oublieux de la portée philosophique et humaine des évangiles de Jésus.
Pythagore, (-580/-495) réformateur déiste de la grande Grèce, moine d’influence orientale sectaire, pratiquant ses arts monistes réels et légendaires de manière autoritaire. Les régions éblouissantes volcaniques de la Sicile furent le théâtre de ses activités. Scientifique, mathématicien, thaumaturge créateur du vocable « philosophique » « celui qui a été annoncé par la Pythie de Delphes. Sa vie énigmatique recouvre pourtant des univers nombreux, variés et concrets. Il considère religieusement l’univers naturel à travers une vision numérique, sa géométrie n’est pas abstraite. Le symbole et la métaphore n’entre pas dans son école contemplative qui féconde la raison à travers la réalité plastique du nombre. Pas de texte de lui, des apocryphes, soixante et onze lignes des vers d’Or lui sont faussement attribués. La vraie vie ne serait-elle pas aussi légende ? Le néopythagorisme ne naquit pas du néant. L’intuition Parménidienne se confirme. Le néopythagorisme est empreint d'une mystique des nombres, celle-ci est présente dans la pensée de Pythagore. Hérodote le mentionne comme « l'un des plus grands esprits de la Grèce, le sage Pythagore ». Il conserve un grand prestige ; Hegel disait qu'il était « le premier maître universel ».
Anaximandre de Milet (-610/-546 av. Jésus) émerveillé par son élève, Pythagore. Pratique des observations directes comme le lever et le coucher des étoiles. L'Univers, clos qui prévalait jusque-là, s'est changé en un espace ouvert dans lequel flotte la Terre. « Elle reste suspendue, elle n'a aucune direction particulière vers laquelle tomber, elle n'est dominée par rien, et reste à sa position parce qu'elle est à égale distance de tous les points. » Les notions de haut et bas sont celles de notre expérience quotidienne. La raison, bien exploitée, et appuyée sur l'observation, nous libère d'une illusion ; elle nous libère d'un point de vue partiel et limité, et restructure notre compréhension du monde selon une forme nouvelle. » Anaximandre sera le premier penseur à assumer de manière explicite la pensée de l’infinité de l’Univers. Pour désigner cet espace, Anaximandre emploie le terme d’Apeiron que l’on peut traduire par « substrat indéterminé et illimité ». Pour lui, c’est bien plus qu’un support de coordonnées géométriques puisque c’est le premier principe de tout ce qui est. C’est une révolution cosmologique.
Parménide, (fin VIe, milieu Ve av. Jésus.) Cherchant l’approbation de Pythagore, scribe absorbé : La poésie au service de la connaissance, « Ces fragments inachevés, ces papyrus de marbre dont la lumière , comme celle des étoiles mortes nous vient d’un autre temps. » Cet authentique poète offre en partage, le contenu de son écritoire de marbre, fragments de phrases gravées devenues pour l'éternité. Inspiration qui fait s’interroger ses compagnons de route à travers les siècles, aujourd’hui encore... A ses côtés, en retrait, Hypatie l’unique femme, scientifique et philosophe alexandrine qui nous fixe conquérante pacifique, énigmatique par les passions et les drames qu’elle suscita dans sa vie et par les choix contestés des personnages de la fresque de Raphaël. Dans ce temple du savoir où la réalité et la fiction cheminent joyeusement pour engendrer la vérité, pourquoi ne pas songer à la déesse de la justice, la Diké dont l’éléate Parménide reçut le commandement pour acquérir la connaissance. Sa muse, son anima, celle qui produit l’illumination. Il est des instants délicieux ou les sciences de l’esprit et de l’âme touchent au sacré. Entre « l'être "l'étant" et le non être qui n'est pas, » tautologie, pléonasme, lapalissade pour les uns et pieux casse-tête linguistique et métaphysique pour les autres ? Parménide, dans son poème philosophique qui émerge de cette rencontre inspirée offre le passage de l’ignorance à la connaissance, c’est à dire à ce qui « est ». C’est un appel à la formation de l’esprit critique. Il demande de connaître et de prendre en compte le vrai et l’opinion. « I1 faut que tu apprennes toutes choses, et le cœur fidèle de la vérité qui s’impose, et les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude »(la doxa)
Héraclite, (542-480 av.Jésus) Philosophie du logos, de l’harmonie, du combat, de la mobilité du temps. Implication dans les afflictions et calamités d’une humanité en mutation permanente. Pensée actualisée parce qu’à l’épicentre de l’ego. « c’est une philosophie de la limite et du seuil qui nous fait accéder à ce devant quoi elle s'arrête. » « je gémis sur l'instabilité des choses ; tout y flotte comme dans un breuvage en mixture ; amalgame de plaisir et de peine, de science et d'ignorance, de grandeur et de petitesse : le haut et le bas s'y confondent et alternent dans le jeu du siècle. » C’est le décryptage d’une dérive de l’humanité à travers sa violence aveugle, militaire, politique ou financière. Toutes formes d'injustice inhérentes à l’humanité qui se perpétuent à travers les siècles. Héraclite représenté sous les traits de Michel-Ange, ils partagent une expression faciale torturée, se retrouvant l’un dans l’autre, prostrés, mélancoliques et voués au chaos intérieur pour l'éternité. Tandis que l'auteur, Raphaël, contre le pilastre de droite, à côté de son ami Sodoma (en latin dans le texte) nous observe indifférent et complètement étranger aux facéties dont on le soupçonne.
Diogène, Incontournable, même si d’évidence, cet atypique insoumis semble repousser la collectivité ambiante. Univers antique aux époques prestigieuses confondues intentionnellement. Ce rigoriste peu enclin à la chaude sympathie se répand dans un inconfort spartiate. Gastéropode et philosophe d’amphore, il semble affecté d’être privé de son habitacle légendaire. Il n’en est rien, son esthétique cynique est profondément scellée, car elle s'accorde avec la réalité et satisfait aux lois de l'esprit. Quant à la caricature, dont elle épouse la forme, ce peut être pure pédagogie pour imposer l’essentiel de son fondement. La modernité confirme le pouvoir de l’outrance.
Euclide, errant pourtant entre mythe et réalité formant ici avec son groupe d’étudiants, un ensemble harmonieux de communication gestuelle, comme le prolongement humain de compas et de règles s’entrecroisant et s’articulant gracieusement dans l’espace. Son message et son illustration modélise avec pertinence le monde physique ambiant. C’est un moment de grâce, d’initiation et de solennité spatiale. Le bras tendu, tel un archer arque bouté, Euclide se soumet à l’attraction terrestre.
La géométrie euclidienne réside dans le fait qu'elle n'utilise peu ou pas de théorèmes complexes et d'algèbre ou d'analyse. C'est une mathématique autonome et indépendante, où les preuves proviennent essentiellement de raisonnements purement géométriques.
Le lien s’établit entre le théorème fondamental des espaces euclidiens et la version géométrique du théorème de Pythagore, son grand aïeul et l’on bascule dans le groupe pythagoricien de gauche.
Ptolémée Claude Auteur de traités scientifiques qui ont exercé une grande influence sur les sciences occidentales et orientales. Un traité d’astronomie, l’Almageste, La Grande Composition et une synthèse des connaissances géographiques du monde gréco-romain. Antique science fondée sur
l'observation des astres, les nombres, le calcul et la mesure. Les arabes et les byzantins seront les passeurs des sciences hellénistiques au moyen âge et à la Renaissance.
Zoroastre. Sa vie prophétique intemporelle, s’accompagna d’événements surnaturels et de miracles Les affabulations galactiques qu’il généra, s’adressent aux amateurs antédiluviens. C’était au temps ou l’inconscient collectif de l’humanité planchait sur l’existence d’un Dieu unique. Temps lointain où Abraham arpentait le croissant fertile en sandales, songeant à la terre promise avec postérité. A ce propos, l’on ne peut que rendre grâce à cette augure, le judéo-christianisme. Babylone, Our en Chaldée, 3e dynastie (Assyrie), 1900 ans av. Jésus, Abraham fait route vers Canaan. Vers 1250 av. Jésus, sous Ramses II, Moïse entreprend l’exode qui durera 40 ans. Il immortalisera le Pentateuque, les 5 premiers livres de l’ancien testament et transposera le monothéisme égyptien dans le nouveau pays de son peuple. Il semble que les historiens sont plus à l’écoute des philosophes que des religieux. La littérature générée par la religion est d’une abondance considérable, on pourrait s’interroger sur le bien fondé de cette attitude intellectuelle ? Certes la nature particulière des phénomènes religieux, arbitraire et partielle découragent la réflexion.
Plotin, espèce de capucin d’un ordre mendiant dans la compassion christique médiévale. L’index gauche mollement orienté vers la terre, geste délicat un peu abandonnique. Porphyre évoque dans sa biographie, sa bienveillance, sa douceur, et sa présence à la condition humaine. Il s’occupe des enfants orphelins qu’il a recueilli et dont il a la charge. Il veille à leur éducation et à la gestion de leur vie matérielle. Plotin ramène le particulier à l’universel, le sensible éphémère et décevant aux réalités invisibles. Le progrès est dans le détachement — Critique de la conception plotinienne du détachement . Double influence, socratique et christique. La vie philosophique mène à l’union ineffable avec Dieu mais elle peut revêtir des aspects de stoïcisme voire d’austérité. Plotin fut impopulaire malgré son humanisme. Selon le témoignage de St. Augustin, la Passion de la Beauté, de la Lumière, de la Pureté, de l’Intelligence est en même temps l’Être. Elle porte témoignage d’une vie avec Dieu. « La vie sans Dieu n’est qu’une ombre de vie » le vrai moi est en nous, l’âme doit s’affranchir du corps. Alors elle pourra peut-être s’unir à un principe métaphysique transcendant, au-delà du monde, l’Un. La vie philosophique mène à cette union ineffable avec l’Un, a sa valeur en soi, sa vie le démontre.
L’activité des philosophes plus anciens, même s’ils n’en étaient pas conscients, débouche sur un salut commun et une purification générale ; le cours puissant de la civilisation grecque ne doit pas être interrompu et de terribles dangers doivent être écartés de sa route : Le philosophe défend sa patrie. Or, désormais, depuis Platon, le philosophe est en exil et conspire contre sa patrie...Les géants s’interpellent à travers les intervalles désertiques de l’histoire et, sans qu’il soit troublé par les nains insouciants et bruyants qui continuent à ramper au-dessous d’eux, leur sublime dialogue entre esprit se poursuit. F. Nietzsche
Plan et inspiration, « La philosophie à l’époque tragique des grecs »
Raphaël apporte sa vision picturale humoristique et gracieuse. « L’Académie d’Athènes »
http://artpaintingartist.org/wp-content/uploads/2014/02/Who-is-who-The-School-of-Athens.jp
Profs d'Histoire lycée Claude Lebois* M. Renard L'école d'Athènes, iconographie
54 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON