La Turquie prête pour l’Europe ? Quatrième volet : la laïcité
La Turquie, laïque depuis la proclamation de la République en 1923 par Atatürk, est depuis quatre années dirigée par un gouvernement composé d’élus de l’AK Parti, parti de droite islamiste, modéré.
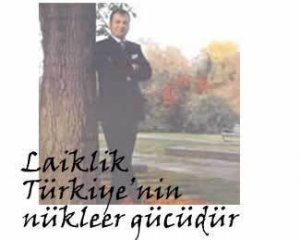
Au début des années 2000, la Turquie fut frappée par une crise économique : inflation galopante, licenciements, faillites d’entreprises... La population la plus vulnérable (jeunes, ouvriers, employés, agriculteurs et petits commerçants) fut touchée de plein fouet.
Encore en pleine convalescence de cette crise économique, la Turquie sanctionna, au cours des législatives 2002, les partis politiques historiques de droite, du centre et de gauche, mais donna une majorité parlementaire aux élus de l’AKP, un parti islamiste modéré de tendance de droite.
L’arrivée au pouvoir de ces dirigeants islamistes révolta les partis classiques turcs et inquiéta l’Occident. La principale crainte fut la mise en place progressive d’un Etat musulman balayant ainsi la laïcité. Mais les années passant, l’action du gouvernement apaisa les inquiétudes.
La République de Turquie, depuis sa fondation dans les années 1920 sous l’impulsion de Mustafa Kemal Atatürk, est laïque. La laïcité est l’un des principes de l’idéologie kémaliste. Elle mit fin à la participation de la religion aux affaires de l’Etat, comme c’était le cas dans l’Empire ottoman. Elle imposa l’indépendance de la justice, de l’éducation et de la culture, la religion n’ayant plus aucune influence.
La laïcité est donc un des fondements de la Turquie. L’armée en est garante, et n’hésite pas à le rappeler régulièrement afin d’éviter d’éventuelles dérives. Récemment, elle a participé à un débat naissant sur le port du voile par de jeunes femmes étudiantes pratiquantes dans les universités. Cette intervention a clôturé les discussions.
La laïcité est donc un sujet très sensible. L’opinion publique turque est partagée sur la question. En "excluant" les islamistes radicaux (qui prônent un Etat islamiste), deux approches de la laïcité s’opposent : celle dite kémaliste (sans concession sur la séparation complète de l’Etat et de l’Eglise) et celle "relative", qui souhaite certaines libertés de la pratique religieuse. Cette deuxième approche a des demandes multiples parmi lesquelles deux prédominent : l’autorisation du port du voile par les femmes pratiquantes, partout et sans restriction (actuellement, interdiction dans toutes institutions publiques) ; et la mise en place d’une pause supplémentaire le vendredi, pour la prière du Vendredi (actuellement tolérée mais sur la pause repas, tout retard n’étant pas excusable).
Aujourd’hui la Turquie, celle qui veut intégrer l’Union européenne, sous l’impulsion de son gouvernement d’islamistes modérés, est laïque au même titre que la France. Les débats sont de même ampleur que ceux qui agitent parfois la France. Forte de sa toute-puissance, l’armée est garante de la laïcité turque, héritage d’Atatürk, fondateur de la nation... et ici, cette garantie est la plus solide qui puisse être.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








