Le Pakistan dans le chaos : l’ombre de la Mosquée Rouge et d’Al Qaeda
Le Pakistan, pour le découvrir, il faut se plonger dans sa culture, sa vie politique, ses courants religieux, sa presse locale. On y découvre la part d’ombre de son régime, les peurs d’un peuple mais aussi ses espoirs... Aujourd’hui, plus encore, alors que le Pakistan a déclaré l’état d’urgence, il est important de mieux comprendre les tenants et aboutissants d’une situation qui peut malheureusement dégénérer. Tout semble avoir dérapé lors de la tragédie de la Mosquée Rouge qui ensanglanta Islamabad en juin dernier. Cette date est manifestement un tournant majeur de la politique de ce pays qui sombre dans une guerre civile programmée par les mollahs, mais également par des puissances étrangères. Ce texte veut rassembler l’ensemble des données nécessaires pour comprendre une nation « nucléaire » plongée dans une histoire douloureuse et minée par le terrorisme international.
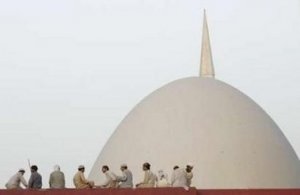
Introduction
Le Pakistan est en train de vivre des moments délicats. Sorti « de la cuisse de l’Inde » en 1947, cette jeune nation islamique a eu à affronter des partitions meurtrières. On se rappelle des mots du jeune BHL visant à alerter la communauté internationale de la catastrophe Bangladhi. À l’époque, le Pakistan désespéré tentait de reprendre par une brutalité toute militaire un quart de son territoire qui lui échappait. Après cette cuisante débâcle, le Pakistan lorgna sur le Kashmir à dominante musulmane et sous l’autorité de l’Inde... Là, s’ensuivirent d’interminables escarmouches qui débouchèrent parfois sur des péripéties humiliantes pour le Pakistan : on rappellera la retraite de l’armée pakistanaise qui pourtant avait mené une campagne victorieuse au Kashmir en 1999 sous la pression internationale. Erreur fatale qui décida notamment le général Musharraf à évincer le chef de l’État Nawaz Sharif dont le pouvoir se confondait avec une corruption sans précédent couplée à des réformes islamisantes très anxiogènes pour l’Occident.
Mais le Pakistan reste également le premier pays musulman à s’être doté de l’arme nucléaire le 28 mai 1998 dont le concepteur Abdul Qadeer Khan est élevé en gloire nationale... Particularité donc d’un pays qui arrive à une excellence technologique et dont la population conserve un mode de vie quasi-médiéval. Contradiction d’un pays qui conduisit une femme, Benazir Buttoh, aux plus hautes fonctions exécutives alors que certains mouvements politiques soutiennent des positions très radicales ouvertement proches d’Al Qaeda.
Rappelons également l’étanchéité relative de la frontière Afghano-pakistanaise... Christophe de Pontfilly, reporter international, était d’ailleurs intarissable sur le sujet. Il mentionnait notamment « les avions pakistanais bombardant les troupes du général Massoud en juillet et en août 2000 autour de la ville de Taloqan ». Inversement il ajoutait que « des observateurs virent plus tard des hélicoptères faire des allers-retours entre des poches de combattants talibans et le Pakistan afin d’exfiltrer hors du champ des caméra la présence logistique pakistanaise et des islamistes de l’Afghanistan ». Enfin, les NWFP pakistanaises (régions tribales) servent toujours de position de repli aux Talibans à la suite de la bataille de Tora-Bora comme l’indique l’ambassadeur Robert Black Hill qui voyait en ces zones montagneuses « des sanctuaires terroristes et des provinces totalement ingouvernables » (21 octobre 2001). Elle fut un levier majeur de la survivance de la résistance talibane et surtout de l’autogénération des partisans d’Al Qaeda.
I- Un panorama politico-religieux pakistanais :
1-Les origines ethno-religieuses du Pakistan
Pour comprendre le Pakistan d’aujourd’hui, il faut scruter son « histoire immédiate ». Ainsi, le fondateur du Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, fut un des pionniers de la « désislamisation » du Pakistan et de l’orientation du pays vers une forme de laïcité. Ceci n’était pas simple car 75 % de la population pakistanaise est sunnite. Ces derniers se divisent eux-mêmes en « Déobandi » et en « Barelvis ». Les premiers descendent spirituellement d’un courant né en Inde, au nord de Delhi au sein d’une madrasa (école coranique) établie dans la ville de « Deoband ». Dès 1867, cette madrasa influença la spiritualité des musulmans locaux dans une forme de prostration austère. Cette philosophie voyait la technologie, les influences extérieures comme néfaste à un islam recroquevillé sur lui-même. À partir de la création du Pakistan, les Déobandi bien qu’opposés à l’idée d’un État politique islamique pakistanais affluèrent vers les provinces du Balochistan, du Punjab, du Sindh ou enfin dans les zones tribales (NWFP). C’est d’ailleurs de ces madrasas à majorité Déobandi que sont issus les étudiants « talibans » et l’ossature du mouvement qui ravagea l’Afghanistan dès 1996. On rappellera la passion de certains dirigeants religieux Déobandi, comme Sami Ul Haq, issu de la fameuse madrasa Haqqaniya, qui se disait prêt à fermer son école coranique pour mener le Jihad en Afghanistan... Idem aussi pour les campagnes de « rééducation coranique » visant à nettoyer la ville de Baloch en 1998 de tout ce qui pouvait ressembler à un poste radio, à un magnétophone, à un téléviseur et de toute représentation incohérente avec la logique coranique radicale. Campagnes en effet récurrentes... Encore récemment les massacres de la Mosquée Rouge démarrèrent par une épuration des quartiers chauds d’Islamabad.
Face à ce fondamentalisme, une large majorité de Pakistanais se trouve plutôt assimilée au mouvement Barelvis. Il a vu jour dans la ville de Bareilly et plus précisément au sein d’une madrasa, la « Mullah Ahmad Raza Khan Barelvi ». La particularité de ces Barelvis est de s’accoutumer à l’islam classique et modéré, tout en acceptant des formes de vieilleries paganistes, permettant des croyances en des bienfaiteurs plus ou moins magiques. Au-delà de ces différences entre Barelvis et Deobandis, il faut souligner que les dirigeants politiques ont toujours su sentir les limites de réformes acceptables ou non par la population. Ainsi, lorsqu’un dirigeant désire se rapprocher du gouvernement américain, il tient compte de la réaction Déobandi qui ne se fait jamais attendre. Elle se limite le plus souvent à des manifestations relativement musclées. Mais rien de bien méchant car la large majorité des Pakistanais aime son confort, sa musique et les bons côtés de la vie. Même au fond des provinces les plus reculées, les Pakistanais savent écouter d’une oreille les activistes Déobandi ou les rengaines des mollah Barelvis tout en « faisant leur vie ».
L’étude de Richard Kurin permet de bien comprendre les réactions paradoxales et explosives de quelques courants pakistanais et d’apprécier la sagesse de la majeure partie la population. Richard Kurin a navigué pendant des années dans les villages les plus reculés du Pakistan. Chaque micro-société semble être une miniaturisation de cette volonté générale de vivre bien et de « faire avec » des particularismes sectaires que nous décrirons plus loin. Là, encore, il y a toute une dimension locale à ne pas négliger : ainsi dans certaines localités du Sindh un adultère ou un acte contraire à loi coranique conduira à une résolution expéditive et brutale du problème, ce qui ne sera pas le cas dans d’autres vallées qui auront des interprétations plus humaines du Coran. Les assemblées de villages (jirga) sont alors toutes puissantes, mais sont perçues par les Pakistanais comme une forme démocratique respectée.
2- Les particularismes religieux et les dirigeants pakistanais
Bon nombre de responsables politiques comme Mohammed Ali Jinnah voulurent une séparation de la religion et de l’État. On retrouve ainsi un texte daté du 11 août 1947 qui se révèle incontournable pour l’ensemble de la classe politique de l’époque. Ali Jinnah devant l’Assemblée nationale déclara « Vous êtes libres, libres d’aller à vos temples, libres d’aller à vos mosquées et n’importe où au sein du Pakistan. Vous pouvez appartenir à n’importe quelle caste, croyance, religion. Mais ceci n’a rien à voir avec les fonctions de l’État. Nous entamons un principe fondamental qui suppose que nous sommes tous des citoyens et des citoyens égaux d’un seul État ». Cette déclaration est donc cruciale dans la vision du Pakistan moderne, même si quelques dirigeants, portés par des résurgences islamiques radicales, ont tenté d’établir un État islamique, ont facilité le retour à la Charia, ont assoupli les mesures restrictives concernant l’éducation au sein de madrasas un peu trop extrémistes. Dès 1949, on note les diatribes du Mullah Sabbir Ahmed qui fustigeait ouvertement le principe « laïcisant » d’Ali Jinnah... Pour lui, l’islam n’est pas un code privé entre un « créateur » et son fidèle. Il est un code de vie, un code politique, religieux, social. Les deux mentalités modernistes et radicales étaient ainsi plantées très tôt dans le décor politique du jeune Pakistan. Le général Ayub Khan, en 1958, traita d’ « obscurantistes » les religieux qui voulaient « frustrer » de tous les progrès la population pakistanaise. Ayub critiqua les mœurs polygames qui menaient à la misère des villages entiers en s’appuyant sur le fait que trop d’hommes avaient abusé d’un pouvoir qui reposait essentiellement sur la capacité d’un être à faire vivre une descendance décemment. Il tenta même de changer le nom de la République islamique pakistanaise en République pakistanaise... Mais il se heurta à une série de poussées populaires orchestrées par des groupuscules très implantés et très structurés (rapport du général Lamballe) que nous aborderons plus loin. Face à ces montées de puritanisme et de religiosités tatillonnes, les successeurs d’Ali Jinnah et d’Ayub Khan eurent des attitudes différentes. Au cours des années 70, Zulikar Ali Bhutto joua sur les particularismes religieux pour prospérer et lâcha du lest en direction des instances cléricales les plus radicales. D’autres dirigeants choisirent de pactiser totalement avec les religieux et en vinrent à être plus « royalistes que le roi ». Le général Zia ul Haq, préoccupé par l’avancée des troupes soviétiques en Afghanistan, s’appuya sur les intégrismes et laissa progressivement le pouvoir des mollahs se redresser. Il alla même jusqu’à proposer une taxe, la « Zakat » basée sur une idée de redistribution financière émanant du Coran. On réécrivit les livres de classe à l’adresse des petits Pakistanais, la burqa fut largement plébiscitée au grand dam de ceux qui rêvaient d’un Pakistan moderniste. Au début des années 1990, la situation héritée par Benazir Bhutto et Nawaz Sharif obligea la classe politique à des compromis systématiques avec les religieux. Benazir Bhutto ne se focalisa pas le moins du monde sur la réduction des féodalismes religieux, mais perdit son énergie à justifier sa compétence en tant que femme. L’impact de Nawaz Sharif fut politiquement largement plus discutable. Outre le fait qu’il fut incapable de diriger son pays, il préconisa un retour à nouveau vers des fondamentaux religieux. Nawaz issu d’une famille de conservateur se rallia naturellement aux souhaits des mollahs. Il lança une réforme constitutionnelle visant à promulguer la Charia comme pierre angulaire du droit pakistanais. Ceci provoqua une inquiétude grandissante dans l’armée qui voyait aussi d’un très mauvais œil les atermoiements de Sharif dans la situation de Kargil au Kashmir. Aussi, le coup d’État de Musharraf puis plus tard la déflagration du 11-Septembre vinrent-ils changer la donne aux confins de Lahore, de Quetta, de Karahchi ou d’Islamabad. L’enjeu actuel est donc de maintenir le Pakistan dans une forme de régime stable et progressivement indépendant des structures religieuses radicales. Musharraf lui-même se considère comme progressiste. Il abhorre les partis islamiques et les résurgences d’un monde musulman archaïque. Ainsi, on rapporte l’anecdote d’une interview de Pervez à la BBC. Le journaliste demanda au Premier ministre s’il priait 5 fois par jour. Musharraf lança sereinement : « quand un père ne prie pas cinq fois par jour, pourquoi voulez-vous que le fils le fasse ». La modernité de Musharraf éclatait et sûrement faisait oublier le peu de marge de manœuvre que lui laisse la réal-politique pakistanaise.
3- Des partis politiques subversifs
Au-delà des différences ethnologiques existant entre Deobandis et Barelvis, le Pakistan doit composer avec des courants politiques internes très actifs voire des influences sectaires qui reposent sur des différences plus connues entre sunnites et shiites. Ainsi, par exemple, on compte des groupes comme le SSP (Sipah-e-Sahaba Pakistan), le TJP (Tehrik-e-Jafria Pakistan), le SMP (Sipah-e-Pakistan) qui ont le point commun de flirter avec la lutte armée et les coups de force violents. La violence par attentat a d’ailleurs été multipliée par 20 entre 1989 et 2001 au fur et à mesure de l’apparition de ces groupes... Plus violent encore, le Lashkar-e-Jangvi, issu du SSP, conduisit des campagnes militaires réitérées pour éliminer Nawar Sharif en 1999 et montra une détermination stupéfiante dans la poursuite de ses actions qui culmina dans un bain de sang en avril 2000. La mosquée de Rawalpindi fut ainsi la cible d’un groupe d’assaillants armés de grenades et d’armes automatiques... avec un bilan sombre, 19 morts et une trentaine de blessés. Enfin, pour compliquer la politique intérieure pakistanaise, on peut citer des partis religieux officiels qui canalisent une partie des radicalités du pays. L’Ulema-e-Islami (JUI) et le Jamat-e-Islami couvrent les régions des provinces tribales (NWFP) et la Balochistan, le premier ayant une implantation plus rurale que le deuxième. L’Ulema-e-Pakistan (JUP) qui après une série d’échecs électoraux s’est transformé en un groupe de pression islamique plus ou moins résilient. Chacun de ces partis apprécie les aberrations de la Charia... et se spécialisent dans des formes d’actions précises. Ainsi, le Jamat-e-Islami s’est spécialisé dans des mouvements d’opinions qui finissent souvent par des drapeaux américains brûlés sous la clameur des « Allah Akbar ». Mais encore une fois, ces foyers d’islamisme dur ne sont pas assez coalisés pour faire craindre une révolte populaire, les Pakistanais étant majoritairement proches du modernisme prôné par les instances dirigeantes actuelles. Ainsi, la politique pakistanaise est aussi complexe que nos groupuscules politiques européens. La nébuleuse des partis islamiques est aussi impressionnante que la noria de groupuscules d’extrême droite français qui existait au cours des années 30 ; rappelons l’Action française, les Croix de feux, les Volontaires nationaux... Cette analogie permet de se faire une idée globale de la variété du paysage politique pakistanais.
4- L’ISI, acteur principal de la « démocratie pakistanaise »
Un organe majeur de la stabilité politique du Pakistan réside en l’ISI, agence de renseignement nationale. Élément majeur du Pakistan moderne, vase communicant à l’infini, courroie de transmission politique, influençant ou influencée, infiltrée ou infiltrante. Que ce soit à Karachi, à Lahore ou Peshawar, elle est implantée. Elle est. Elle veille et surveille. L’Agence est redoutée par les Pakistanais. Personne n’aime à la nommer tellement elle est puissamment ancrée dans l’esprit des gens. Elle est également l’ossature de ces conflits politico-religieux. C’est elle qui rythme la vie de chaque habitant, qui s’immisce dans chaque madrasa, chaque Mosquée... Au courant de tout et au cœur de toute la politique actuelle du Pakistan moderne, l’ISI est incontournable, mais reste marquée par ses contradictions toutes pakistanaises. Ainsi, le chef de l’ISI en 2001 séjournait à New York le 11 septembre et fut démissionné très rapidement pour avoir des sympathies très poussées avec le Mollah Omar. L’agence de renseignement pakistanaise est elle aussi influencée par les partis islamiques et on ressent l’opacité de cette structure capable de faire condamner Omar Sheik, tout en assurant la survie des chefs de guerre talibans au sein de madrasas reculées du Wasziristan. Là encore, BHL montre combien l’ISI fut responsable d’un deal avec Omar Sheik dans son ouvrage vérité sur la mort d’un journaliste dont le seul travers était d’être né juif et Américain. Dans cette histoire, on découvre que pour l’ISI, une bonne vérité est celle qui l’arrange ou qu’elle arrange. Elle orchestre incessamment des pare-feux méandreux camouflant des compromissions avec Al Qaeda. L’ISI donc s’affirme comme une pieuvre responsable directement ou passivement d’attentats sur l’ensemble de la région indo-pakistanaise. En effet, elle fut d’ailleurs soupçonnée dans le maelström qui déchira une ville du sud de l’Inde qui vit exploser plusieurs camions piégés en simultané.
5-Les Madrasas
Mais, plus encore que l’ISI, il est important d’aborder le rôle des Madrasas. La question fondamentale du poids des madrasas revient incessamment dans la vie quotidienne des Pakistanais. Elles sont parfois le creuset d’un intégrisme dont les soubresauts se font ressentir autant dans les articles du Dawn que dans le Boston Globe ou l’International Herald Tribune. Ces écoles religieuses étaient pourtant estimées seulement à 250 au temps de l’indépendance du Pakistan. Avec l’invasion soviétique en Afghanistan, la situation et leur nombre changèrent. Elles fournirent les combattants les plus motivés contre l’armée rouge : ces célèbres Moudjahidins qui vinrent à bout du pouvoir communiste au fil d’une érosion des spetsnaz et autres bataillons soviétiques. Les madrasas alors virent des fonds étrangers affluer provenant de la CIA, des émirats, de l’Arabie saoudite... En 1987, on comptait environ 2 800 madrasas produisant déjà 30 000 « étudiants » chaque année. Un véritable cursus de Jihad organisé et structuré sous le regard approbateur de l’Occident... En 1995, une étude de la question des madrasas montra qu’elles étaient au nombre de 2 500 dans la seule région du Punjab. La croissance exponentielle continua jusqu’à l’avènement de Pervez Musharraf qui en 2001 fit état de 7 000 à 8 000 écoles produisant entre 700 000 ou 800 000 adeptes. Dans un article de Pervez Houdboy paru dans le Daily Times en juin dernier, le décompte frôlait les 10 000 structures religieuses totalement libres et globalement peu surveillées. Sur cet ensemble, Owen Bennet Jones (Pakistan, eye of the storm) fait néanmoins un rappel intéressant : le faible réseau d’écoles religieuses des années 47 s’est transformé en « système d’éducation parallèle » touchant un nombre très substantiel d’enfants pakistanais. Là où l’État de droit démissionne, les groupes religieux s’installent.
L’éducation proposée par certaines madrasas est bien évidemment orientée sur des principes religieux austères et anachroniques. Ainsi Owen Bennet Jones aime à rappeler que dans quelques écoles coraniques la médecine y est enseignée comme au XIe siècle et les manuels de géométrie sont calqués encore sur ceux du IIIe siècle... Un vrai retour aux sources, Euclide quasiment dans le texte... Bien sûr, un enseignement totalement inadapté pour une activité professionnelle quelconque. Pour la plupart des candidats au Jihad, la perspective d’un petit salaire suffit à les convaincre de traverser les frontières pour se battre contre des ennemis d’Allah. On retrouve également la clause ultime d’une prime de quelques centaines de dollars pour soulager les familles de martyres. Le prix d’une mort violente, déchiqueté par un obus ou partagé en deux par une rafale de mitrailleuse lourde. Abus de confiance ou d’inculture par une religion prise dans les méandres du jusqu’auboutisme. On est loin des cavaliers de Kessel toujours sur leurs montures glorieuses qui traversent l’Hindou Koush jusqu’aux confins du Pakistan voisin, criant « Allah » avec la joie de virtuoses équestres. Mais rappelons encore qu’il ne faut pas banaliser et associer l’extrémisme radical à toutes les madrasas. Ce ne serait pas correct vis-à-vis du Pakistan. D’ailleurs Christophe de Ponfilly, dans sa lettre ouverte à Joseph Kessel, mettaient en garde sur les raccourcis d’éditorialistes ou de reporter trop focalisés sur un point de thématique intégriste. Pontfilly dénonçait ainsi « ces journalistes qui allaient jusqu’à payer pour tourner dans les madrasas. Il fallait montrer l’image du mal, l’incarnation du méchant. Le mollah hystérique, celui qui avait la plus longue barbe et la plus sale gueule était au hit parade des sujets chocs... On annonçait (en 2001) déjà avec une sorte de jubilation malsaine l’imminence d’une explosion du monde musulman ». De même, il rappelle que « la moindre manifestation d’extrémistes bruyants, de provocateurs illuminés, de tarés vociférants, était aussitôt filmée sous tous les angles, de préférence au moment où les effigies de Georges Bush étaient piétinées et le drapeau américain brûlé ». Pontfilly conclut d’ailleurs que « les extrémistes sont partout minoritaires, les filmer c’est faire leur propagande »... Je retiendrai personnellement cette dernière remarque gravée dans l’imaginaire de nombreux journalistes. Néanmoins, il est toujours utile aussi d’enrichir cette réflexion de celle de BHL qui fit une incursion dans la madrasa de Binori Town (Qui a tué Daniel Pearl ?) : l’ambiance lourde d’une zone de non-droit avec des militants religieux armés, des dignitaires religieux ambigus et menaçants.
II-Le tournant historique du Pakistan et de la péninsule indo-pakistanaise.
1- La tragédie de la Mosquée Lal Masjid (Mosquée Rouge)
Il y aujourd’hui un problème avec les madrasas. Cette réalité est revenue à la surface en juin dernier au cours de la tragédie de la Mosquée Rouge et constitue probablement un tournant politique pour l’ensemble du Pakistan. Un reportage de Matthews Pennington, du 13 juillet dernier, montre l’intensité de l’assaut qui a eu lieu dans la Mosquée Rouge, plus connu sous le nom de Mosquée « Lal Masjid »... 87 victimes et trente-cinq heures de combats acharnés à la suite d’un mois de tergiversations ; bilan militaire aussi, 9 morts dans les services de sécurité et 40 blessés... Les journalistes ont visité les lieux des combats, ont d’abord traversé la « Jamia Hafsa », école de jeunes filles. À l’intérieur, les impacts de balles ont tout ravagé... Des fresques ont éclaté sous les tirs des commandos spéciaux, les sols, les plafonds, les murs sont constellés d’éclats, des bris en tout genres. Les militants religieux avaient sûrement préparé leur siège, prévoyant des chicanes bien fortifiées, des murs de sacs de sable encore présents et ayant amorti quelques charges sourdes des unités d’élites de l’armée pakistanaise. Une petite ville confinée dans un théâtre de guerre improvisée en plein Islamabad... Il faut alors imaginer ces chaussures en vrac dans les petites salles de classe, les livres déchiquetés par la mitraille, les échanges de coup de feu entre retranchés et troupes pakistanaises et au milieu des militantes, des fanatiques et des innocentes... Le major-général Waheed Arshad mentionnait aux journalistes quelques lieux bien tristes... tel endroit où une bombe humaine avait emporté six otages, empêchant toute reconnaissance des victimes pulvérisées par l’explosion en milieu confiné. Là, dans ces lieux d’études religieuses évidés par tant de heurts, seules les mouches continuaient à former des nuages gloutons et voraces... Encore, là, Arshad mû par une forme de somnambulisme hébété, arpentant les lieux connaît chaque recoin qui a vu partir en morceaux plusieurs kamikazes ceinturés par des kilos d’explosifs... Effarant, consternant... des explosifs artisanaux, des canettes de soda transformées en bombes infernales, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des douzaines de pistolets de tous calibres, des dizaines d’AK-47, des radios, un arsenal lourd, arsenal réfléchi permettant de résister pendant ces deux jours furieux. Les lieux les plus retranchés et ceux qui auront été les plus durs à « nettoyer » ont été ceux occupés par Abdul Rashid Ghazi, l’un des deux frères qui avaient menés la rébellion islamiste en plein cœur d’Islamabad... Rappelons au passage que ce sont ces deux frères qui auront lancé une campagne de « vertu »... dénonçant la présence de « masseuses chinoises » très consciencieuses et menacées d’être défigurées à l’acide... Tout cela avec l’assentiment du grand dignitaire de la Mosquée Rouge, Maulana Abdul Aziz... Ce dernier, juste avant l’assaut final, avait d’ailleurs quitté cette mosquée en se déguisant en femme, mais avait été très aisément repéré par les forces de l’ordre. Cette anecdote mémorable avait fait sourire les Pakistanais dans leurs chaumières. Mais, plus sérieusement, pour Abdul Rashid, la mort avait été le choix, la seule solution acceptable, à l’image de son père Maulana Muhammad Abdullah qui périt pour cette même mosquée quelques années plus tôt...
Ce choix d’ailleurs avait été bien anticipé par une reporter du Herald Tribune qui quelques jours avant l’assaut avait fait un article sur l’angoisse des familles qui avaient envoyé leur progéniture étudier l’Urdu, la langue officielle, dans une école coranique digne, sévère et respectée... Ainsi, Carlotta Gall avait bien décrit le sentiment d’inquiétude montante de Manzur Ahmed, anonyme d’un jour mis en lumière par la prise d’otage de sa fille. Celui-ci avait voyagé et traversé tout le Punjab pour avoir des nouvelles de sa fille de 19 ans, Sumaya Tabbasum retenue prisonnière. Idem pour Misraddin, qui lui venait du Kashmir pour soutenir un frère blessé au pied dès les premiers échanges de tirs. Enfin, un dernier témoin du désastre, Malik Muhammad Ayub, 58 ans, originaire du fin fond du Waziristan qui avait envoyé son petit-fils travailler ses langues, devenir un honnête homme dans ces écoles, mais pas pour se battre contre un gouvernement ou des idées. La tragédie est donc ainsi, des enragés jouant sur la crédulité, l’innocence de gens sans histoire envoyés là pour faire leur éducation. Les quatre coins du Pakistan représentés dans un article fleuve d’une reporter américaine très « pro ». La suite est connue. Quelques images restée dans les mémoires. D’un côté, le général Musharraf se recueillant symboliquement devant la dépouille d’une colonne des forces spéciales tuée dans un assaut décisif. La mosquée criblée de balles qu’on repeindra en jaune pour effacer le passé. Dans la tension du moment, d’ailleurs, mettant en terre son frère dans son village en plein cœur du Penjab, le survivant Ghasi prédit au Pakistan une « révolution islamique imminente ». Le tournant politique du Pakistan est ainsi enclenché. En écho à cela, une série d’attentat aux camions piégés fut perpétrée aux quatre coins des régions du Sindh, Balochistans... réactions sourdes qui s’opèrent dans le « Pakistan féodal » dès que le pouvoir se fait trop stringent. Une querelle de chiffre plus macabre s’ensuivit. Qazi Hussain Ahmed, chef du Parti islamique, « le Jamaa-e-islami », déclara d’ailleurs qu’on pouvait pleurer entre 400 et 1 000 étudiants avec leurs professeurs. Il faut savoir pour corroborer ces chiffres légèrement surévalués que la madrasa réunissait jusqu’à 1 300 jeunes filles de 4 à 20 ans. La centaine de victimes officielles ne correspondait pas au va-et-vient des obsèques orchestrées en catimini par les agents très officiels de l’ISI...
2- Les origines internationales du drame de la Mosquée Rouge
Oui, le désastre de Lal Masjid est donc à l’interface de plusieurs intérêts, internationaux, locaux, particuliers... Certaines explications de cette tragédie sont en effet à rechercher à l’échelle internationale. D’une part la gesticulation de la Chine a poussé le gouvernement pakistanais à l’assaut sanglant. L’ambassadeur chinois contesta énergiquement le fait que ces jeunes « masseuses » chinoises prises en otages par les frères Ghazi puissent être des prostituées. La Chine mit la pression sur Musharraf pour les faire délivrer et régler durement le conflit. On rappellera que la Chine apprécie les régimes radicaux islamistes et qu’elle a déjà un passif soudanais que tout le monde connaît. Voudrait-elle déséquilibrer Musharraf pour mieux négocier avec un régime plus compréhensif ? Série de questions sans trop de réponse...
L’attitude trouble des chancelleries étrangères voyant d’un bon œil un divorce entre Musharraf et les islamistes est frappante. En effet, un pacte de non-agression plus ou moins tacite était toujours en vigueur depuis 2001 vis-à-vis des madrasas trop zélées en matière d’islam radical. Idem d’ailleurs pour la politique très laxiste du gouvernement pakistanais vis-à-vis des salafistes réfugiés au sein des zones tribales en direct contact avec l’Afghanistan. Ceci était donc mal vécu par les Américains et les Occidentaux qui espèrent beaucoup de la situation de crise au Pakistan pour expurger les régions tribales de leurs militants.
Le besoin de puissance des frères Ghazi est aussi un facteur clé... Essayant de renouer inconsciemment avec l’aura de leur père sacrificiel, les Ghazi sont allés délibérément « au contact ». Ces islamistes étaient convaincus de leur devoir de diriger la vie de leurs compatriotes... En face, la nécessité de régler le problème des extrêmes par Musharraf aura fait le reste. Musharraf petit homme au tempérament brutal, peu doué pour communiquer ce qu’il sent politiquement et ce qu’il veut, mais homme profondément persuadé que le chemin vers la démocratie dans son pays sera long et difficile...
3- Les répercussions du massacre de Lal Masjid
Désormais, la brutalité s’immisce dans tout au Pakistan. Ainsi, un hélicoptère d’escorte présidentielle explosa lors du dernier voyage éclair de Musharraf à Rawalimpi. Un dernier attentat retentissant a visé le retour triomphal de Benazir Buttho... Le carnage de Karachi a fait plus de 100 morts et 400 blessés dans la procession joyeuse venue accueillir l’exilée politique. Y a-t-il également une peur des islamistes radicaux devant la coalition Buttho-Musharraf, ces deux derniers étant déterminés à en découdre avec Al Qaeda et à en finir avec Ben Laden, probablement replié dans les régions tribales ?
En sourdine, il faut se souvenir des propos de Fran Towmsen, éminence grise du comité de sécurité à la Maison-Blanche, qui exigeait du Pakistan une politique plus active contre le terrorisme. Le 8 et 9 juillet dernier, elle prit la parole sur Fox New pour prévenir que si Musharraf ne prenait pas les devants contre Al Qeada, elle proposerait l’incursion de forces spéciales américaines au Pakistan... Message apparemment bien reçu étant donné qu’elle vient de féliciter le mois dernier le gouvernement pakistanais pour ses efforts dans la guerre contre le terrorisme. On a pu entendre ces derniers jours qu’une trentaine de militaires avait péri lors d’un assaut contre des talibans embusqués dans un nid d’aigle des régions tribales.
Faut-il d’ailleurs douter d’une autre analyse de Fran Townsen qui fut diffusée dans le Herald Tribune récemment ? Pas vraiment : en septembre dernier, l’attentat avorté qui se préparait dans la ville d’Ulm remontait rapidement dans les méandres des camps d’entraînement pakistanais. Ainsi Daniel Mathieu Schneider et Fritz Gelowitz, respectivement 22 ans et 28 ans, qui projetaient de mener un attentat avec plus de 400 kg de peroxyde contre les bases américaines en Allemagne et qui furent appréhendés par le GSC9 dans la localité de MedeBach Oberschleden, avaient fait quelques séjours de formation terroriste à Damas, en Ouzbekistan et enfin au Pakistan. Même chose pour les proches de Mohammed Atta qui furent souvent en discussion avec des membres de l’ISI. Idem enfin pour les médecins anglais qui ont tenté de se faire exploser le 11/9 à l’aéroport de Glasgow. Idem pour Mohammed Irfan Raja, Akbar Butt et Usman Ahmed Malik qui selon le Daily Telegraph du 25 juillet dernier projetaient de faire un séjour actif au Pakistan. De même pour un jeune Anglais de 21 ans qui a été condamné la semaine dernière à huit ans de prison pour avoir surfer de trop près sur des sites de confection de bombes et qui fut appréhendé alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour le Pakistan. Ces stigmates terroristes confirment donc l’importance du Pakistan dans la régénération systématique d’Al Qaeda et des groupes salafistes les plus durs.
Le 9 octobre dernier, un rapport, à l’écriture duquel Fran Townsend a participé, fut profondément scruté par le monde du renseignement. En effet, les régions tribales pakistanaises auraient vu une recrudescence de l’activité de militants plus aguerris et déterminés visant à fondre sur des cibles occidentales. La deuxième partie du rapport laissait entendre que des infiltrations étaient déjà en cours au cœur même du Waziristân. Face à ce chaos originel, il est peut-être important de se focaliser sur le moyen terme. Ainsi, les propos de Pervez Hoodbhoy (Daily Times, juin 2007) montrent combien la prévention peut être efficace contre les dérives des madrasas ou d’extrémistes. Il rappelle l’évidence d’une politique de sécurité adaptée. Ainsi, comment le processus d’armement de la Mosquée Rouge a-t-il pu passer inaperçu ? Comment se fait-il que les sites web de la Mosquée Rouge ou des madrasas talibanes aient pu être réactualisés au plus fort de la crise de juillet dernier ? Comment se fait-il qu’une radio talibane puisse dicter des fatwas appelant à l’insurrection générale en émettant de cette funeste madrasa... Pervez Hoodbhoy, en bon physicien, souligne que si des principes de pure logique avaient été suivis la tragédie d’Islamabad aurait pu être évitée et le recrutement de jihadistes internationaux aurait pu être freiné. A la fin octobre, Hoodbhoy avec son courage d’universitaire titrait son article du Dawn (octobre 2007) : « C’est notre guerre ». Dans cet article qui fait écho à celui de juin dernier, il montre l’importance de lutter frontalement contre la « talibanisation » du Pakistan. En effet, depuis Lal Masjid, les régions tribales sont en ébullition et des centaines de soldats ont été faits prisonniers. Pervez critique ouvertement l’inaction de l’armée qui aurait dû riposter rapidement. En effet, « comment mobiliser une armée si on ne va pas à son secours lorsqu’elle est en péril » ? Hoodbhoy mentionne Israël qui avait déployé une opération gigantesque pour retrouver ses fantassins kidnappés par le Hezbollah...
3- L’insurrection du Swat et l’Etat d’urgence
Comme pour donner raison à Pervez Hoodbhoy, des informations concernant la vallée du Swat, qui coule paisiblement au cœur des régions tribales, mettent en relief la descente aux enfers du Pakistan depuis Lal Masjid. A la une du Herald Tribune du 2 novembre, un taliban armé de son AK47 propose fièrement un billet à une petite échoppe destinée à recevoir les dons de soutien aux proches d’Al Qeada. Jane Perlez et Ismael Khan, journalistes au NY Times, rapportent aux lecteurs que la guérilla s’est intensifiée depuis juin dernier. Alors que 2 000 soldats pakistanais investissaient la vallée, une bombe humaine emporta une vingtaine d’entre eux pour leur souhaiter la bienvenue. Malgré l’appui d’hélicoptères attaquant la position de 500 militants, quarante militaires ont été faits prisonniers du côté de Kwazakhela. Plus sordide, les têtes de deux agents gouvernementaux ont été exhibées dans les rues de Matta, un village situé à une trentaine de kilomètres de Saidu Sharif, capitale du Swat. Ainsi, selon Sher Mohammad, juge dans la région du Swat et vivant du côté de Peshawar, les talibans « détiennent environ 10 % du territoire, mais ils arrivent à terroriser l’ensemble de la vallée ». L’ambiance cruelle compose également avec les sermons de Maulana Fazlullah. Proche du mouvement radical local « Tehreek Nafaz-e-Shari at Muhammadi », Fazlullah prône souvent sur les radios la création d’un califat. Il s’oppose à l’éducation des filles, mais surtout il bannit la vaccination anti-polio. Le résultat est que la plupart des gamins du Swat n’ont plus de couverture vaccinale. La plupart des lots vaccinaux envoyés par l’Univef sont désormais stoppés aux portes de cette région jugée trop instable et hostile. Selon Rukhshanda Naz, directeur de la fondation Aurat, qui travaille sur le droit des femmes, une douzaine d’écoles de jeunes filles a été détruite par les talibans, celles qui restent encore ouvertes ont reçu l’injonction de faire porter la burqa à l’ensemble des élèves. Ainsi, pour finir, on comprend donc la constatation de Farook Adam Khan, juge très influent au Pakistan : « Le Pakistan est en état de siège ». Prémonition évidente car le 4 novembre, le président Musharraf a décrété un état d’urgence. Le pouvoir est à nouveau dans ses mains. Il devra alors se lancer dans une rééducation du Swat avec tout ce que cela comporte de risques, de sacrifices humains. On notera le jeu politique de Benazir Buttho, qui reste en retrait pour reprendre l’Etat en main dans le cas précis où Musharraf serait emporté par un attentat islamiste. Elle est, avec ce petit général qui vise à en finir avec le féodalisme religieux et Al Qaeda, la dernière carte démocratique du Pakistan.
En conclusion
L’enjeu des suites de la Mosquée Rouge est international. Il y a l’arme nucléaire et sa technologie. Il y a l’ombre de Ben Laden. Il y a aussi l’échec de Bush dans sa guerre mal pensée contre un terrorisme qui n’espérait pas une position de repli aussi facile. Il y a aussi tapie dans un mutisme calculateur la Chine limitrophe qui a soif d’une porte vers le pétrole au prix d’un pacte de non-agression avec le fasci-islamisme. Cette semaine Pervez Musharraf a déclaré l’état d’urgence dans le but de résoudre le problème des extrémismes. En aura-t-il le temps ? Les Etats-Unis lui permettront ils de stabiliser le pays ou préféreront-ils jouer la carte Buttoh ? Contre ces forces à géométries variables, il faut compter sur le fond « Barelvi » pakistanais. Des hommes qui aspirent avant tout à la paix.
Bibliographie :
- Bangla-Desh : nationalisme dans la révolution, Maspéro, 1973 réédité sous Les Indes Rouges en Livre de Poche)
- http://sara-daniel.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/06/05/7-tora-bora-ou-pas.html
- Général Alain Lamballe, Terrorism in South Asia, RR3, november 2005 http://www.cf2r.org/fr/activites/rapports-recherche.php#rr_3 - http://www.svabhinava.org/IndoChina/AlainLamballe/PakistanSeVendALaChine-frame.php
- Lettre ouverte à Joseph Kessel sur l’Afghanistan. Christophe de Ponfilly ISBN-13 978-2869700611
- http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370168
- http://www.iht.com/articles/2007/11/03/asia/pakistan.php
- http://www.iht.com/articles/2007/11/01/asia/militants.php
- Pakistan : The Eye of the Storm. Owen Bennett Jones. ISBN-13 : 978-0300097603
- Pervez Hoodbhoy. http://www.chowk.com/writers/495
- Preventing More Lal Masjids. Pervez Hoodbhoy, Daily Times. July 2007 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=13276
- It Is Our War. Pervez Hoodbhoy. The Dawn. http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=14113
30 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









