Lutte contre le terrorisme : « retirer le feu sous le chaudron » (19e stratagème)
Pour paraphraser Sully, nous pourrions dire que les deux mamelles d’une action efficace sont un concept pertinent et des moyens d’action adaptés. Ceci vaut tout particulièrement dans le domaine de la lutte anti-terroriste.
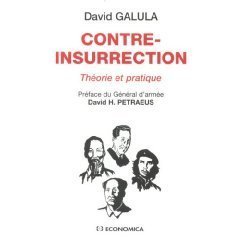
En matière de concept, une bouffée d’oxygène vient de nous être apportée par la Rand Corporation, avec la parution d’une étude intitulée « How terrorist groups end, lessons for countering al Qa’ida ».
En substance, les chercheurs se sont livrés à une étude portant sur 648 groupes terroristes ayant sévit entre 1968 et 2006. Leur principale conclusion est que seuls 10 % d’entre eux ont cessé leurs activités après avoir atteint leurs buts, tandis que 7 % seulement ont été écrasés par la force militaire. Reste donc un noyau dur constitué par 83 % de ces groupes. C’est là que réside l’intérêt principal du travail de la Rand. Il met en évidence que la moitié (43 %) de ce noyau dur a déposé les armes suite à une solution politique et l’autre moitié (40 %), celle qui refuse l’évolution vers le terrain politique, a été démantelée sous l’effet d’une action combinant le renseignement, l’infiltration et le noyautage (services secrets) avec un dispositif sécuritaire coordonnant les acteurs publics dans la mise en œuvre de la loi (justice, police, douanes, administrations…). L’étude de la Rand souligne en outre la résilience particulière des groupes terroristes religieux qui rend la tâche plus ardue pour les autorités. Voilà donc une base intéressante pour éclairer le choix d’un concept de lutte anti-terroriste.
Le paradoxe en la circonstance réside dans le fait que le pays qui nourrit l’institution éminente qu’est la Rand Corporation, au sein de laquelle sont hébergés les auteurs de cette étude, ainsi que de nombreux autres think tanks, qui irriguent la pensée stratégique internationale, soit également celui qui, tout en disposant d’autant de matière conceptuelle, agit de manière monolithique en Irak, comme en Afghanistan, en faisant de l’outil militaire l’argument central de la lutte anti-terroriste.
Mais paradoxe pour paradoxe, et pour stopper net un rictus méprisant d’anti-américanisme primaire, il est intéressant d’évoquer un autre événement qui prend place également dans le champ conceptuel, quitte à écorner, cette fois, notre amour propre national. Il s’agit de la redécouverte, par le général américain David Petraeus1, de l’ouvrage de David Galula, intitulé Contre-insurrection, diffusé en 1963 par la même Rand Corporation, faute, pour l’auteur, d’avoir pu s’exprimer sur le territoire national. Cette rencontre est celle de deux intelligences et de deux parcours exceptionnels.
Parcours hors du commun pour le lieutenant-colonel David Galula, officier français, entré à Saint-Cyr en 1939, rayé des cadres de l’armée d’active en 1941 « en application des lois portant statut des juifs ». Réintégré au sein de l’armée d’Afrique en 1943, héros des combats de libération de l’Europe, il occupe ensuite une série de postes qui lui permettent d’observer de près les conflits insurrectionnels d’après-guerre dans les Balkans (Grèce) et en Extrême-Orient (Chine, Vietnam, Malaisie, Philippines). Ce qu’il y a vu lui sera directement utile lorsqu’il se retrouvera à la tête d’une compagnie dans le Djebel Mimoun en Kabylie. C’est là qu’il mettra en œuvre sa théorie naissante de la contre-insurrection par la pacification. Il prouve alors le rôle central de l’action en faveur des populations pour faire baisser le niveau de conflictualité en coupant la guérilla de sa base populaire. L’originalité de Galula tient notamment à la distance qu’il a prise, par rapport à la doctrine du colonel Trinquier, exprimée dans La Guerre moderne, ouvrage dans lequel l’auteur considère qu’en ayant recours au terrorisme les rebelles perdent tout droit à être traités comme soldat.
Un moment mis en avant par la hiérarchie militaire qui lui fait prononcer des conférences en France et aux États-Unis, son caractère non-conformiste irrite rapidement ses chefs. Il choisit alors de s’exiler pour répondre à une invitation de Harvard qui, ayant reconnu ses talents, lui propose un poste de visiting fellow.
Les travaux de David Galula ne seraient probablement jamais parvenus sur les rayons de bibliothèque de l’école militaire (publication française en 2008), si cet autre homme d’exception qu’est le général David Petraeus n’en avait découvert les vertus, en 2005, alors qu’il rentrait d’Irak, où il avait été chargé d’organiser les forces irakiennes. Son expérience sur ce théâtre d’opération avait stimulé en lui le besoin de solutions alternatives à la mise en œuvre de la force militaire conventionnelle. Passées les opérations de conquête du terrain, en 2003, la force classique avait montré rapidement ses limites devant le développement de l’insurrection.
David Petraeus est un personnage complet, alliant la compétence intellectuelle, il est docteur en sciences politiques (Princeton), a une très large expérience du commandement de terrain, il a commandé la 101e airborne pendant l’offensive de 2003. Son profil, à mi-chemin entre l’intellectuel et l’opérationnel, l’a conduit naturellement à rechercher des réponses non conventionnelles à une situation qui ne l’était pas non plus. Avant même que la Rand ne produise son étude suggérant les deux grands axes à retenir pour lutter contre le terrorisme, David Petraeus les avait fait consigner, peu ou prou, dans le manuel de contre-insurrection diffusé au sein de l’US Army Combined Arms Center, à Fort Leavenworth, qu’il a commandé à son retour d’Irak.
C’est à ce stade qu’ont commencé les vraies difficultés, car il ne suffit pas d’identifier le concept d’action le plus pertinent, encore faut-il le mettre en œuvre.
David Petraeus, comme nombre d’esprits innovants, s’est rapidement heurté à un mur. Ce mur est celui de la résistance au changement, bien connu de tous les réformateurs. Nombre d’études faites par le département de la défense ont souligné l’inertie, voire les réticences exprimées par les cadres de contact, officiers et sous-officiers, à renoncer à une posture uniquement tournée vers le combat. Ces jeunes militaires plongés dans un univers hostile, si différent de leur environnement habituel, ont tendance à raisonner de façon binaire. Chaque instant passé hors de leurs camps retranchés met leur vie en danger. Dans ces conditions, l’attitude sécuritaire, justifiée par des pertes nombreuses, les conduit à traiter la population systématiquement comme suspecte et contribue, donc, à l’entretien du ressentiment.
Le concept de « caporal stratégique », exprimé par le général Charles Krulak, peine à montrer sa face positive. Les bavures du caporal américain dans un village irakien éclaboussent la Maison-Blanche, mais le même caporal est en difficulté pour conquérir le cœur des populations, à l’opposé du caporal des troupes de marine français qui y met un point d’honneur. On peut voir, dans cette incapacité, la traduction non seulement d’une incompréhension du concept, mais surtout du manque de préparation et de formation pour mener à bien des missions qui allient les qualités, d’apparence antinomiques, de combattant à celles de militant d’ONG. Il n’est pas aisé, en effet, d’accepter ce mode de fonctionnement quasi schizophrénique qui impose une implication personnelle, une remise en cause et une adaptation permanente, une intelligence des populations et du terrain, une capacité relationnelle, une compétence technique adossée à des moyens financiers pour traiter les affaires dites "civilo-militaires". C’est un changement de culture qui ne va pas de soi pour l’armée américaine, c’est une charge lourde à porter par les militaires de rang modeste, c’est un défi risqué pour la hiérarchie. Sur ce terrain, pourtant les Britanniques, comme les Français, ont démontré sur tous les théâtres de l’après-guerre froide, qu’il pouvait être relevé. Le général Petraeus est malgré tout parvenu, à force de conviction et de volonté, à réduire la violence en Irak pendant son mandat de commandant des troupes au sol de 2007 à 2008. Mais il était personnellement le moteur de cette évolution. En son absence, le naturel risque de revenir au galop.
Le comportement des militaires n’est pas le seul en cause. L’appareil politico-militaire américain ne s’engage pas, non plus, véritablement dans la mise en œuvre des phases de pacification suggérées par David Galula : prise de contrôle de la population, destruction de l’organisation politique insurgée, organisation d’élections locales, mise à l’épreuve des dirigeants élus, création d’une structure politique regroupant les opposants à l’insurrection. Cela imposerait d’administrer directement les populations sur le terrain, de répondre à leurs besoins essentiels et de restaurer la confiance en mettant en œuvre une gouvernance exemplaire dans le respect des individus et de leurs cultures. Méthodes appliquée en totalité ou partiellement avec succès par David Galula en Kabylie, par John Paul Vann au Vietnam et bien d’autres encore, restés anonymes. Mais il est vrai que ces réussites ponctuelles et éphémères devaient plus à l’imagination et à la volonté de ces personnalités d’exception qu’à la clairvoyance et à l’implication de leurs hiérarchies avec lesquelles ils étaient souvent en délicatesse.
La lutte contre le terrorisme impose de réconcilier ces francs-tireurs et les administrations dont ils dépendent pour ne pas en rester éternellement à un échantillonnage d’actions brillantes rapidement annihilées par les erreurs en séries ou les revirements intempestifs des responsables trop éloignés des réalités de terrain. Cette remarque vaut pour toutes les nations désormais solidaires, de facto, face aux menées terroristes. Encore faut-il bien distinguer la nature de ces menées qui vont de l’acte isolé (Madrid, Londres) jusqu’à l’insurrection (Irak, Afghanistan), en passant par les actions multiples concertées (New York). Chacune appelant des anticipations et des ripostes durables et adaptées.
La question centrale devient alors celle des moyens humains. La Rand, dans son étude, a souligné les deux modes d’action qui conduisent le plus sûrement au terme de l’activité des groupes terroristes : aider à l’évolution de ces groupes vers le champ d’expression politique et développer une gamme d’actions sécuritaires visant à dévitaliser les structures clandestines. Dans ces deux configurations, ce sont toujours les hommes qui en sont le plus sûr atout : coordonnateurs, diplomates, juges, fonctionnaires, agents des services, forces spéciales, militaires.
Pour valoriser ce potentiel, deux axes principaux d’effort doivent être retenus : d’une part le développement d’une réelle capacité d’innovation et de pensée alternative chez les cadres et, d’autre part, le décloisonnement des services et des administrations de l’Etat.
Sur ce dernier point, beaucoup reste à faire en dépit de déclarations rassurantes ressassées comme un leitmotiv incantatoire dans les sphères dirigeantes. Chacun a le loisir de constater au quotidien qu’il reste du chemin à parcourir. Il ne suffit pas d’être imaginatif en matière d’organigramme pour brasser les hommes. Par ailleurs, il est plus aisé pour les dirigeants médiocres d’entretenir dans leurs services un sentiment obsidional, qu’ils pensent propice à la cohésion interne, qu’une culture de partage. Une part substantielle de l’énergie déployée par les groupes humains est consacrée à freiner, contrer, critiquer l’action déployée par les plus créatifs. Face au terrorisme, cette attitude est purement suicidaire. L’évaluation des cadres de tous niveaux doit inclure sans ambiguïté leur aptitude à coopérer efficacement avec leurs partenaires. La « jalousie territoriale » et « l’étouffoir à initiative » sont des fautes graves.
Lorsqu’on en vient à évoquer les notions d’innovation et surtout de pensée alternative, les dirigeants les mieux disposés ne peuvent s’empêcher de penser indiscipline, électron libre, cacophonie et au bout du compte désordre et inefficacité. Cette version frileuse ne saurait être retenue sans faire prévaloir le conformisme stérile qui nous prive des meilleurs talents. L’exemple du lieutenant-colonel Galula, contraint de s’exiler aux États-Unis pour s’y exprimer librement et utilement, nous le rappelle douloureusement.
Pour introduire une note d’espoir, il est permis de se référer à un milieu au sein duquel cette tournure d’esprit est en revanche considérée comme une qualité. C’est celui des forces spéciales. Pour elles, c’est une question de survie. Placées dans des situations extrêmes, leur imagination doit fonctionner à plein régime. Pour cela toutes les énergies sont employées à ciseler un outil destiné à obtenir un effet maximum avec des moyens réduits : hommes motivés, compétents, entraînés, équipés, procédures rigoureuses, combinaison optimale des moyens, interopérabilité, capacité à agir en tous milieux sur l’ensemble du spectre allant de l’action psychologique à l’action de vive force. Pour faire face à des menaces asymétriques, multiformes, insolites, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot ni jouer en solitaire. Inspirons-nous de cet exemple qui n’est pas dépourvu de pertinence lorsqu’on évoque la lutte contre le terrorisme.
Pour en terminer provisoirement avec ces réflexions qui mêlent le sort de toutes les nations libres qui ont à subir les assauts du terrorisme, revenons-en à quelques idées simples.
L’Histoire est, dans une certaine mesure, une constante répétition de la lutte entre l’épée et le bouclier, entre le mouvement et l’immobilisme, entre les lumières et l’obscurantisme. Le naturel humain pousse vers ce qui demande le moins d’effort et expose le moins aux risques. Ce sont les circonstances d’exception qui poussent les organisations humaines à faire preuve d’imagination pour assurer leur survie. Ceci étant, il est rare qu’il n’y ait pas de solution à portée de main pour ceux qui savent regarder. Le plus difficile reste de changer de paradigme, de bousculer les habitudes ou les intérêts particuliers, de sortir des routines et des pratiques convenues. Pour encourager les plus paresseux, disons-leur que parfois l’innovation demande simplement de revenir aux fondamentaux. Ainsi, face au terrorisme pourrions-nous nous inspirer du 19e des fameux 36 stratagèmes chinois qui conseille, de façon imagée, de « retirer le feu sous le chaudron ».
Encore faut-il ne pas s’imaginer qu’il suffira pour cela de souffler dessus.
1Chef du United States central Command (commandement qui engerbe les théâtres irakien et afghan), parallèlement théoricien de la contre-insurrection.
24 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










