Etats généraux de la presse, un secteur sous pression
Ce jeudi 2 octobre à 11 heures, faisant suite à sa propre volonté, N. Sarkozy donnera le coup d’envoi des états généraux de la presse devant un parterre de patrons du secteur réunis au palais présidentiel. Les travaux devraient durer deux mois durant, sous la forme d’ateliers divers, afin de poser un diagnostic ainsi que d’apporter des solutions aux difficultés profondes qui caractérisent la presse en ce début de XXIe siècle. Modèle économique en déliquescence, crise de confiance et de défiance du public, montée en puissance exponentielle du monde numérique, tels sont les principaux défis à relever par une presse moribonde.
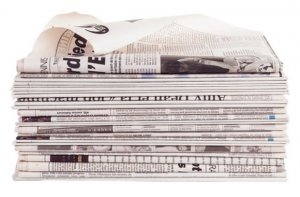
Le moins que l’on puisse écrire, concernant cet événement premier du genre, c’est qu’il va falloir convaincre tant l’unanimité attendue n’apparaît pas à l’ordre du jour, même si, sur le principe, tous les caciques du secteur s’accordaient à le juger indispensable.
Le chantier devrait être réparti entre quatre groupes de travail, chacun étant chapeauté par une pointure du secteur. Selon Frédéric Rey (AFP) la distribution des rôles se fera ainsi : « Arnaud de Puyfontaine (ex-PDG de Mondadori France) animerait les débats autour des aspects économiques et industriels, Bruno Patino (directeur de France-Culture et ancien vice-président du Monde) serait chargé du numérique, Bruno Frappat (président du directoire de Bayard Presse) de la réflexion autour du métier de journaliste et François Dufour (fondateur du groupe Play Bac Presse) de la question presse et société. » Si la pertinence des thèmes ne se discute pas, ce sont les personnalités animant les débats qui font grincer des dents.
Le ton était donné par le SNJ-CGT, la centrale de dénoncer la mainmise par les patrons sur les débats, décrédibilisant de fait la manifestation qui ne pourra accoucher que d’une souris sur le fond, alors que dans la forme devrait s’accentuer une concentration pourtant déjà bien avancée dans le secteur.
En arrière-plan, c’est aussi le monopole du syndicat du livre qui risque d’être remis en cause tant il est synonyme pour certains d’un archaïsme insupportable. La lutte s’annonce fort âpre sur cet aspect du problème, l’histoire étant fortement ancrée dans ce champ de la profession. Force est de constater qu’en l’état, il sera très difficile de revenir sur un modèle qui repose depuis pratiquement 75 ans sur un monopole. On se souviendra ainsi de l’apparition mouvementée des quotidiens gratuits en 2002 qui auront dû faire face à des manœuvres d’intimidation de la part de certains membres du syndicat du livre.
Concentration d’un côté, monopole de l’autre, mais c’était sans compter sur la démocratisation massive et foudroyante de la technologie internet qui aura porté un véritable coup de grâce à une presse plongée dans une crise qui pourtant était déjà latente [1]. L’apparition des ondes radio et de la télévision avaient déjà entamé la suprématie d’une presse écrite, seule source d’information en des temps reculés.
Ainsi, le développement de la toile, puis du web 2.O, auront modifié en profondeur les pratiques du consommateur en quête d’informations, tous domaines de connaissance confondus. En effet, le coût d’une connexion haut débit est équivalent à celui de l’achat d’un quotidien pendant un mois, l’infinillimité en plus. La concurrence se situe désormais ici, et il n’est qu’à voir la réactivité de tous les titres, chacun ayant désormais son propre site internet, par ailleurs véritable auto-concurrence, mais pouvait-il en être autrement ? [2]
Alors, on évoque la faiblesse du réseau de distribution autant que le coût de la presse comme causes essentielles du déclin, et de proposer différents remèdes pouvant pallier ces failles. Par exemple, il serait question de développer le portage à domicile, solution quasiment risible tant elle apparaît en décalage avec la réalité dessinée par le monde numérique. Solution d’un autre siècle s’il en est. De même, la multiplication des points de vente, économiquement non viables, ne pourra aucunement endiguer le phénomène tant le raz-de-marée est immense, incommensurable, et irréversible [3].
Alors, si elle veut survivre, la presse devra démontrer son côté irremplaçable, unique, indispensable en rendant un service que le lecteur ne trouvera pas en ligne.
C’est ici le point essentiel, et il n’est que le qualitatif pour cela. C’est sur ce registre que doit jouer la presse, chaque titre devant exiger que la qualité de la ligne éditoriale soit indiscutable, véritable pierre angulaire de la réussite dans l’avenir. Un journal, qu’il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, devra trouver sa propre niche composée de lecteurs fidélisés car devenus dépendants d’un titre qui leur apportera un produit différent de ce que le réseau internet pourra faire, tant dans la forme que sur le fond.
L’évaporation du lectorat des quotidiens a eu lieu, le reconquérir sera chose quasi impossible, alors que maintenir un volant incompressible de lecteurs assidus reste chose envisageable. A cette fin, il est évident que le journaliste demeure la pièce maîtresse de l’édifice futur, ce dernier devant apporter une réelle plus-value grâce à un travail qualitatif novateur, où le talent le disputera à l’éthique. Il faut pour cela que la confiance soit renouée avec le « consommateur d’information » en garantissant l’indépendance totale d’une presse quotidienne redevenue accessible en termes de prix, et unique au niveau de l’analyse et des décryptages proposés.
Aussi, il faudra bien se faire à l’idée que de profonds changements sont en cours, et cela du simple fait d’une évolution technologique irréversible, et désormais quasi entropique avec son entrée dans l’ère du numérique. Le débat sur le journalisme citoyen qui fait rage illustre diablement le sujet en s’invitant dans l’arène [4].
A terme, même si dans l’immédiat sa disparition n’est pas d’actualité, n’est-on pas en droit de nous demander si le support papier en matière de presse ne tendra pas à disparaître, ce fait culturel ayant été éradiqué par des pratiques exclusivement numériques désormais culturellement sédimentées [5]. Mais il serait étonnant que les états généraux de la presse actent cela.
[1] La concentration des médias en France, une réelle exception culturelle ? Actes de la journée thématique organisée au Sénat le 9 juin 2005
[2] http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/tessier/rapport-fev2007.pdf
[3] Comment sauver la presse, Institut Montaigne
versus Acrimed
[4]http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=20943
[5] Jean-Marie Charon, ingénieur d’étude au CNRS, spécialiste de la presse.
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










