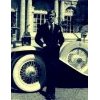HADOPI : justification morale de la contrefaçon
Si j’en crois les élégies tragiques des supporters d’HADOPI, j’en suis pour mes frais. Avec Luc Besson, je suis un voleur. Avec Thomas Dutronc, je suis commissaire du génocide musical. Avec tous les barons de l’industrie musicale, je suis penaud de mon manque de savoir-vivre, moi qui ne reconnaît pas la culture à sa juste valeur, qui considère même qu’elle n’a pas de prix, faisant crever des millions d’artistes qui ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. Oui, vous le sentez poindre, le jugement moral : « Je ne dois pas m’approprier gratuitement le travail d’autrui », à copier 100 fois (m’en fous, sur ordinateur, en un copié-collé, c’est torché).
Et pourtant, je vais poser cette hypothèse simple : on peut justifier moralement le fait de télécharger illégalement.
Le paradoxe de l’action collective
Ni plus, ni moins, la loi HADOPI nous met en face de la théorie du contrat. On veut se procurer un bien (culturel), qui a un prix. L’échange prix-bien constitue le moment contractuel. Or, dans un système collectif comme l’est celui d’Internet et des réseaux peer-to-peer, la tendance naturelle de tout utilisateur est de vouloir obtenir le bien sans en supporter le coût.
Ce paradoxe de l’action collective a été mis en lumière par Mancur Olson dans les années 60 à partir de situations économiques et notamment de l’action des syndicats : c’est la logique du free rider. Un syndicat lutte pour un bien collectif (augmentation, retraites, etc) et requiert pour cela une participation de ses membres. Or, dans la mesure où le bien collectif obtenu reviendra à tous indépendamment de leur participation à l’obtention de celui-ci, le calcul rationnel de chaque individu sera de se défausser de sa participation à l’obtention du bien collectif et de recevoir le fruit de la participation des autres. Quand un syndicat se bat pour une augmentation et l’obtient, celle-ci s’applique à tous les travailleurs d’un secteur d’activité donné : pourquoi donc supporter les coûts individuels (financiers et humains) de l’action syndicale quand les autres peuvent le faire pour vous ?
Appliqué au téléchargement illégal, la logique fonctionne de la même façon. Il existe un bien (l’album, le DVD), et des coûts pour l’obtenir (débourser 15 ou 20 euros). Or, l’obtention du bien avec les réseaux peer-to-peer est dissociable des coûts pour l’obtenir : c’est le téléchargement. Pourquoi supporter des coûts individuels quand on peut avoir le bien gratuitement (sans payer et sans se déplacer) ? En outre, si l’on considère que dans l’acte d’achat du bien culturel réside non seulement une volonté d’acquisition personnelle du bien (écouter son CD), mais en plus une logique de bien collectif (participer à l’essor d’une culture nationale ou récompenser des artistes), le paradoxe de la logique de l’action collective fonctionne encore mieux : pour obtenir le bien collectif (récompenser les artistes et soutenir la culture nationale), je dois engager des coûts individuels ; par calcul rationnel, je préfère obtenir ce bien collectif (la satisfaction chauvine que mon pays est puissant culturellement) en me reposant sur les autres (les idiots qui continuent d’acheter des CD et des DVD).
Incitation sélectives
Revenons à Olson. Pour enrayer la logique individualiste et rationnelle, il faut casser le lien entre le bien collectif et les coûts individuels. A partir du moment où les coûts que l’on engage sont personnels, le bien ne peut pas être collectif, sans quoi la tendance naturelle pour qui fonctionne par calcul sera toujours d’en faire le moins possible, mettant ainsi en péril l’obtention même du bien : si dans un groupe donné tout le monde est rationnel, alors personne n’agira, et donc le bien ne sera pas obtenu. Il faut ainsi mettre en place ce qu’Olson nomme des « incitations sélectives », c’est-à-dire des raisons valables qui poussent chaque individu à engager les coûts individuels nécessaires à l’obtention du bien commun. Pour Olson, ils sont de deux types : coercitifs et incitatifs. Pour forcer un syndicaliste à être actif, vous pouvez le frapper d’amendes ou exercer sur lui une pression psychologique (dénigrement, menaces, etc). Mais vous pouvez aussi lui faire miroiter des biens individuels qui récompenseront son engagement en plus de l’obtention du bien collectif (promotion interne, valorisation auprès du groupe, etc). Dès lors qu’on use de la carotte et du bâton de manière individuelle (je doute que la coercition collective de type consigne générale fonctionne vraiment), on casse la logique du calcul rationnel, ou plutôt on lui ajoute une nouvelle donnée, qui tend à motiver l’individu vers l’action.
En outre, la communauté des téléchargeurs étant par nature anonyme, gigantesque et sans lien entre ses membres, le phénomène de pression sociale y est absent. Dans les petits groupes, le regard que chacun porte sur autrui agit comme un censeur des velléités de free riding : c’est l’exemple du village où tout le monde se connaît et où agir à l’encontre du bien commun vous exclut du groupe par les ragots qui circulent ou tout autre manifestation d’hostilité, agissant comme un contraceptif efficace et vous poussant vers l’action collective. Sur la toile, l’internaute est désinhibé, parce que le gendarme est au pire absent, au mieux invisible. La logique du calcul rationnel est alors complètement pure et non biaisée.
Punir et allécher
Dans HADOPI, ce sont ces deux logiques qui s’opposent.
Il y a d’abord ceux qui plaident pour de la répression à outrance, jusqu’à la suspension de l’abonnement à Internet. Plus d’Internet, plus de fraude. C’est une logique assez sommaire, et très nombreux sont ceux qui déclarent très justement que ce sera globalement inefficace. Le dispositif d’HADOPI est non seulement bancal techniquement, mais je doute qu’en plus il y ait une véritable peur du gendarme. A tel point que je vois bien s’organiser sur Internet des mutuelles de la fraude : chaque participant versera une cotisation et continuera à télécharger illégalement, et l’on puisera dans la caisse commune pour payer les amendes auxquelles la justice condamnera les contrefacteurs. En termes de calcul rationnel, le ratio sera très vite trouvé, et cela fera baisser le coût du bien culturel à des prix plus qu’hard discount.
Il y a ensuite ceux qui considèrent qu’il faut justifier la valeur du bien aux yeux de l’acheteur pour l’inciter à ne pas se le procurer gratuitement. Ici, l’action porte sur deux tableaux. Le premier est sur le plan de la valeur. On ne répètera jamais assez que les maisons de disque, préoccupées par la recherche d’amortissement et de profit sur du très court terme, privilégient les soupes culturelles, des usines à tubes jetables. La logique du Kleenex a été bien comprise des internautes : je télécharge, j’écoute, je partage, je jette. C’est ce que font les maisons de disque avec les artistes. Pour enrayer le phénomène, il faut que les consommateurs aient envie d’acheter. Cela passera par une meilleure offre artistique, mais aussi par un packaging différent. Aujourd’hui, la formule boîte-CD-livret (avec de grandes disparités dans la composition des livrets) ou la formule DVD-bonus, s’essouffle : il faut que chaque bien ait une plus grande valeur aux yeux de celui qui est susceptible de l’acheter. L’industrie du disque qui est prompte à s’étrangler des phénomènes de gratuité se fait une très haute idée de la valeur de l’offre qu’elle propose.
Le second tableau est typiquement olsonien : donnons au consommateur un bien unique ! On ne répètera jamais assez que l’évolution des supports est nécessaire et que, si les consommateurs achètent moins de biens culturels sur supports matériels, ils continuent cependant à aller au cinéma et dans les concerts. Là-bas, ils sont susceptibles de vivres des expériences culturelles individuelles, qui ne sont pas avec la technologie actuelle disponibles par le téléchargement. Même avec la meilleure sono du monde, rien ne remplacera jamais le concert en live. Etrangement, les maisons de disque et les boîtes de production cinématographique ont encore du mal à augmenter leur offre en marketing one-to-one. Si les produits culturels sont standardisés, qu’on ne s’étonne pas que l’on préfère avoir gratuitement la copie du voisin ! Les rencontres entre les fans et leur idole, les showcase, les concerts privés, la figuration dans les films ou les invitations aux festivals et cocktails… Les occasions de couplage achat-récompense sont incommensurables pour l’industrie de la culture, qui en reste à un modèle complètement éculé !
L’acteur rationnel est un bien précieux
Plutôt que de diaboliser l’acteur rationnel qui préfère se procurer gratuitement ce qu’on voudrait lui faire payer, il vaudrait mieux le considérer comme un régulateur du marché culturel. Je suis absolument frappé de voir à quel point l’adage qui veut que le client soit roi et que le marché soit tout entier à l’écoute de ses comportements et de ses habitudes soit à ce point battu en brèche sur la question d’HADOPI. Je croyais les grandes industries, toujours ingénieuses en matière de marketing, beaucoup plus créatives et résilientes. Les nouveaux comportements ne sont pas immoraux en eux-mêmes : ils sont rationnels. Et on adressera le même compliment aux grandes entreprises audiovisuelles qui préfèrent embaucher des intermittents à moitié payés par l’UNEDIC pour un travail de pro. Ou à toutes les autres entreprises qui préfèrent occuper certains départements ou certains métiers par un roulement incessant de stagiaires afin de réduire drastiquement leur masse salariale. Si ces grandes industries veulent être libérales, qu’elles jouent le jeu du libéralisme à fond. Ou alors qu’elles acceptent que la resquille soit partout traquée et endiguée, de la contrefaçon qui leur fait perdre un peu d’argent (encore faut-il prouver que tout bien téléchargé serait un bien acheté si le téléchargement n’existait pas) aux filouteries avec le droit du travail.
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON