La décrépitude de la presse : grandeur et décadence
Il y a des jours où on tombe sur une pépite, un papier bien senti qui met des mots (maux) sur ce qu’on ressent, sur les petites choses qui nous font détester notre environnement professionnel. Tant de bêtises, de complaisances crasses, de médiocrité. Philippe Thureau-Dangin, ancien directeur de Courrier international et ancien président de Télérama, nous donne un rayon de soleil.
Auteur d’une analyse pertinente sur la grande misère de la presse, il nous force à nous interroger sur l’évolution des media ces cinquante dernières années. Avant – oui je sais… c’était mieux avant – on parlait de L’Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, le Nouvel Observateur (pardon… L’Obs…) de Jean Daniel, Le Monde de Hubert Beuve-Méry, de grands noms du journalisme comme Albert Camus. Et j’en oublie sans doute. Or, aujourd’hui, les nouveautés comme Rue89, cherchant à s’extirper de la nasse, sont in fine cannibalisées par les rentiers en mal de nouveauté (l’Obs) et voient poindre la déshérence. Une fin à la Libé peut-être, devenu une succursale de L’Express, bien loin des rêves de Jean-Paul Sartre.
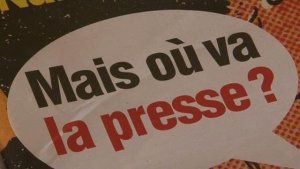
Massification, standardisation et consanguinité du journalisme
Cette évolution de la presse a plusieurs raisons, sociologiques notamment. En effet, en 50 ans, le recrutement des journalistes a changé. Il existe même un double processus. Premièrement, il y a un nombre incalculable d’écoles de journalisme et donc une standardisation des méthodes, une popularisation de ces cursus. Bref, une sorte d’égalitarisme dommageable pour la qualité des productions. N’en déplaise aux bien-pensants, le bâtonnage de dépêches semble la norme.
En outre, pour ce qui est de l’information politique, il y a une concentration sociologique plus que dommageable, comme l’explique Philippe Thureau-Dangin : « à Paris, cela a été maintes fois souligné, où se concentrent toutes les élites dans quelques arrondissements, la consanguinité est chose redoutable. Les journalistes, souvent issus des mêmes lycées et des mêmes classes préparatoires que les politiques, mais moins brillants souvent que ces derniers dans la suite de leurs études, ont bien du mal à ne pas être de connivence ». De plus, chose importante, les classes sociales dites de droite voient plus leur rejeton embrasser une carrière dans la finance, les nouvelles technologies… plutôt qu’un métier artistique ou dans les media. D’où l’estampille ‘de gauche’ du métier.
De fait, il est difficile de ne pas voir que le positionnement social du journaliste – à l’image de celui des instituteurs et professeurs, voire des responsables politiques (notamment les maires) ou encore le clergé – s’est dégradé. Et on ne parle pas que des feuilles de salaire. Autrefois vigie démocratique, le journaliste est dorénavant décrié, à tort ou à raison. Le milieu a évolué. Avant, le journalisme représentait une certaine élite, une certaine noblesse. Il y avait des intellectuels, des penseurs à l’image d’Albert Camus, irrigués des idées de la Résistance, du combat contre le fascisme. Tout ceci s’est étiolé au fil du temps. Et Philippe Thureau-Dangin de déplorer ce formatage et le manque de style de la presse française. « La France pourtant avait une tradition de presse politique et littéraire, engagée et brillante, qu’elle a eu bien tort d’abandonner au profit de je ne sais quelle objectivité ». Pour un pseudo fact-checking à l’anglo-saxonne ? Pour quelles réussites ?
Où est la presse de qualité ?
Il y a pourtant un paradoxe : il n’y a jamais eu autant de titres de presse. Mais sur le « cœur de métier » qu’est l’information générale/politique, c’est le néant. Il suffit de regarder les ventes de la presse magazine payante et de la PQN. Les Français sont plus intéressés par TV magazine que les journaux d’information… Et évitons d’aborder le sujet des aides publiques à la presse, tant papier que numérique. Les caisses de l’Etat sont pourtant vides ?
La presse d’analyse se délite : baisse des capacités d’analyse et de traitement, baisse du nombre de correspondants… La crise (mais elle a bon dos la crise !) oblige à faire muter son métier. Les journalistes sont devenus des hommes/femmes à tout faire : le JRI prend l’image, le son, fait l’interview… certes facilité par la révolution technologique. Bien sûr, cela amène une meilleure productivité mais paradoxalement, le contenu baisse. En effet, d’un autre côté, le journaliste ne peut pas faire de l’investigation, de la recherche documentaire… Il ne peut que faire confiance à la source, sans la connaître. Sans oublier la course à l’image, au buzz, avec des dérapages regrettables. On tend le micro et le « témoin » débite son discours sans qu’un professionnel ne le contredise, vérifie les faits. N’est-ce pas BFM ?
Par ailleurs, Internet, THE media par excellence, donne une capacité sans égale à avoir de l’information en tout temps et tout lieu, ce qui n’existait pas avant. Qui peut dorénavant croire, aujourd’hui, à cette analyse convenue de certains journalistes installés, qui pensaient qu’Internet ne remplacerait jamais les journaux comme vecteur d’influence ? Toutefois, cela décuple les effets pervers de la course à l’audimat. De plus, Internet renforce les phénomènes de désinformation et de manipulation, laissant libre cours aux délires paranoïaques de certains : il est bien facile de créer son blog et de propager sa haine, de manière anonyme.
Parallèlement, comme le note Philippe Thureau-Dangin, « aujourd’hui, on ne cherche plus à se faire une opinion, à analyser, à peser les choses pour juger, mais on cherche d’abord à savoir ce qu’il faut penser, ce qu’il faut dire avant que les autres ne le disent ». Et de rajouter, « nous ne sommes donc plus face à une presse politique mais face à une presse du commentaire ». Comment s’étonner, dès lors, du succès de la presse marquée aux extrêmes, droite évidemment, celle de gauche ayant disparu. Il n’y a qu’à regarder les chiffres : 10% de croissance pour Valeurs Actuelles pour 2014-2015, un tirage passant de 88 000 exemplaires en 2012 à 117 000 en 2014. Et on attend un autre carton en 2015… En attendant la présidentielle de 2017.
C’est quoi être journaliste ?
Ainsi, le journaliste comme symbole a vécu, malheureusement. Qui connaît le prix Albert Londres aujourd’hui ? Qui en connait la symbolique ? Qui, d’ailleurs, connaît ce journaliste, son histoire, ses origines et ses valeurs ? En creusant, on se pince de voir certains ‘journaux’ être des usines à pigistes, soutiers bien commode d’une profession en dépérissement.
Actuellement, on ne cherche pas à croiser l’information mais plutôt à évaluer le buzz, le nombre de clic et de retweets… Quel questionnement sur le contenu ? Si on recherche le buzz, il faut être dans un format court, facilement « viral » sur Twitter, Facebook. Sans parler des supports spécialement dédiés aux annonceurs. M, le magazine du Monde, est un exemple navrant, gavant ses lecteurs de publireportages pour les groupes de luxe. Quelle utilité, mis à part pour quelques lecteurs parisiens ?
Il y a également des interrogations à avoir – et à poser – sur le traitement médiatique de sujets importants. On pointe là le débat idéologique en cours sur la place des media et de la presse dans la démocratie. Et on espère que ce débat soit moins réducteur que le simple conflit gauche/droite, nous permette sortir de l’analyse binaire voulant qu’une mosquée attaquée, c’est une info, et qu’une église incendiée, c’est un fait divers. Mais difficile de sortir de ce tropisme, sans parler de l’autocensure sociologique. Or, si on ne le fait pas, cela renforce l’éclatement de la société. Choix cornélien…
Après, on peut toujours sombrer dans l’introspection, comme le fait Johan Hufnagel, directeur délégué de Libération. On peut toujours répéter à l’envi que « la richesse de Libé, c’est son identité », mais c’est un peu comme ces entreprises cibles d’une OPA qui vous expliquent que la chose est impossible car la culture d’entreprise n’est pas la même que l’assaillant… Décidemment, en France, le principe de réalité a du mal à vivre. La méthode Coué est tellement réconfortante.
Le métier est foutu ?
Philippe Thureau-Dangin le dit très clairement : « les médias ne sont qu’un miroir assez fidèle de la société française, une société qui doute et semble paralysée ». Comment, dès lors, sortir du triptyque de la misère intellectuelle, politique et économique ? Et le crowdfunding ne sauvera que les apparences : ce financement participatif ne marche qu’une fois.
Cela ne veut pas dire que le journalisme est mort. Seulement en mutation, et seule la qualité prévaudra à terme, pour qui veut être un media d’influence. Et les critères sont connus, à la fois qualitatifs (porter des idées dans le débat public, publier des enquêtes…) et quantitatifs (nombre de ventes, abonnés, construction d’un business model et d’un écosystème économique solide…).
Certes, des personnes s’interrogent sur leur avenir, à l’image du Comité Orwell, créé à l’initiative de Natacha Polony et d’Alexandre Devecchio. L’ambition est de faire vivre le débat d’idées, sans être anesthésié par le politiquement correct. Et de pointer du doigt la ‘déspécialisation des journalistes’, devenus des généralistes de l’information. Un bon début finalement.
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










