Médias, service public et publicité
Pour ou contre le retour de la publicité sur le service public ? Le débat fait rage et rares sont les politiques qui osent affirmer leur position. Une question qu’il faut pourtant se poser tant l’audiovisuel public se retrouve enfermé dans un état dichotomique, balloté entre deux concepts divergents d’économie des médias. Alors, autant l’annoncer clairement, je penche pour la suppression totale de la publicité sur Radio-France et France-Télévisions. Une position parfois difficile à assumer. Donc avant de me faire ramasser, voici quelques éléments de réponse. Loin des idéologies politiques, il est simplement question ici de remettre en cause le système public audiovisuel en lui-même ; l’opinion d’un simple citoyen sur un débat-média public, donc.
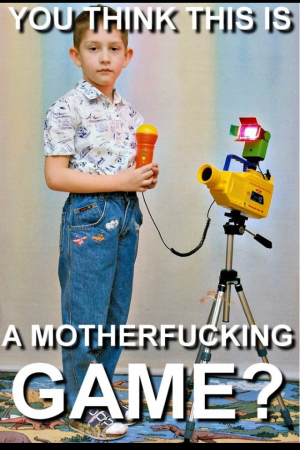
Les formes plurielles du tout.
Dans l’univers généralisé des médias de masse, trois secteurs médiatiques cohabitent. Mon premier épouse des structures entrepreneuriales, là où produire de l’information s’axe sur une obligation de rentabilité ; c’est le secteur privé. Mon second représente une sorte de « délégation informationnelle » étatique qui concoure au service général du « faire connaître » ; c’est le modèle public. Mon dernier œuvre dans une mission non lucrative par des subventions ou autres fonds de soutien ; c’est le secteur associatif. Pour illustrer les ramifications de l’arbre médiatique et initier ce contexte polémiste, retournons aux prémices du paysage audiovisuel en comparant deux branches radiophoniques particulièrement représentatives : l’exemple des radios américaines et anglaises.
Le modèle Américain est libéral, essentiellement privé. Une culture du média économique qui prend sa source dans les premiers pas du journalisme audiovisuel, car à ce moment, seules les riches entreprises avaient les moyens d’investir dans la technologie de diffusion. La production s’associe donc de fait avec les logiques industrielles de marché et d’audience : une rentabilité assurée par des financements privés et - pour éviter une éventuelle production à perte -, par la publicité. Ici, le média est une entreprise, l’état ne s’investit pas, sauf par quelques organismes publics de contrôle, comme la Federal Communications Commission qui veille au respect des règles de contenus et de concurrence.
De son côté, le schéma anglais s’est développement en suivant les mêmes méthodes jusqu’à ce que finalement, l’État charge les entreprises médiatiques de se réunir dans une union nationale de développement. La BBC devient ainsi rapidement une compagnie publique (dès les débuts des années 1920), la publicité est supprimée, le secteur privé est remercié alors que les dirigeants sont nommés par la couronne - une organisation administrative publique finalement assez commune. Les stations et chaînes de la Broadcasting British Corporation se transforment en une mission nationale censée promouvoir le patrimoine culturel ou les programmes éducatifs. Encore aujourd’hui, la diffusion se fait sans aucune interruption publicitaire.
Source : Cheval, J.-J., Les radios en France. Histoire, état et enjeux.
Confusion et mauvais alliages.
En France, on aime le mélange des genres, ou les modèles particulièrement déconstruits. En fait, nous nous représentons mal l’importance d’une séparation claire entre secteurs publics et privés et floutons les engagements publics dans leurs missions envers la communauté, « la puissance publique ». Car France-Télévisions et Radio-France sont bien des entreprises publiques, dont les objectifs sont sociaux (donc non lucratifs) et se tournent uniquement vers une offre destinée aux publics. Un acte démocratique exempt de toute logique économique : chaque citoyen a le droit d’être informé, à l’État de garantir la mise en œuvre d’un média pour tous. Une action en faveur de l’intérêt général. Point. Cette mission s’ancre alors dans un contrat d’ordre public qui a pour fonction principale d’assurer un service d’information généralisé ; d’autant que ce service, vous le financez avec vos impôts par la redevance audiovisuelle. A cet instant, il me semble qu’à aucun moment, l’administration publique puisse être polluée par des logiques commerciales. Il en va de l’assurance d’une information certes politique, mais non-commerciale (c’est déjà ça).
Loin de moi toutes les idéologies de l’État-providence. Seulement, force est de reconnaître que l’hypothèse d’une suppression totale de la publicité sur le service public apparaît tout à fait défendable. Car d’une manière générale, quand on situe l’action de l’État dans les affaires sociales, on l’affirme sans marier les intérêts publics aux intérêts privés. Et c’est valable pour tout : les organismes publics sont une nécessité et non une source de profits, quels qu’ils soient. Imaginez un instant que votre préfecture soit financée par des entreprises, que l’hôpital public soutienne des campagnes promotionnelles privées ou que l’école de vos enfants introduise des publicités dans ses salles de classe. Une affiche Coca au dessus du tableau noir, une annonce audio Peugeot dans la salle d’attente… Vous trouveriez ça étrange ! Alors, pourquoi le sort des médias publics serait-il différent ?
Les répercussions d’un tel modèle médiatique disharmonieux sont lourdes de conséquences. D’abord, la confusion des schémas est telle que l’idéologie de médias pluriels s’efface. Le système est désorganisé, voire inégal ; il réclame des statuts clairs et particulièrement transparents - ce qui, dans l’état actuel des médias publics, n’est pas le cas. La redevance, contribution des citoyens au développement de leur support d’information, cette fiscalité imposée à tous les français n’a plus de sens si les ressources des chaînes et stations publiques sont dégagées en externe. Indirectement, c’est aussi le problème de la concurrence qui se pose. Comment les autres chaines, y compris les dernières arrivées de la TNT, pourront rivaliser sur le terrain des programmes quand certains de leurs concurrents bénéficient de surcroît d’une aide publique ? Admettez que le concept soit un peu déloyal.
Et pardon, mais il faut bien démolir l’argument de l’émancipation financière, car tout journaliste a le devoir de dégager son exercice des contraintes économiques du support médiatique pour lequel il officie. L’indépendance de la profession n’est plus à prouver : malgré des financements publics, l’amalgame monopolistique du service public est menteur, au même titre que le Ministère de l’Information n’existe plus. Dans toutes les rédactions, les professionnels savent se dédouaner et négocier avec les propriétaires de leurs groupes, épaulés par une hiérarchie, des syndicats et des sociétés de rédacteurs, soutenus également par une législation qui a depuis longtemps fixé l’autonomie de leurs statuts.
Différencions toujours et encore la vente de la vocation, et le commerce du service public. Les deux ne peuvent plus cohabiter, nous risquerions trop de court-circuiter à terme l’équilibre du système social des médias, déjà pas mal affaibli ces dernières années. Pour sauver l’audiovisuel public français, je crois que nous devons redéfinir les frontières médiatiques : entre les recettes privées et la redevance, entre le public et les entreprises, il va bien falloir choisir. Voilà, je suis favorable à un paysage médiatique français pluriel et cohérent. Efficace, en somme. Sans omettre les difficultés de Radio France ou France-Télévisions à subvenir à leurs besoins sur le simple budget accordé par l’État, il reste néanmoins important de questionner les modes de subvention comme ses dépenses. En majeur partie, ce travail consistera à re-centraliser les ressources des médias publics, quitte à se séparer de France 3, chaîne la moins populaire du PAF et pourtant la plus couteuse. Une opinion peut-être tranchée, mais qui se positionne finalement pour un réajustement des valeurs du service public audiovisuel.
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 , mais mon domaine c’est la sociologie. J’aime échanger avec les autres disciplines car ça me donne toujours des idées nouvelles, et je n’ai pas la science infuse. Merci pour ta référence à Francis Balle, que je ne connaissais pas. Je visionne en ce moment une interview de monsieur, datant de 2010, intitulée « les médias vont changer le monde ! » vue à partir de
, mais mon domaine c’est la sociologie. J’aime échanger avec les autres disciplines car ça me donne toujours des idées nouvelles, et je n’ai pas la science infuse. Merci pour ta référence à Francis Balle, que je ne connaissais pas. Je visionne en ce moment une interview de monsieur, datant de 2010, intitulée « les médias vont changer le monde ! » vue à partir de 
