Alain Peyrefitte, le diplomate normalien au service du gaullisme académique
Diplomate, écrivain prolifique, homme politique au plus près du pouvoir, Alain Peyrefitte était un touche-à-tout rigoureux, à la fois fin observateur et acteur déterminé.

Il y a dix ans, le 27 novembre 1999, Alain Peyrefitte quittait ce monde. Homme de culture et de lettres, Alain Peyrefitte fut, avec Jean Lecanuet, parmi les personnalités politiques majeures des années 1960 à 1990 à avoir conservé une mauvaise réputation. Pourtant, Alain Peyrefitte fut un personnage original et constructif qui accompagna les premiers émois de la Ve République.
Un diplomate éclairé
Alain Peyrefitte est né le 26 août 1925.
Malgré sa mère qui fut hostile à l’institution religieuse, il se convertit au catholicisme et passa après le baccalauréat une année chez les dominicains dans un couvent corse. Pendant cette période de retraite, il écrivit son programme de vie avec une troublante précision : « 1948-1958 : vie diplomatique ; 1958-1968 : vie politique ; 1968-1978 : vie littéraire ».
Gabriel de Broglie étudia son caractère ainsi : « Alain Peyrefitte reste un émotif secret, un penseur absorbé. Entre des vocations qui paraîtraient s’exclure, il hésite à choisir, ou plutôt, son choix est de ne pas choisir. Est-ce un trait de son caractère, le sentiment d’un destin ? La vie se chargera de trier. ».
Il fut dès lors élève de Normale Sup. puis docteur d’État en lettres et sciences humaines. Après avoir échoué l’année précédente, il fit partie de la deuxième promotion de l’École Nationale d’Administration (ENA) créée en 1945 par Michel Debré pour doter le pays d’une haute fonction publique compétente. Il se dirigea vers la carrière de diplomate.
Nommé à Bonn (en Allemagne) en 1949, il travailla avec Jean-François Deniau sous l’égide de l’ambassadeur André François-Poncet, père du futur ministre giscardien Jean François-Poncet. En 1954, il fut éloigné à Cracovie (en Pologne) comme consul de France où il excella dans son talent d’observateur de la guerre froide. En 1956, il regagna le Quai d’Orsay comme chef de service des organisations européennes et fit partie des négociateurs du Traité de Rome avec Jean-François Deniau et Georges Vedel.
Jeune cadre de la République gaullienne
Alain Peyrefitte fut gaulliste dès le 21 mai 1940, quand il a entendu le colonel De Gaulle parler à la radio et prédire la victoire finale des forces motorisées blindées. Mais il ne rencontra la première fois De Gaulle qu’en 1959.
Lors des premières élections législatives de la Ve République, Alain Peyrefitte fut élu député à 33 ans en automne 1958 en Seine-et-Marne après avoir échoué à la cantonale de Bray-sur-Seine au printemps (sans étiquette).
Député gaulliste de 1958 à 1995, constamment réélu sauf en juin 1981 (mais il fut finalement réélu en janvier 1982 à la suite d’une invalidation), puis sénateur de 1995 à 1999, il fut élu au Conseil général de Seine-et-Marne de 1964 à 1988 (vice-président de 1982 à 1988) et maire de Provins de 1965 à 1997 (c’est le futur ministre chiraquien Christian Jacob qui reprit sa succession à partir de mars 2001).
Sa grande connaissance des Affaires européennes et son dynamisme le fit rapidement remarquer auprès du général De Gaulle qui en fit un collaborateur très proche (trente-cinq ans les séparaient) jusqu’à en devenir ministre le 14 avril 1962, d’abord comme Secrétaire d’État à l’Information puis brièvement Ministre des Rapatriés puis de nouveau Ministre de l’Information jusqu’en 1966.
Dans "C’était De Gaulle", il écrivit la grande chance d’avoir été, pendant quatre années, le porte-parole d’un si grand homme : « Les figures de proue nous mettent à l’abri de la médiocrité. Elles fendent les flots incertains. Elles nous élèvent au-dessus de nous-mêmes. ».
L’information, domaine encore réservé
À ce poste, Alain Peyrefitte fut le grand intermédiaire entre De Gaulle et les journalistes. Il a créé l’ORTF qui fut le précurseur, entre autres, de Radio France, qui visait à moderniser et à libéraliser l’audiovisuel public. Cependant, ses passages à la télévision en tant que ministre pour dire ce que devrait être le journal télévisé en a fait le symbole d’une information à la solde du pouvoir. Les historiens diront si l’information était moins libre en 1965 qu’en 2009.
Après la réélection de De Gaulle, Alain Peyrefitte fut nommé le 8 janvier 1966 à la Recherche scientifique et lança le programme de dissuasion nucléaire français.
À l’issue des élections législatives gagnées de justesse, Alain Peyrefitte siégea le 6 avril 1967 au Ministère de l’Éducation nationale, qu’il dut quitter le 28 mai 1968 en raison des événements de mai 1968 (écouter ses déclarations au cours de la semaine des barricades).
Il ne revint au pouvoir qu’à la fin de la Présidence de Georges Pompidou. L’occasion pour lui, entre temps, de présider entre 1968 et 1972 la Commission des affaires culturelles et sociales de l’Assemblée Nationale, puis de diriger le mouvement gaulliste de 1972 à 1973 (comme secrétaire général de l’UDR, à l’époque, il n’y avait pas de poste de président).
Alain Peyrefitte, écrivain et essayiste
C’est pendant cette période où il ne fut plus au pouvoir qu’il tira les meilleures réflexions, notamment au cours d’une mission parlementaire en Chine en juillet 1971 (rapport n°2544 déposé le 1er juillet 1972 à l’Assemblée Nationale) où il comprit l’exceptionnel potentiel du développement économique chinois (il publia en 1973 son fameux livre "Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera").
Gabriel de Broglie livra en 2002 son analyse de l’écrivain : « Au-delà de l’action, derrière les actes, il y a toujours le livre. C’est dans l’écriture qu’Alain Peyrefitte trouve les ressorts de sa réussite : une abondance de formules heureuses, saisissantes, souvent redoublées et efficaces comme un tir serré d’arguments ; la multiplication des angles de vue comme l’œil de la mouche dont les facettes donnent l’impression du relief ; le découpage en séquences courtes et simples d’une écriture cinématographique ; une dialectique irrésistible ; un étincelant crépitement d’idées. Ces caractères s’apparenteraient à un procédé si l’auteur n’exprimait, par surcroît, un ardent amour de la langue française. C’est par là qu’il a conquis son public et par là que je me sens le plus proche de lui. Le service de la langue française a ceci de commun avec la religion qu’il n’est pas nécessaire d’y réussir pour s’y consacrer, ni d’y briller pour s’y plaire. C’est un culte dont voici le temple, qui était à l’origine une église. (…) Alain Peyrefitte manie la langue d’une correction parfaite, d’une clarté souveraine, qui ne fait qu’un avec la pensée. La littérature n’est pour lui ni introspective ni symboliste. Elle consiste en un travail d’écriture, une justesse d’expression et une fermeté de conception. Il livre une œuvre rédigée debout, au sens propre puisqu’il a toujours écrit sur un lutrin pour éviter d’être surpris par le sommeil et au sens figuré, c’est-à-dire une œuvre pour démontrer, pour convaincre. ».
Parmi ses mentors, André Gide fut l’un de ses auteurs fétiches, trouvant n’importe quel prétexte pour aller le rencontrer plusieurs fois.
Albert Camus le parraina chez Gallimard pour son premier essai "Le Mythe de Pénélope", écrit à 21 ans et récompensé par l’Académie française. Cet essai, selon Claude Lévi-Strauss, « découvre dans la confiance, au lieu de l’absurde, le secret de la condition humaine. Une tradition légendaire qui veut qu’Ulysse eût été engendré par Sisyphe. En glorifiant Pénélope, vous opposerez la bru au beau-père. » (il s’adressait à Alain Peyrefitte).
Le 6 juin 1976, six semaines avant sa mort, l’écrivain Paul Morand invita Alain Peyrefitte à déjeuner. Ils ne se connaissaient. Jean Guitton et Claude Lévi-Strauss firent partie des convives, le premier comme futur parrain d’une candidature à l’Académie et le second, celui qui le recevrait sous la Coupole le 13 octobre 1977.
Le 10 février 1977, c’est effectivement au fauteuil de Paul Morand qu’Alain Peyrefitte fut élu à l’Académie française. Il venait de publier "Le Mal français" (qui fut un grand succès commercial) où il analysait les blocages de la société française et notamment son pessimisme, un essai encore d’actualité selon l’académicien Jean d’Ormesson.
Entre son élection et sa réception, Alain Peyrefitte est redevenu ministre, situation inédite depuis 1718, et Valéry Giscard d’Estaing assista à la séance. La présence du Président de la République, protecteur de l’Académie française, est exceptionnelle dans ce genre de cérémonie.
Son livre, en trois tomes, "C’était De Gaulle" publié entre 1994 et 2000, est devenu un précieux et dense témoignage sur le général De Gaulle et la réalité de ses états d’âme en rassemblant près de cinq mille pages de notes personnelles prises lorsqu’il travaillait à ses côtés (C’est Pompidou qui l’encouragea à les publier).
Devenu un "baron" du gaullisme
Son retour aux deux derniers gouvernements de Pierre Messmer (après la victoire des élections législatives) fut très furtif, aux Réformes administratives le 5 avril 1973 puis à la Culture et à l’Environnement le 1er mars 1974 (un mois avant la mort de Georges Pompidou).
En baron gaulliste, Alain Peyrefitte fit partie des soutiens de Jacques Chaban-Delmas à l’élection présidentielle de 1974 face à Valéry Giscard d’Estaing, ce qui alimenta une forte inimitié envers Jacques Chirac qui consacra toute son énergie à la victoire de Giscard d’Estaing (qui lui concéda alors Matignon).
Paradoxalement, c’est lors de la démission de Jacques Chirac l’été 1976 que les mêmes barons gaullistes, menés par Olivier Guichard, légitimistes donc respectueux du Président de la République, se rapprochèrent de Valéry Giscard d’Estaing et contestèrent la virulente opposition de Jacques Chirac pendant le reste du septennat giscardien.
Les six premiers mois du gouvernement de Raymond Barre avaient placé Olivier Guichard au sommet des ministres gaullistes mais sa mission de coordination entre giscardiens et chiraquiens s’était avérée impossible depuis la candidature et la victoire de Jacques Chirac à la mairie de Paris, véritable camouflet pour le Président de la République qui en avait fait une affaire personnelle.
Alain Peyrefitte revint au gouvernement dans le nouveau dispositif de Valéry Giscard d’Estaing le 30 mars 1977, à l’issue des élections municipales.
Jusqu’à la fin du septennat, Alain Peyrefitte fut Ministre de la Justice (pendant trois ans) où son nom resta associé à la loi "Sécurité et Liberté" promulguée en janvier 1981 (et vite abrogée par le gouvernement socialo-communiste qui lui succéda). Il est intéressant de revoir un résumé des débats parlementaires du 10 juin 1980 où François Mitterrand s’opposa lui-même à Alain Peyrefitte (revoir un extrait ici). La dualité sécurité/liberté reste encore aujourd’hui un enjeu politique majeur.
Relations tendues entre Peyrefitte et Chirac
Les relations entre Alain Peyrefitte, premier des ministres RPR, et Jacques Chirac, président du RPR, furent de plus en plus conflictuelles.
Pour preuve, cette réunion le matin du 8 novembre 1977 au siège du RPR où (à quatre mois des élections législatives) Alain Peyrefitte piqua une colère contre Jacques Chirac : « Tout cela arrive parce que ici, rue de Lille, vous n’arrêtez pas de critiquer le gouvernement. Lorsque toi, Jacques, tu dis : dans ce gouvernement, il n’y a qu’une bande de chiffes, figure-toi que je n’apprécie pas. Et le Premier Ministre pas davantage ! Renonce à tes agressions, tu seras moins souvent agressé ! ». Jacques Chirac aurait alors ponctué : « Alain, tais-toi ! ».
La cassure irrémédiable avec Jacques Chirac a eu lieu lors de l’appel de Cochin le 6 décembre 1978 où Jacques Chirac (influencé par Marie-France Garaud dont il se sépara après son échec de juin 1979) accusait Valéry Giscard d’Estaing d’être le parti de l’étranger pour avoir favorisé l’élection des députés européens au suffrage universel direct (la première élection eut lieu le 10 juin 1979).
Ministre de la Justice
Un peu comme la cavale de Jean-Pierre Treiber, arrêté le 20 novembre 2009 après son évasion du 8 septembre 2009, Alain Peyrefitte a dû subir l’affront de l’évasion du criminel Jacques Mesrine le 8 mai 1978 (il fut tué par la police le 2 novembre 1979, trois jours après la mort de Robert Boulin).
En novembre 1979, le nom d’Alain Peyrefitte est en effet mêlé à la mort de Robert Boulin, son collègue du gouvernement, tous les deux en position d’être nommés très prochainement Premier Ministre après l’hospitalisation de Raymond Barre pour surmenage (voir son témoignage sur l’Enfer de Matignon).
Alain Peyrefitte n’a jamais été accusé d’avoir "assassiné" Robert Boulin (à l’époque, tout le monde parlait de suicide) mais d’avoir peu soutenu, avant la mort de celui-ci, son collègue accusé d’une malversation. Alain Peyrefitte ne voyait pas comment intervenir sur le cours de la justice (le juge chargé de l’affaire était Renaud Van Ruymbeke).
Le 17 novembre 1979, à l’occasion d’un débat sur les crédits de la justice à l’Assemblée Nationale qui a dévié sur la peine de mort, Alain Peyrefitte proposa de déposer « un texte révisant l’échelle des peines, c’est-à-dire, revoyant le problème des peines les plus importantes pour les crimes les plus importants » ajoutant : « On ne peut pas examiner le problème de la peine de mort séparément de l’ensemble de ces peines et de l’ensemble de ces crimes ; c’est une affaire complexe et le gouvernement refuse de se laisser entraîner à un vote simpliste. » (l’écouter ici). Ce projet de loi n’a, semble-t-il, jamais été déposé.
Alain Peyrefitte, giscardien
À l’élection présidentielle de 1981, Alain Peyrefitte, comme d’autres ministres gaullistes, soutint Valéry Giscard d’Estaing dès le premier tour malgré la présence de trois candidats gaullistes, Jacques Chirac, Michel Debré et Marie-France Garaud.
Le 9 avril 1981, Alain Peyrefitte reçut à Provins (ville dont il était le maire) le "citoyen candidat" Valéry Giscard d’Estaing pour un meeting qui fut suivi, le soir même par un autre meeting à Troyes, dont le maire était Robert Galley, autre ministre gaullo-giscardien (à la Défense).
Une occasion pour Alain Peyrefitte d’apporter clairement son soutien à Giscard d’Estaing qu’il considérait comme le seul héritier possible de De Gaulle et d’inviter les électeurs gaullistes à ne pas disperser leur voix sur Chirac : « L’héritage gaulliste a été maintenu et au prix de quels efforts ! (…) La vraie question est de savoir si notre République saura résister aux assauts de ceux qui veulent la détruire. Votre seul adversaire est celui qui a combattu le général De Gaulle. C’est la Ve République qu’il veut abattre ! » (parlant de François Mitterrand).
Cependant, le soutien trop tardif des gaullo-giscardiens au cours de la campagne du premier tour n’a pas permis de compenser les attaques permanentes des partisans de Jacques Chirac, ni de réduire le conflit entre giscardiens et chiraquiens, Jacques Chirac ayant joué la politique de la terre brûlée pour conquérir le leadership de la droite après la victoire de François Mitterrand.
Dans l’opposition
Bien que battu aux élections législatives de juin 1981, Alain Peyrefitte regagna brillamment sa circonscription après une invalidation et l’organisation des élections législatives partielles du 17 janvier 1982 (Bruno Bourg-Broc, Pierre de Bénouville et Jacques Dominati furent élus en même temps que lui), une mini-victoire électorale qui annonça la fin de "l’état de grâce" du pouvoir mitterrandien et l’amorce d’une reconquête du pouvoir par le RPR.
En 1983, Alain Peyrefitte prit la direction du comité éditorial du journal "Le Figaro" (corrigeant de façon très pointilleuse les écrits des journalistes politiques) ; au cours de son existence, il a collaboré avec de nombreux journaux : "Le Monde", "Le Point", "L’Express", "La Revue des Deux Mondes", "Commentaire", "La Nef", "Les Cahiers du Sud", "La Revue de Paris"… et fut élu à l’Académie des sciences morales et politique le 1er juin 1987.
À la mort de Raymond Aron, le 17 octobre 1983, l’écrivain académicien Alain Peyrefitte a évoqué cet « esprit universel comme il en existe peu », à savoir qu’il « embrassait de son regard toutes les spécialités à la fois » en affirmant ceci : « Son grand message, ce sera un message de liberté de l’esprit, c’est-à-dire, de refus de l’esprit de système. Il a combattu toute sa vie l’esprit de système, les idéologies, parce qu’elles plaquent une abstraction sur la réalité vivante. » (l’écouter ici).
Matignon ?
L’approche des élections législatives du 16 mars 1986 et la défaite prévisible des socialistes de François Mitterrand ouvrait une période nouvelle avec la cohabitation entre un Président et un gouvernement de bord opposé.
En 1985, dans un essai politique "Encore un effort Monsieur le Président", Alain Peyrefitte avait pris position en faveur de la cohabitation (comme Édouard Balladur et Jacques Chirac, et contrairement à Raymond Barre qui considérait que la cohabitation était contraire à l’esprit des institutions), et avait même laissé entendre qu’il ne serait pas opposé au fait d’être nommé à Matignon.
À l’époque, les premier-ministrables étaient nombreux, de Jacques Chaban-Delmas (ami de François Mitterrand) à Valéry Giscard d’Estaing en passant par René Monory ou encore Simone Veil, mais Jacques Chirac, qui avait verrouillé le jeu à son profit, fut naturellement appelé à former le nouveau gouvernement, en tant que chef du parti majoritaire.
Le 15 décembre 1986, Alain Peyrefitte fut directement visé par un attentat mortel revendiqué par le groupe terroriste "Action directe" qui détruisit complètement sa voiture. Un employé municipal de Provins de 51 ans, Serge Langé, y perdit sa vie. Cette explosion faisait partie d’une vague d’attentats très durs qui entraîna l’assassinat de Georges Besse (patron de Renault) le 17 novembre 1986 et de l’ingénieur général de l’armement René Audran le 25 janvier 1985 (entre autres). Alain Peyrefitte avait été auparavant le cible de deux tentatives d’attentat en raison de ses fonctions de Garde des Sceaux.
En retrait progressif de la politique active
Alain Peyrefitte quitta l’Assemblée Nationale pour le Sénat en septembre 1995. Il démissionna de sa mairie de Provins en 1997 et s’éteignit le 27 novembre 1999 dans le 16e arrondissement de Paris d’une grave et rapide maladie. Il venait de subir un terrible deuil par la perte de sa fille. Sa devise était : « Encore un peu plus oultre », dépassement de soi et volonté de perfection dans l’action.
Une personnalité plus conviviale qu’il n’y paraît
Son aspect très austère, ses sourcils sévères, sa bouche qui avait du mal à esquisser un sourire, et si sourire il y avait, il ressemblait fort aux grimaces de Louis de Funès, ne doivent pas faire oublier l’homme de très grande culture mais aussi l’homme affable.
Gabriel de Broglie, son successeur à l’Académie française, le décrivait ainsi : « Peut-on imaginer une existence plus riche de travaux et de lauriers que celle d’Alain Peyrefitte, normalien, énarque, chercheur, diplomate, député, ministre, écrivain, académicien, journaliste, chroniqueur ? » puis il évoquait « sa silhouette bien découplée, son vaste front, sous ses sourcils broussailleux son regard scrutateur, ses yeux qu’il plissait souvent, pour aiguiser son regard ou pour le retourner vers ses pensées, son sourire enfin, large et franc, mais qu’un léger déplacement des lignes pouvait rendre extrêmement volontaire ». Puis, parlant de ses rencontres professionnelles avec Alain Peyrefitte dans les allées du pouvoir, Gabriel de Broglie a « profondément admiré (…) le style qui présidait à la conduite des affaires de la France, style auquel le talent d’Alain Peyrefitte apportait une note de rigoureuse exigence et de haute qualité ».
Alain Peyrefitte prenait des notes tout le temps, avant et après ses rencontres. Il ne cessait de lire, même en marchant ou au bord d’un télésiège pendant ses vacances d’hiver, et écoutait la radio lorsqu’il faisait son jogging matinal au bois de Boulogne.
Sa culture était exceptionnelle. Il connaissait par cœur de nombreuses poésies françaises. Il correspondit en grec ancien avec le linguiste Georges Dumézil qui lui répondait en latin. Il entretenait des relations intellectuelles avec Maurice Clavel, Michel Foucault et Alain Touraine.
Je me souviens d’avoir écouté Alain Peyrefitte plusieurs heures dans l’émission du dimanche matin "L’oreille en coin" sur France Inter (je ne retrouve plus la date, entre 1984 et 1990), surprenant les animateurs par son humour de potache, racontant les quatre cents coups qu’il faisait avec ses camarades de Normale Sup. lorsqu’ils étaient étudiants.
Un homme qui fut un acteur majeur des débuts de la Ve République, de la même génération que Valéry Giscard d’Estaing, député précoce, diplomate fin et averti, écrivain reconnu et talentueux, une écriture incisive au service de la pensée, libre de tout système, fidèle aux idées de De Gaulle, mais aussi "Premier Ministre virtuel" à une ou deux occasions et une réputation de Garde des Sceaux strict et intraitable.
Voilà ce que pourrait avoir laissé Alain Peyrefitte dans l’histoire politique française.
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (27 novembre 2009)
Pour aller plus loin :
Notices institutionnelles d’Alain Peyrefitte.
Bibliographie sommaire d’Alain Peyrefitte.
Vidéos avec Alain Peyrefitte.
Éloge funèbre d’Alain Peyrefitte par Gabriel de Broglie.
Jean d’Ormesson sur "Le Mal français".
Discours de réception d’Alain Peyrefitte.
Réponse de Claude Lévi-Strauss.
Documents joints à cet article
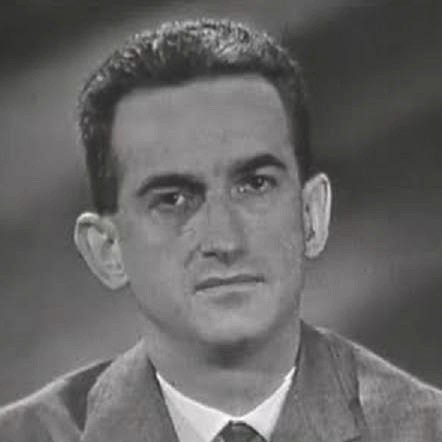

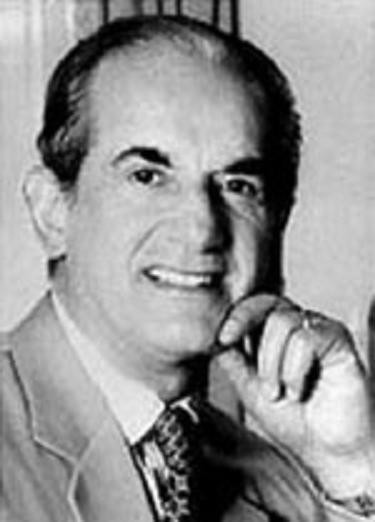
30 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










