Codéveloppement, la voie du centre
La nouvelle UDF a organisé, comme pour chacun des thèmes de son programme, un colloque ouvert au public sur le codéveloppement en y conviant ses acteurs : Union européenne, Etat français, Onu, ONG, élus des pays récipiendaires. La réflexion dégage trois principes du codéveloppement : favoriser la bonne gouvernance (“Il n’y a pas de famine en démocratie”), développer les partenariats entre entités locales (régions d’Europe et régions d’Afrique) et s’appuyer sur les réseaux des migrants (résidents et nationaux). naturalisés) pour une meilleure connaissance des besoins locaux et un contrôle de l’efficacité des aides. Compte rendu d’un observateur curieux.
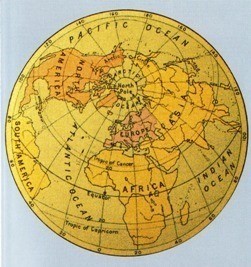
Le colloque a débuté par un rappel historique de l’aide française au développement par Jean-Michel Debrat de l’Agence française de développement (AFD), héritière de la Caisse centrale de la France libre, crée par de Gaulle pour gérer les ressources de la France en exil, notamment dans les colonies. Par la suite, cette Caisse centrale a eu pour mission de rendre effectivement l’indépendance des anciennes colonies, par la création des banques centrales pour chacun des Etats, de financer infrastructures et entreprises dans la zone Afrique et Méditerranée. Devenue AFD, elle est le pivot des aides françaises dans le cadre du Consensus européen sur le développement, texte qui engage autant la Commission européenne que chacun des Etats membres.
En termes de chiffres, l’aide publique au développement français se monte à 9 milliards d’euros, répartis comme suit : un tiers d’aides multilatérale : Union européenne et Onu, un tiers d’annulation de dettes, un tiers d’aide bilatérale d’Etat à Etat. Le total de l’aide de l’Europe au sens large vers l’Afrique s’élève à 90 milliards d’euros.
Si les progrès existent, les intervenants ont constaté que les objectifs du millénaire que l’Onu, dont l’éradication de la pauvreté, s’est assignés à l’horizon 2020 sont loin d’être atteints : des famines persistent, l’absence d’hygiène et d’eau potable tue cinq mille enfants par jour, la corruption ponctionne l’aide transmise et les résultats sont parfois difficilement tangibles. L’immigration illégale aux portes de l’Europe, aux Canaries ou à Melilla est un des symptômes de l’insuffisance des aides actuelles : la misère s’exporte vers les lieux de prospérité. Or aucune frontière, aucune barrière, aucun barbelé n’empêchera ceux qui ont faim d’aller chez ceux qui ont à manger. Seul le développement local permettra de tarir l’immigration massive.
Or, comme l’a rappelé Jean Favre, responsable Onu pour les Objectifs du millénaire, l’aide publique ne peut plus être considérée comme une “dépense extérieure”, mais comme un investissement pour l’avenir, non seulement celui de l’Afrique, mais aussi celui de l’Europe.
D’où cette volonté d’évoluer vers le codéveloppement.
Le codéveloppement repose sur d’abord sur la promotion de la démocratie : Il n’y a pas de famine en démocratie, car les dirigeants sont comptables de leurs actes, ce qui n’est pas le cas des dictatures, ni des Etats en guerre civile (Jean Favre). Sans qu’il s’agisse de conditionner stricto sensu l’aide à l’adoption d’un régime parlementaire, le principe est d’exiger au moins une “bonne gouvernance”, permettant un contrôle de l’usage fait des aides accordées, un droit de regard de la population concernée grâce à une transparence sur les montants reçus et sur les projets financés. Concrètement, un premier stade peut consister à appuyer (politiquement et financièrement) les ONG locales afin qu’elles puissent exercer ce contrôle et la publicité nécessaire. De même, ce principe implique de mettre fin immédiatement aux aides de géopolitique à des régimes non démocratiques, jusqu’ici justifiées par les liens coloniaux et surtout par la stratégie française en Afrique. La fin des réseaux.
Le second principe du codéveloppement est la coopération dite décentralisée, laquelle court-circuite les Etats pour mettre en relation les collectivités locales, telles que les régions ou les villes, voire les villages d’Europe et d’Afrique. Le premier intérêt est d’éviter une partie de la corruption lors du passage des flux entre les mains des Etats. Le second est d’impliquer des acteurs locaux de chaque coté : les entités locales d’Afrique sont les mieux placées pour savoir quels sont leurs besoins et faire remonter l’information à leurs partenaires d’Europe. Ces derniers ont à coeur de vérifier l’usage fait de leurs aides. Cette décentralisation permet une plus grande efficacité et réunit des compétences. Partir de là-bas plutôt que d’ici.
L’exemple a été parfaitement exprimé par Abdourahim Agne, ministre du développement du Sénégal. Lorsqu’il était président de la région de Saint-Louis au Sénégal, il a été confronté au coût de la réfection du Lycée Faidherbe à Saint-Louis : trois cents millions de francs CFA. Le partenariat monté avec la Région Rhône-Alpes grâce à Thierry Cornillet, député européen, a permis de réaliser les travaux en un temps record, grâce aux solutions imaginées par les deux régions, et pour un coût diminué d’un tiers.
La décentralisation signifie des aides plus modestes, mais mieux ciblées et utilisées plus intelligemment. En cela, elle se rapproche du micro-crédit : des petites sommes à destination des plus démunis pour qu’enfin la croissance aille vers la population la plus défavorisée.
Le troisième principe réside dans l’association des migrants aux actions de développement. Les migrants, qui sont aussi bien les résidents que les personne naturalisées, apportent à l’Afrique près de cent milliards d’euros chaque année, soit autant que l’aide publique, qui sont injectés directement dans l’économie locale : les bénéficiaires sont les familles principalement, mais aussi des villages. Les migrants expriment, à travers Brice Monou du Forim, le souhait d’être associés étroitement aux actions publiques de développement. L’intérêt de cette association réside dans la parfaite connaissance qu’ont les migrants des besoins de leur communauté d’origine, ainsi que dans les acteurs susceptibles de mettre en oeuvre ces actions. Cette reconnaissance d’un rôle d’intermédiaire à jouer pour les migrants, outre l’aspect de respect et d’humilité, permettrait également une plus grande efficacité des aides au développement.
Ces trois principes ont été repris par François Bayrou dans son discours de synthèse, insistant sur la nécessité de passer de l’assistanat au partenariat. François Bayrou a évoqué le commerce équitable comme étant une des voies majeures pour y parvenir, cette nouvelle distribution des richesses étant aussi une source de développement pour nos sociétés occidentales : un autre modèle est possible, qui ne repose pas uniquement sur le profit, mais sur l’équité et la qualité. Sortir du tout-financier.
Fils et petit-fils d’agriculteur, François Bayrou a rappelé que l’économie des pays en développement reste agricole à 70 %, que la concurrence entre notre agriculture mécanisée et subventionnée et des cultivateurs sans machine ni bête de somme est impossible à tenir et que le résultat en est l’exode rural, non pas vers les industries, inexistantes, mais vers les bidonvilles. Le codéveloppement implique donc aussi, selon le président de l’UDF, la remise en cause de nos subventions agricoles, au moins dans leur aspect productiviste, pour aller vers une agriculture produisant moins, mais mieux et sans nuire à notre environnement et surtout à nos voisins, nos frères de planète, en les laissant respirer...
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









