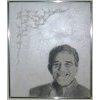Egalité des chances, faites-moi rire !
Le débat sur l’égalité des chances resurgit régulièrement comme un serpent de mer émergeant sous l’effet de tempêtes périodiques, car ses données et ses enjeux sociétaux dépassent largement le cadre de l’institution scolaire.
Une question pour commencer. Statistiquement, quels sont majoritairement les statuts socioprofessionnels des parents des élèves qui réussissent à l’école ? La réponse est connue depuis longtemps grâce à de nombreuses études en sociologie de l’éducation. Ce sont les professions libérales, les cadres supérieurs, les dirigeants d’entreprises et les professionnels de l’éducation, c’est-à-dire les parents qui connaissent les règles explicites du fonctionnement scolaire sans méconnaître celles qui sont implicites. En conséquence, ces parents savent aider leur progéniture. Le fameux problème de la carte scolaire témoigne de cette réalité.
La fonction de l’école est de former les générations montantes mais aussi de sélectionner les futures élites nécessaires à la création, à la production et à la distribution des biens et des richesses. Si ce débat sur l’égalité des chances perdure, n’est-ce pas parce que ces élites financières, économiques ou culturelles ont du mal à accepter les changements qui atténueraient les écarts de situation, et en particulier celles qui concerneraient l’accès du plus grand nombre aux savoirs, à la maîtrise de compétences expertes et à de meilleures positions ? Dans les formations actuelles, fondées plus ou moins consciemment sur l’idée de compétition, l’égalité des chances entre les individus a donc toutes les chances de rester une virtualité, un concept illusoire qui mystifie les plus crédules.
A moins que... A moins que pour assurer l’égalité des chances, nous nous attelions tout d’abord à mieux comprendre les inégalités et leurs conséquences, comme le disent Serge Paugam et Bruno Palier dans leur dernier ouvrage, Repenser la solidarité au XXIe siècle, l’apport des sciences sociales (PUF) : « Pour réduire les inégalités, il faut d’abord bien les connaître et en faire l’inventaire. » C’est ici que ce débat sur l’égalité des chances dépasse largement celui de l’école car il embrasse toutes les dimensions de la société.
- Concernant les conditions financières et matérielles de vie. Sur ce point, il est inutile de développer les écarts de qualité de vie entre ceux qui jouissent d’un environnement à la pointe du progrès (environnement facteur d’apprentissages) et ceux qui croupissent dans des cages à lapin. Par contre, un autre phénomène parascolaire grandissant mérite ici d’être explicité. Avec le développement des cours particuliers et autre Acadoemia qui fleurissent actuellement un peu partout, il est évident que le fossé des inégalités se creuse encore plus entre ceux qui disposent des moyens pour soutenir les progrès ou les difficultés temporaires de leurs enfants et ceux qui voient leurs gamins s’enfoncer dans l’ignorance des subtilités du monde. Et les médias dominants, avec leurs programmes télévisuels débiles ou basés sur l’appât facile du gain, n’aident sûrement pas les défavorisés à plus d’intelligence et de compréhension de leur environnement ! Faire l’inventaire des inégalités réelles est donc bien nécessaire avant toute chose.
- Concernant l’environnement familial. Entretenus par certains décideurs sociétaux ou des employeurs obtus ou suffisants, le chômage ou la déconsidération professionnelle de certains parents pénalisent leurs enfants, qui trouvent difficilement en eux les modèles identificatoires nécessaires à leur développement affectif et cognitif. Ces atteintes à la dignité humaine des familles font des ravages non négligeables dans la capacité que possède tout enfant à découvrir et s’approprier le monde. Construire ou restaurer la confiance en soi et les sources de son estime chez les plus en difficulté, en tenant compte de leur histoire personnelle et familiale, est un objectif essentiel d’une politique éducative d’égalité des chances. Ces constats psychosociologiques sont trop peu partagés dans les médias ou dans le monde du travail et commencent tout juste à être reconnus par les décideurs du monde enseignant.
- Concernant la morale dominante. Les discours sur le mérite individuel, que nous entendons aussi bien à droite que chez certains républicains de gauche, et que la compétition sportive à outrance entretient malicieusement, s’imposent comme une pensée unique. Dans une société de marché, tout le monde tendrait à avoir les mêmes chances, et ceux qui réussissent seraient ceux qui font le plus d’efforts. La majorité des sociologues pensent au contraire que tout le monde n’est pas sur un pied d’égalité. Les situations sociales, l’endroit de naissance et de vie, les trajectoires familiales et scolaires déterminent grandement les chances de réussite et les cheminements individuels. Le déni des déterminants de ces inégalités est flagrant. Par exemple, la grande explication de la pauvreté et du chômage serait la paresse qui démarrerait à l’école et qui ensuite se poursuivrait le reste de la vie de certains individus. Discours simpliste, qui ne veut pas reconnaître les facteurs entremêlés du développement de chaque être et de son psychisme, discours qui refusent aussi de voir la responsabilité collective du fonctionnement sociétal et de la solidarité qu’elle implique. Comme l’a écrit aussi très justement François Dubet dans un article du Monde du 23 janvier, « En finir avec l’élitisme scolaire », la politique d’égalité des chances qui consiste à encourager les élèves méritants des zones défavorisées ne dit tragiquement rien du sort qui sera réservé à la masse des élèves les moins favorisés et les plus faibles. C’est pourtant une bonne partie d’entre eux qui poseront des problèmes dans le futur en devenant chômeurs, délinquants ou adultes déséquilibrés mentalement et à la charge des autres citoyens, faute d’un développement éducatif équilibré et d’une insertion responsable. Notre collectivité devra tôt ou tard se pencher sérieusement sur ces constats. Et, identiquement aux problèmes écologiques, le plus tôt sera le mieux.
Bref, avec un libéralisme dominant et avec des élites bornées ou repliées sur leurs intérêts à court terme, quelle chance a-t-on de voir aboutir une véritable politique d’égalité des chances ? Aucune. Le poids de notre dette publique, entretenu par l’intérêt particulier de ces élites (voir les débats actuels sur les revenus astronomiques de certaines d’entre elles, l’utilisation scandaleuse des paradis fiscaux et les stratégies financières s’appuyant sur un libéralisme sauvage et mondialisé), est l’exemple même des contraintes qui vont peser de plus en plus sur d’indispensables investissements culturels, sociaux et éducatifs. Sans protection coordonnée à l’échelle européenne de nos modes de vie, nous n’avons aucune chance de dégager les marges financières permettant d’investir dans la matière grise des élèves, de développer une véritable refonte des modalités d’enseignement et d’assurer une formation pertinente des enseignants à la hauteur de nos connaissances en sciences sociales et humaines.
Certains pays reconnus performants l’ont bien compris avant nous. La Finlande, par exemple, a déjà mis en application des mesures salutaires dans le sens de l’égalité des chances, en reconsidérant par exemple la notion d’évaluation normée (les fameuses notes et classements !). Les notations n’y apparaissent qu’à partir de treize ans. Avant cet âge, l’absence de notes laisse la place à des stratégies positives qui impliquent chaque enfant dans sa globalité et dans ses différences, et qui ne laissent que très peu d’élèves sur la touche. En conséquence, et grâce à d’autres mesures tout aussi subtiles mais réalistes, les petits Finlandais acquièrent de meilleures compétences que leurs homologues français. Il faudra attendre encore combien de dégâts, de révoltes et de violences juvéniles gratuites pour que nos responsables politiques et sociétaux commencent à s’inspirer de ces réussites étrangères, pour les divulguer et les mettre en application ?
Pour l’avenir, nos responsables politiques se trouvent donc devant des difficultés majeures de réformes, en l’absence de clairvoyance et de courage depuis de nombreuses années. Le désintérêt (ou au contraire les positionnements extrémistes) à l’égard de la vie politique et la morosité d’une partie non négligeable de la population témoignent aussi de cette ambiance. Les débats participatifs du Parti socialiste laissent entrevoir une nouvelle manière de tenir compte de la réalité et de l’avis des citoyens. Ne seront-ils que des épiphénomènes de périodes préélectorales ou les prémices d’une vie citoyenne reconsidérée et digne du XXIe siècle ? En d’autres termes, nos responsables politiques souhaitent-ils vraiment porter les mutations nécessaires de nos institutions, pour garantir une véritable égalité des chances et surtout pour offrir à chacun un statut digne de notre condition d’humain ?
Didier Lescaudron
23 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON