Les renoncements d’#Hollande, 2ème épisode : le marché du travail
Durant sa campagne électorale, en bon social démocrate, François Hollande avait promis un accord gagnant gagnant entre les syndicats et le Medef sur le marché du travail. Il devait offrir aux salariés la sécurité, aux entreprises la flexibilité. Car le socle même de la sociale démocratie repose sur la négociation directe entre le patronat et les syndicats, sans que l’état n’intervienne par le truchement de la loi. C’est ça le coeur de la sociale démocratie. Pour qu’un tel système du dialogue social soit possible il faut au moins deux conditions :
- l’état, autrement dit le gouvernement en fonction, doit être impartial et ne pencher d’aucun des deux côtés des négociateurs,
- les négociations doivent appréhender le marché du travail branche par branche, secteurs d’activités par secteurs d’activités pour coller au plus près des réalités disparates de l’économie.
Aucune de ces deux conditions n’a pourtant été respectée. Dans les deux cas, François Hollande et son gouvernement, en particulier son premier ministre, son ministre de l’économie, son ministre du budget et son ministre du travail, ont rompu la neutralité en s’engageant clairement derrière le patronat. Ils ont refusé une négociation branche par branche, obsédés qu’ils étaient d’obtenir un accord historique, c’est à dire un accord général et national signé par tous les syndicats.
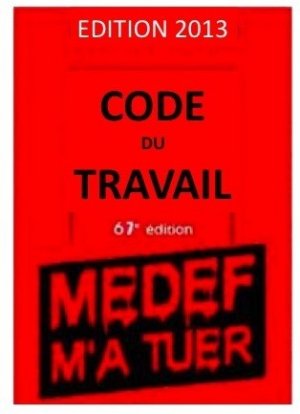
La rupture de la neutralité a débuté avec le quinquennat. En allant massivement aux universités d’été du Medef plutôt que de faire voter une loi d’amnistie des syndicalistes, loi pourtant prête et promise à mots couverts, Jean-Marc Ayrault et ses ministres envoient un signal catastrophique aux syndicats de salariés, exaltant pour les organisations patronales. La suite des décisions économiques du gouvernement confirmera qu’il ne s’agissait pas seulement d’une opération de communication mais véritablement d’un choix politique assumé. Car il y eut ensuite cette fameuse affaire des geonpis. Il aura suffit à quelques patrons médiatiques, à la tête d’entreprises non moins médiatiques, de crier du bout du bec pour que le gouvernement accepte de les “épargner” fiscalement. Ils pourront donc bénéficier d’avantages et d’exonérations considérables. La brèche ouverte durant l’été, enfoncée à l’automne, pouvait alors être totalement explosée à la veille de l’hiver. C’est à ce moment là que le Medef choisit de ressortir sarengaine âgée de plus de 40 ans : les entreprises française souffrent d’un manque de compétitivité et sont sur le point de mourir. Il est donc indispensable de les exonérer de cotisations, de baisser le coût du travail dans le vocable patronal. Jean-Marc Ayrault nomme un insubmersible à la tête d’un groupe de travail, Louis Gallois, qui pond en moins de temps qu’il ne faut pour le dire un rapport sur l’état de santé de l’économie française. La conclusion tombe alors comme un couperet, non seulement pour les salariés, mais également pour les électeurs de François Hollande. Le gouvernement mettra en oeuvre un allègement de 20 milliards des cotisations sociales patronales que les salariés financeront de leurs poches par le biais de leur consommation et de la TVA anti-sociale. Non seulement François Hollande bascule du côté de la politique économique de l’offre, théorisée par les économistes les plus libéraux, mais il renonce au principe d’un impôt direct et progressif au profit d’un impôt indirect et proportionnel. Certains diront que ce renoncement n’est que partiel. Il est surtout hautement symbolique et dramatique pour les salariés, dramatique pour l’image de la gauche toute entière. C’est dans ce contexte que démarrent à la mi décembre 2012 les fameuses négociations sur le marché du travail, c’est à dire un contexte où la présidente du Medef crie sur les plateaux télé sa joie d’avoir été entendue par un gouvernement aussi conciliant, c’est à dire un contexte où Florange sera sacrifiée comme des centaines d’entreprises victimes de plans sociaux, c’est à dire dans un contexte où le marché du travail est au plus mal avec une croissance du chômage spectaculaire.
En voulant un accord global, François Hollande torpille les syndicats et arme puissamment le patronat. En effet, les revendications patronales sont claires et connues de tous :
- pouvoir licencier sans entrave,
- pouvoir moduler le temps de travail à volonté,
- pouvoir jouer sur la rémunération en intégrant que le salaire n’est rien d’autre qu’une variable d’ajustement de la profitabilité.
Les justifications de ces revendications sont également claires et connues de tous : les entreprises françaises ont “peur de licencier”, insinuant ainsi que la peur du chômage que ressentent les salariés est équivalente. Si bien que pour le Medef l’accord doit porter sur toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité, quelle que soit la santé de l’entreprise. Ainsi, avec l’accord signé par la CFDT, les entreprises travaillant dans des branches ou des secteurs d’activité porteurs et en pleine croissance pourront licencier, baisser les salaires, baisser le temps de travail au même titre que les entreprises agissants dans des secteurs en crise. C’est juste incroyable ! Car, lorsqu’on regarde les pays si “admirés”, comme peut l’être l’Allemagne, jamais un tel accord ne serait signé sur la totalité des entreprises. Quand un accord incluant une diminution du temps travail et donc une diminution de salaire est signé dans le secteur automobile, il ne concerne que le secteur automobile. Certainement pas la totalité des entreprises allemandes ! En réalité, le gouvernement a laissé le Medef maitre de l’ordre du jour des négociations et du périmètre des discussions. Ainsi, il a condamné les syndicats non à un compromis historique, mais à une compromission inacceptable. Seule pouvait signer un accord aussi global et défavorable au salariat une confédération qui raisonne l’emploi en termes de marché et non en termes de rapports de force : la CFDT. Car cet accord n’a rien à voir avec la sociale démocratie, mais tout à voir avec le libéralisme économique qui donne la primauté à l’offre, c’est à dire à l’entreprise, la demande n’étant qu’une simple variable d’ajustement. Ici, en l’espèce, le salariat.
Cet accord traduit un renoncement supplémentaire de François Hollande. Il n’est plus social, mais libéral. Cette métamorphose est majeure et implique de manière automatique les renoncements du président concernant la justice et l’équité en matière salariale. Le SMIC n’augmentera pas, les salariés ne seront pas impliqués dans les décisions majeures de leurs entreprises, les licenciements pourront être “automatiques” dès lors que le salarié refusera les contraintes qui lui seront imposées (mutation, diminution de son temps de travail, baisse de son salaire…) avec un pouvoir de recours aux Prud’Hommes considérablement amoindri. Finalement son seul droit sera d’aller au chômage, avec l’espoir illusoire de bénéficier de droits ASSEDIC rechargeables. La contre partie sera le retour à l’allocation degressive ou bien une baisse de 10 à 15% de l’allocation actuelle. Car le Medef entend raisonner à coûts constants. Si cette disposition, remise à la négociation en avril, devait être mise en oeuvre sans remettre en question les niveaux d’indemnisation, elle coûterait 50 milliards aux entreprises. Elle ne verra donc jamais le jour, si ce n’est au détriment des salariés, tout en sauvant la face par le biais d’une communication savamment orchestrée par une agence richement payée. Du reste, dès le lendemain de l’annonce de l’accord Medef/CFDT, l’UNEDIC révisait ses prévisions d’accroissement du chômage dans le sens d’uneprogression encore plus forte pour 2013. En définitive, Hollande c’est comme Sarkozy, les cris et les larmes en moins. Quoique…
5 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









