Oser l’universalisme, contre le communautarisme
Oser l’universalisme, contre le communautarisme de Nathalie Heinich ; Éditions Le bord de l’eau ; collection clair et net, 136p, 16€
Nathalie Heinich est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur d’une quarantaine d’ouvrages.
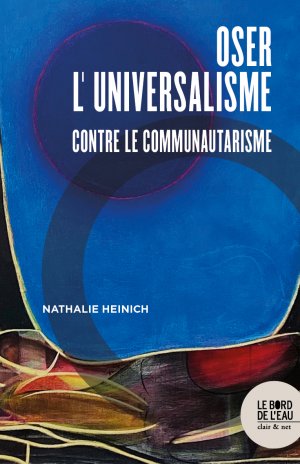
Ce petit livre expose et développe les raisons qu’on peut avoir de résister à un certain esprit du temps qui disperse et enferme les hommes, au sens de l’humanité, dans des catégories figées. Il est constitué d’articles divers parfois déjà publiés ailleurs. Il est du côté de la rationalité de l’universel, de ce qui constitue notre commune humanité. C’est ce choix qui fonde le mot « universalisme » : une aspiration, qui n’est pas (encore) une réalité, et qu’il faut conserver et développer. À cet universalisme, s’oppose le communautarisme qui met en priorité les groupes auxquels chacun appartient. L’universalisme ne peut céder devant l'argument des communautaristes selon lequel l’égalité n’est pas parfaitement réalisée.
Le mode de pensée des communautaristes est binaire : des dominants et des dominés, des bourreaux et des victimes.
Trois domaines de la vie sociétale sont affectés par ce retournement des valeurs : l’identité, la différence sexuelle, le peu de valeur de la parole de l’autre. Cela donne trois parties au livre. Ces retournements viennent des USA, ce qui est reprochable en soi, les USA ayant toujours fonctionné sur ces distinctions préalables à toutes autres considérations, et à la considération de l’unité de l’homme dans toutes ces « identités ». Quel que soit l’avis qu’on peut porter sur ce phénomène, sa dimension d’intrusion caractérisée est en soi un reproche qui pourrait suffire à l’invalider, à le rejeter. Mais ce n’est pas l’essentiel.
L’identitarisme découpe la société en communautés. L’appartenance à une identité collective n’est pas le fait d’une décision, ce qui la placerait dans l’ordre de la volonté, elle est donnée comme « un fait », une essence. Or, tout groupe, par construction, exclut ceux qui ne sont pas du groupe. L’appartenance en peut exister sans son contraire : la non-appartenance. C’est là que l’unité de l’universel se brise. L’appartenance comme son contraire peuvent être douces et tranquilles. Ce n’est guère le cas dans cette optique : les groupes communautaires entrent en concurrence forte les uns avec les autres. A été inventée ainsi l’intersectionnalité : « dès lors que les individus sont appréhendés comme appartenant à un collectif assigné, il faut trouver des solutions pour rendre compte de l’évidente pluralité des identités… créer une nouvelle identité » (p90)
Le néo-féminisme est un autre domaine du communautarisme. Du point de vue de l’universalisme, la différence sexuelle ne doit être mise en avant que lorsqu’elle joue un rôle dans ce que l’on a à dire, le reste du temps, l’humanité des femmes et des hommes ne nécessite pas de spécification et n’a pas à être mentionnée. L’écriture dite-inclusive ne cesse de vouloir rappeler l’existence des femmes et des hommes, ce que l’on sait bien. Il y a une double injonction (impossible) à, d’une part ne pas considérer les sexes (par souci d’égalité) et, d’autre part de les spécifier sans cesse dans la détermination dominant-dominé. Comme il va de même de la race, on trouve un « féminisme décolonial », les femmes noires subiraient plus de discrimination, selon leur appartenance à deux catégories victimisées. Le bourreau désigné identitairement est le « mâle blanc », convergence de toutes ces catégories de plaignants.
Car, dernier point, tout ce système se fait sur un mode accusatoire, ou l’élimination du discours de l’autre et même de sa personne est érigée en méthode et en idéal (cela s’appelle woke ou cancel culture). Des conférences sont interdites, des statues déboulonnées, des livres brûlés… dans une culture de la censure, où certains se sentent tellement assurés d’être du côté du bien qu’ils se sentent en droit de faire du mal aux autres, à leur parole, à leurs créations… Cette idéologie gagne l’université, les syndicats…
Le meilleur remède aux inégalités du monde est encore la considération de ce qui unifie les hommes, ce qui rassemble, ce qui les rend semblables les uns aux autres, dans un combat permanent pour réaliser l’égalité qui découle de cette unité humaine : chaque humain est membre de la collectivité nationale, ses appartenances à des « communautés » ne lui conférant aucun droit distinct de celui des autres, ne conférant aucune légitimité spéciales à ses opinions.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










