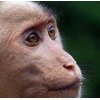Ségolène Royal et la soif de victoire des nouveaux adhérents
La candidate socialiste à la présidentielle doit sa victoire à une anticipation remarquable des conséquence de l’irruption dans le parti des nouveaux adhérents. Elle fut la première à comprendre en quoi leur différence changeait radicalement la donne dans la campagne interne, et elle a réussi à capter ce précieux capital.
Pourquoi cette victoire en forme de raz-de-marée en faveur de Ségolène Royal dans le vote d’investiture socialiste à l’élection présidentielle de 2007 ? Des explications simples et classiques, des questions de positionnement interne au sein du Parti socialiste, une bonne ou mauvaise campagne ne suffisent pas à l’expliquer. Il y a des raisons plus profondes.
Le vote pour Ségolène Royal est manifestement porté par une dynamique de fond à l’intérieur du PS. Cette dynamique est venue de l’extérieur du parti, elle est venue du "peuple de gauche". On l’a vue s’exprimer à travers deux phénomènes massifs qui se sont révélés convergents : l’état de l’opinion selon les sondages et cette arrivée massive des nouveaux adhérents, qu’il est fort instructif d’observer dans le détail. Surfer sur une vague de fond
Ce raz-de-marée électoral répond à une vague qui l’a précédée, celle de l’arrivée massive des nouveaux adhérents au début de l’année 2006. L’une et l’autre forment les deux temps d’un même mouvement qui prend son origine plus en amont encore. Le talent de Ségolène Royal est d’avoir su surfer sur cette vague, car elle l’attendait... Elle s’était déjà positionnée politiquement pour la prendre au passage. Elle l’avait vue venir avant les autres et elle a fait ce qu’il fallait pour qu’elle profite à sa candidature. Le manque de clairvoyance des équipes de campagne de ses "compétiteurs", sur un sujet qui s’est révélé fondamental, lui a offert la victoire.
C’est au début de l’année 2006 que l’équipe de Ségolène Royal a pris sa décision stratégique fondamentale dans cette campagne qui était encore loin d’être lancée. Mais des mouvements agitaient déjà les profondeurs de l’opinion : un pari est apparu jouable. Il était en effet gagnant. En ce début d’année, l’équipe de Ségolène Royal était en train de structurer l’organisation de sa campagne, autour de l’association Désir d’avenir créée en décembre 2005. La question fut sérieusement débattue à l’époque au sein de l’équipe (certains de ses membres le reconnaissent en privé aujourd’hui) : Désir d’avenir devait-elle s’organiser dans le parti, à côté, en marge, ou contre le Parti socialiste ?
A cette époque, dès janvier et février 2006, la campagne d’adhésion commençait à prendre, et à prendre massivement, quand elle fut relayée en mars par la campagne sur Internet. La clairvoyance de l’équipe de Ségolène Royal fut de s’être penchée la première sur ces nouveaux adhérents : qui sont-ils ? pourquoi viennent-ils ? Les équipes de DSK et Fabius n’ont pas sérieusement fait cette démarche à l’époque, ils n’ont ainsi pas vu que les nouveaux adhérents n’avaient pas le profil des adhérents traditionnels et qu’ils allaient donc changer profondément la règle du jeu dans le vote d’investiture. Les nouveaux adhérents changent la donne Il est difficile d’appréhender le profil de ces nouveaux adhérents, car très peu d’outil sont disponibles pour le faire. On trouve toutefois quelques éléments dans la presse interne du PS. La section du 11e arrondissement de Paris propose ainsi une analyse effectuée d’après les données statistiques recueillies lors de l’adhésion (1). Cette analyse porte sur les 1028 nouveaux adhérents enregistrés depuis le 1er janvier 2006, ce qui représente une progression de 138%. Cette section est aujourd’hui l’une des plus importantes de France. Quand ont-ils adhéré ? "Dès le mois de janvier et février, nous avons enregistré un flux d’une importance inhabituelle", relève Michel Puzelat, secrétaire adjoint de la section. "Mais l’explosion de nos effectifs est liée à la campagne d’adhésion par Internet", qui a débuté le 10 mars 2006. Quel est leur portrait sociologique ? Michel Puzelat note une légère féminisation : "Le Parti socialiste reste un parti à forte majorité masculine. Les nouvelles adhésions ont fait un peu bouger cette caractéristique, mais ne l’ont pas bouleversée." Il relève aussi une répartition géographique équilibrée dans l’arrondissement, et "une sociologie diversifiée" : "le profil des nouveaux adhérents ressemble finalement assez à celui des anciens". Il souligne "un retour des profs" mais n’observe pas de retour des ouvriers. Parmi les nouveaux, les fonctionnaires sont "en nombre assez limité. Les salariés du privé sont les plus nombreux". La seule caractéristique sociologique marquant une différence nette est celle de l’âge : "55,7% des nouveaux adhérents ont moins de 40 ans (dont 43% ont moins de 35 ans)." Leur arrivée entraîne un net rajeunissement de la section.
Donc aucun bouleversement sociologique, si ce n’est celui de l’âge... Cette vague de nouveaux adhérents est ainsi surtout un phénomène de génération : une nouvelle génération de militants a adhéré, mais elle ressemble quasiment en tout point par ailleurs aux générations de "vieux militants" qu’elle a rejoints. Seconde caractéristique, cette adhésion a été très brutale. Elle s’est faite en cinq mois seulement ! Le premier frémissement date de janvier 2006, et seules les adhésions enregistrées jusqu’au 1er juin pouvaient donner accès au vote pour l’investiture, selon les statuts du parti. La mauvaise conscience du 21 avril
Pourquoi cette jeune génération de socialistes, qui se tenait jusqu’alors à l’écart d’un parti qui sociologiquement lui semblait pourtant destiné, a-t-elle finalement fait le pas, et pourquoi l’a-t-elle fait si brutalement ?
Peu d’outils pour répondre à cette question, là encore. Michel Puzelat avance, au sujet de sa section, quelques réponses qu’il reconnaît lui-même empiriques : "Il y a évidemment la commodité de l’adhésion par Internet", mais nous avons vu que la vague d’adhésion avait déjà commencé avant. "La cause essentielle", souligne Michel Puzelat, "c’est bien entendu la proximité de l’élection présidentielle et une forte volonté de battre la droite", et "le souvenir du 21 avril". Le secrétaire-adjoint cite un témoignage d’adhérent significatif : "Je préfère adhérer maintenant plutôt que d’avoir mauvaise conscience après un nouveau 21 avril".
D’autres indices, observés de manière également empirique, incitent à croire que cette vague d’adhésion ne traduisait pas une volonté d’engagement militant dans la vie du Parti socialiste, mais pour l’essentiel une volonté de participer à la désignation du candidat socialiste à la présidentielle, et uniquement à cela. Le vote des militants sur le projet socialiste est intervenu dans cette section de Paris le 22 juin 2006. Il s’agissait du premier acte politique dans la vie interne du parti proposé aux nouveaux adhérents depuis leur adhésion. Ils s’en sont pourtant totalement désintéressés. Pour 1127 votants (sur 1534 inscrits) au vote d’investiture du 16 novembre 2006 (soit une participation élevée de 73%), les militants socialistes du 11e arrondissement de Paris n’étaient que 268 votants sur le projet, le 22 juin précédent... Cette indication est renforcée par des témoignages recueillis auprès de militants, qui soulignent que "les nouveaux adhérents, nous ne les connaissons pas", "ils ne viennent pas en réunions de section", "ils ne participent pas aux distributions de tracts"... Un événement catalyseur
Le divorce entre la jeunesse et la politique traditionnelle a été maintes fois souligné depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui fait que la jeunesse soit néanmoins conduite à s’engager à un moment donné ? Une étude sur "l’engagement des jeunes en politique", menée par deux lycéens de seize et dix-sept ans et publiée par le site Internet Place publique (2), pointait déjà en juillet 2002 (et ce sont des jeunes eux-mêmes qui le soulignent au sujet de leur propre génération) : "Face à l’apathie qui règne entre eux et les politiques, au sentiment d’être incompris, marginalisés, certains vont se résigner et se désintéresser du propos, déçus. Cela se traduit alors par l’abstention et par la passivité face aux problèmes sociaux. Seul un événement catalyseur réussit à mobiliser ces jeunes et à faire émerger leur conscience citoyenne et politique : 66% des 18-24 ans se déclaraient plus impliqués dans le débat politique depuis le premier tour des élections présidentielles."
Cette campagne électorale pour l’investiture socialiste s’est donc engagée dans un parti massivement renouvelé par une jeune génération, que l’on sent peu investie dans la vie du parti, ne connaissant pas ses usages, ne relevant d’aucune fidélité de courant ou de personne, ni d’aucune culture de la "tradition du parti". Une génération qui se tient précisément à l’écart, par méfiance, de cette manière traditionnelle de faire de la politique. Une génération qui est peu intéressée par un débat politique perçu comme "politicien", et qui reçoit donc son information politique en dehors d’un parti institué et de son rôle traditionnel de relais, et se tourne plutôt vers la presse, la télévision et Internet. Une génération enfin qui s’est engagée brutalement au Parti socialiste, uniquement dans la perspective de l’élection de 2007, dans une sorte d’adhésion "réduite aux acquêts" et "à durée déterminée", sous "l’effet catalyseur" d’une "mauvaise conscience du 21 avril" et d’une volonté de revanche. Désir d’avenir + devoir de victoire = désir de victoire
C’est cela que Ségolène Royal a compris dès le début de l’année 2006 et que ses compétiteurs n’ont pas vu venir. Sa personnalité et son positionnement politique inhabituel au Parti socialiste l’ont placée dans les sondages depuis des mois en position de favorite. Ce statut de favorite a été le levier de sa conquête du vote des nouveaux adhérents... C’est dans cette perspective que Ségolène Royal a engagé sa campagne en choisissant de créer son association Désir d’avenir à côté, et non contre lui, du Parti socialiste (comme ce fut un moment envisagé). Elle a ainsi revendiqué le caractère socialiste de son association et l’a utilisée comme un vaste outil de recrutement, un sas d’entrée vers le PS. Elle a encouragé l’intérêt que lui portait, parce qu’elle était favorite, une génération dépolitisée mais traumatisée par le 21 avril, à se métamorphoser en adhésion à un parti politique. Ségolène Royal a toujours tenu compte dans sa campagne des caractéristiques de cet électorat potentiel : faible investissement "politicien" et fort investissement affectif. Elle s’est adressée au désir d’avenir (son slogan de campagne) de cet électorat, invoquant un "devoir de victoire" (le slogan repris par ses troupes au MJS, le mouvement des jeunes socialistes). Ces deux slogans fusionnent dans ce qui fait le ressort essentiel de la dynamique sur laquelle s’est appuyée Ségolène Royal dans sa campagne, jusqu’à en faire l’axe de son discours : le "désir de victoire". Son statut de favorite, renforcé sans cesse par les médias, nourrissait quasi mécaniquement ce désir...
Ségolène Royal a martelé ce discours simple et choc qui lui a acquis massivement le vote des nouveaux adhérents, entraînant à sa suite celui des plus anciens, et donnant corps, à mesure des ralliements, à sa propre promesse : "Ségolène Royal est la seule à pouvoir faire gagner la gauche en 2007". Le martelage médiatique, assez invraisemblable, de sondages pourtant faussés, puisqu’ils portaient sur les sympathisants et non sur les adhérents socialistes, a achevé de cristalliser le phénomène de cette campagne, qui a fait d’un désir de victoire l’outil même réalisant la victoire. Une imbattable machine électorale
Les compétiteurs de la candidate n’ont pas vu se mettre en place cette formidable machine électorale. Ils en ont constaté l’efficacité alors qu’il était trop tard pour redresser la barre.
Le positionnement initial de Laurent Fabius était si décalé par rapport à cette nouvelle donne que sa campagne partait dès l’origine sur de mauvaises bases. Ce n’était plus rattrapable. L’incessant rappel au projet socialiste, dont les nouveaux adhérents se sont totalement désintéressés, l’appel aux couches populaires, auxquelles ils n’appartiennent pas, et à la tradition de la gauche socialiste, qui n’est pas la leur, n’ont rencontré aucun écho. Il n’est plus resté au candidat que la solution de bétonner sa position politique pour "préparer l’avenir", en mobilisant son premier cercle de militants, sans espérer l’étendre, en limitant l’hémorragie.
Le positionnement de Dominique Strauss-Kahn en revanche offrait plus de souplesse. Remonter la pente était envisageable, avec un travail intensif de labourage militant en profondeur. Transformant ce combat à trois en un duel direct avec Ségolène Royal, DSK s’est attaqué frontalement à l’argument principal de son adversaire : la garantie de victoire en 2007. Il a tenté de miner les certitudes des militants acquis à Ségolène Royal. Il a tenté de les faire douter de la capacité de celle-ci à gagner, en attaquant la crédibilité des sondages et la capacité de son adversaire à rassembler la gauche au second tour. Il a attaqué sa capacité à gouverner, en mettant en avant sa propre compétence et son expérience gouvernementale. Il a joué de son charisme et de son sens indéniable de la pédagogie pour tenter d’opposer le réalisme, dont il s’est fait le champion, au désir que cultivait son adversaire.
Cette stratégie s’est révélée efficace et DSK commençait à engranger les conversions. Mais elle demandait du temps et de l’énergie pour renverser la vapeur, et le temps a manqué. Laurent Fabius est resté cantonné dans la marginalisation, DSK a été pris de court en pleine ascension. Ségolène Royal a tiré tout le bénéfice d’être partie en campagne très tôt, sur un pari osé qui s’est révélé très juste.
Que vont devenir désormais ces nouveaux adhérents ? Ségolène Royal peut-elle compter sur eux pour s’investir dans la campagne nationale qui s’ouvre aujourd’hui ? Il lui est d’autant plus nécessaire qu’ils se transforment désormais en vrais militants, que certaines troupes pourraient manquer à l’appel... Si l’appareil dirigeant du parti lui est acquis massivement, le ralliement des militants favorables à ses adversaires est loin de l’être autant. Certains ont déjà fait savoir qu’ils envisageaient la "grève" de campagne électorale. D’autres ne cachent pas que même leur vote au premier tour de l’élection est dans la balance, et qu’ils lorgnent, d’un côté, sur un éventuel rassemblement de "la gauche de la gauche", et, de l’autre, sur la candidature centriste de François Bayrou.
A plus long terme, Ségolène Royal aurait toujours besoin de ces nouveaux adhérents en cas de victoire présidentielle, pour s’assurer le contrôle du Parti socialiste et la stabilité de sa majorité de gouvernement. Ces nouveaux adhérents y sont-ils prêts ? Envisageaient-ils que leur adhésion pouvait les mener exactement vers ce qu’ils refusaient auparavant : l’engagement militant dans un parti ?
NovöVision
(1) Michel Puzelat, "Qui sont les Nouveaux adhérents ?", Bulletin d’information n°15, du 9 novembre 2006, de la section du XIe arrondissement de Paris du Parti socialiste. Disponible ici : ftp://ftp2.ps-paris11.org/psparis/docs/0611journal.pdf
(2) Pénélope Patrix, dix-sept ans, et Dorian de Kerorguen, seize ans, "L’engagement des jeunes en politique", dossier réalisé en juillet 2002, mis en ligne en juin 2003 sur le site "Place publique". Disponible ici : http://www.place-publique.fr/espacejeunes/article.php3?id_article=17#
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON