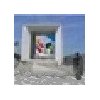Syrie : une censure qui ne fait pas la une des journaux
Leila Aïchi, avocate spécialisée dans les problèmes environnementaux, est sénatrice EELV de Paris. A ce titre elle est secrétaire du bureau de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

Leila Aïchi n'est pas une pacifiste bêlante, loin s'en faut. Elle peut même prendre parti en faveur de l'intervention de la France au Mali. Mais en ce qui concerne la Syrie son opinion est beaucoup plus nuancée que celle de certains bellicistes de son parti n'ayant comme horizon personnel que les ors d'un ministère et ayant dans cette perspective le petit doigt placé sur la couture du pantalon.
Leïla Aïchi doute, ce qui est tout à son honneur. Elle doute à propos de certains éléments de l'argumentaire va-t-en-guerre, quand elle n'en a en revanche aucun sur le caractère indispensable d'un feu vert de l'ONU avant tout passage à l'acte militaire.
Et, comme cela avait été prévu au sein du groupe écologiste, elle aurait souhaité le dire au nom des sénateur(trice)s EELV hostiles à une intervention dans les conditions fixées par le gouvernement, lors du débat au Sénat sur la Syrie le mercredi 4 septembre. Le temps de parole de 12 minutes accordé à EELV avait donc été divisé en deux interventions de temps égal afin que s’expriment les deux points de vue.
Or elle affirme dans son blog et dans la matinale de Bourdin sur RMC : "quelques heures avant le débat une partie de mon groupe a décidé que comme j'étais en défaveur de l'intervention, volonté du président, on m'a évincée" (interview à 17' 51'').
Ainsi donc pour n'avoir pas voulu s'aligner sur la doctrine présidentielle, dans une affaire aussi grave que celle de l'entrée en guerre de notre pays qui, rappellons-le, n'est pas l'objet d'une agression par une armée étrangère ou d'une action terroriste provenant d'un Etat, Leila Aïchi s'est vue "privée de parole" !!
Sans aller jusqu'à poser la question ironique suivante au risque de tomber dans l'outrance, bien que nous ayons à faire ici à un cas de censure digne d'un régime autocratique : " Où se situe donc "l'ennemi" ? En Syrie, ou dans les couloirs du palais du Luxembourg ? ", il n'en reste pas moins qu'il s'agit incontestablement de censure, et d'une censure indigne d'un pays qui se veut démocratique.
Quand la bêtise peut être dans le camp des va-t-en-guerre ("l'esprit munichois" d'Harlem Désir), quand la rhétorique pernicieuse chez un homme intelligent peut revêtir ce genre d'atours, il n'est pourtant pas superflu d'entendre une voix de la sagesse.
Patrick Samba
La position de Leila Aïchi sur la Syrie :

Le drame syrien qui se joue sous nos yeux avec près de 100 000 morts en deux ans de guerre civile est avant tout un échec patent de la communauté internationale qui, à force de calculs stratégiques hasardeux et de protection d’intérêts divergents, s’est révélée incapable de peser politiquement pour contrer et faire plier le régime de Bachar el-Assad.
Notre réaction à l’annonce de l’utilisation d’armes chimiques le 21 août dernier n’est que l’illustration de cette incapacité collective à nous réformer.
Pour autant, l’évolution de cette guerre civile vers un niveau d’horreur insupportable, interpelle à plusieurs égards.
Si l’usage des armes chimiques constitue un crime de guerre, la gravité d’une décision de recours à la force ne peut cependant s’accommoder d’une ingénuité stratégique.
a) Sur la légalité
I – Tout d’abord, une intervention sans mandat de l’ONU rendrait de fait l’opération militaire illégale et illégitime auprès de la communauté internationale. Et ce n’est pas la supposée caution de la Ligue arabe qui pourrait combler ce manque de légitimité.
Mais par-delà l’absence de légitimité, et en écartant les experts de l’ONU, c’est de l’affaiblissement des institutions internationales qu’il s’agit.
Stratégiquement, la rupture de la légalité internationale, seule discipline imposée à la puissance des grandes nations, est en soi une erreur politique majeure.
D’ailleurs, à ce stade, sommes-nous certains que l’utilisation des armes chimiques vienne exclusivement du camp de Bachar el-Assad et non des insurgés, puisque l’opposition syrienne, qui pour certaines de ses composantes ne sont pas démocratiques et proches d’al-Qaïda, a elle aussi, en son temps, utilisé des armes chimiques ?
Veillons à échapper au syndrome de Timișoara et à celui de la deuxième guerre d’Irak dont nous cherchons encore les armes de destructions massives.
Le droit, mais surtout la sagesse, imposent que nous attendions les conclusions des inspecteurs de l’ONU avant de nous prononcer.
b) Sur l’effet déstabilisant d’une intervention dans la région
II – Ensuite, au niveau local, la situation n’est pas aussi manichéenne que nous l’imaginons. La guerre civile en Syrie est protéiforme, multidimensionnelle, complexe par ses racines ethniques, religieuses et historiques. Elle ne peut se satisfaire d’une réponse simple.
Ce conflit ne se résume pas à l’émancipation d’un peuple du joug de son dictateur, comme on tente de nous le faire croire, mais il a révélé un caractère multiconfessionnel, vecteur de radicalisation.
L’opposition, on l’a dit est plurielle. Ses différentes composantes que sont l’armée syrienne libre (ALS), la coalition d’opposition, les islamistes et les Kurdes syriens où l’équilibre des forces est déjà en faveur des islamistes, ne défendent pas le même projet de société, et portent déjà en leur sein tous les ingrédients d’une guerre civile.
La population syrienne se partage entre Arabes sunnites (60 %), chrétiens (10 %), alaouites, ramification chiite (12 %) druzes (6 %), et diverses minorités ethniques sunnites, principalement kurdes et arméniennes.
Le régime syrien s’est appuyé pendant près de quatre décennies sur son groupe religieux les alaouites qui se sont alliés aux chrétiens et aux druzes notamment.
Les alaouites représentent 140 000 des 200 000 soldats de métier dans une armée qui compte environ 300 000 soldats actifs. Environ 80 % des officiers sont alaouites et les 20 % restants représentent les ethnies alliées au régime. L’opposition syrienne est essentiellement sunnite.
À l’instar du Liban et de l’Irak, tous les éléments sont en place pour que ce conflit dégénère en guerre ethnique et religieuse.
Force est d’admettre que si ce constat ne doit pas limiter notre aide, il contraint de fait notre action.
Modifier l’équilibre des forces par la paralysie des moyens du régime risque de profiter aux forces les plus radicales.
Dans cette configuration de guerre civile, initier une intervention entraînerait à coup sûr une déstabilisation de la région (les flux de réfugiés déstabilisent déjà les États voisins (Turquie : 350 000, Jordanie : 375 000 ; Irak Kurdistan : 121 000).
De vacillante, la situation sécuritaire régionale ne peut que sortir dégradée, voire simplement annihilée pour l’Irak, le Liban, et la Jordanie.
c) Sur l’efficacité limitée d’une intervention
III – Les conséquences possibles d’une intervention en termes d’escalade de la violence, d’impact sécuritaire régional et de rupture de la légalité internationale exigent une prise de recul dépassant la réaction émotive ou l’opération vengeresse.
Or, c’est précisément l’efficacité même de cette intervention qui interpelle.
Quel est l’intérêt de lancer des frappes aériennes sur des cibles du régime, alors que nous savons que tous les centres de commandement et de communications ont déjà été évacués ?
Quel est l’intérêt de lancer des frappes aériennes en Syrie, alors que les Etats-Unis ne veulent pas renverser le régime en place ?
Quel est l’intérêt de lancer des frappes aériennes, si elles se révèlent incapables de renverser le cours de la guerre civile en Syrie et si elles ne font qu’accentuer le fossé entre Russes, Chinois et Américains ?
Punir le régime de Bachar el-Assad n’est qu’une réaction de court terme. La solution à ce conflit est avant tout politique.
Les responsables de notre diplomatie, et par ricochet ceux d’EELV, devraient garder leur sang-froid.
Le devenir de la Syrie et le peuple syrien méritent mieux que nos approximations et nos incertitudes.
La France doit être force de proposition avec un plan d’action pour relever la Syrie en associant tous les acteurs de la région ; à commencer par l’Iran qui cherche manifestement à rétablir le dialogue.
Enfin, le temps des protectorats est révolu. Plutôt que de se tourner vers l’Angleterre dans la nostalgie d’un XXe siècle qui n’existe plus, la France devrait contribuer à la construction d’une diplomatie européenne qui seule a du sens dans la nouvelle donne planétaire.
Leila Aïchi
Sénatrice de Paris, groupe des écologistes
Secrétaire du bureau de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
32 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON