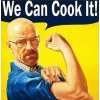Réflexions sur le Christianisme et l’Etat Moderne
La vigueur contemporaine des jugements parfois portés par certains intellectuels à l’encontre du christianisme mais, également, à l’égard des concepts d’Etat et de modernité témoigne d’une actualité paradoxale de ces trois éléments, Christianisme, Etat et Modernité, mais aussi, et c’est un second point, d’une potentielle généalogie commune. L’Etat Moderne occidental est, en effet, le produit d’une histoire ancienne que l’on peut relier à l’essor du capitalisme marchand sous une dimension inédite n’ayant connu aucun équivalent quantitatif et qualitatif par le passé, que ce soit pendant l’antiquité ou au moyen-âge.
Beaucoup résume l’ouvrage de Weber comme étant l’affirmation de l’apparition progressive dans notre histoire d’un cadre de pensée qui, par un rapport nouveau de l’individu à la richesse et au travail, a permis l’essor d’un capitalisme marchand exponentiel qui a lui-même servi de base aux révolutions industrielles du 19ème siècle tout en ayant puissamment transformé les mentalités occidentales dans le rapport qu’entretenaient celle-ci vis-à-vis de toute une série de domaines, ces mentalités s’affranchissant de l’héritage chrétien traditionnel (qu’on pourrait qualifier au prix d’un anachronisme de catholique) qui s’imposait culturellement jusqu’à lors. En cela, Weber serait un idéaliste ce qui le différencierait du matérialisme historique de Marx. Si une telle présentation permet une réduction de la complexité et une facilitation de la compréhension générale des thèmes que nous abordons ainsi, elle est grandement insuffisante pour dresser un tableau le plus fidèle possible de la réalité historique de cette époque riche en mutations fondamentales.
Il serait en effet faux, suivant le cours résumé ci-dessous, de déduire des travaux de Weber que le capitalisme moderne n’ai pu naître qu’en raison d’un cadre religieux muté alors même qu’il ne fait que déduire, de l’émergence d’un style de vie particulier, disons calviniste, une facilitation de son émergence. Par ailleurs, il serait injuste de qualifier, à mon sens, d’idéaliste un théoricien comme Weber qui se distingue par une certaine prise de distance à l’égard de sa propre religion pour tenter d’en cerner ce qu’il appelle « les effets de récompense » en parlant des attentes qu’ont les individus à l’égard de leur propre religion. Enfin, affirmer que l'émergence du protestantisme, à elle seule, ait servi de base aux révolutions industrielles du 19ème siècle, revient à mon sens à faire un bond audacieux dans le temps un peu facile et court. Il est important de garder en tête, lorsqu’on tente de porter un regard le plus neutre possible sur l’histoire, qu’il faut tenter de saisir la complexité de la formation d’une réalité à un instant T, sous influence d’un instant T-1, mais que les choses auraient pu être autrement, les explications d’un évènements sont multiples, les regards sur un même évènement sont toujours pluriels et rien, jamais, ne peut être observé sous un angle aussi linéaire.
Dans cette perspective comprendre le grand bouleversement théologique et moral apportée par la réforme ne se fera, ici, que dans une démarche analytique qui privilégiera d’avantage, je le confesse, l’étude de ce que certains retiennent comme des ruptures formées « ex-nihilo » mais que l’on doit situer, en réalité, dans un cadre plus large où s’entremêlent continuités historiques et périodes révolutionnaires. Pour résumer dans un souci de vulgarisation l’idée centrale de cette présentation, le Christianisme, en tant qu’entité non-monolithe sujette à des bouillonnements théologiques internes dans lesquels s’est inséré la réforme, a permis, en partie et par effet de ricochet, une modification des mœurs propice à l’expansion du capitalisme marchand de l’époque et, par effet d’adaptation, une réorganisation générale de l’Etat, ce dernier s’étant retrouvé dans un certain nombre de pays européens dans une situation où le rapport qu’il entretenait avec la société civile était fortement perturbé.
Pour synthétiser les choses d’une manière volontairement provocatrice et dénuée de nuances, on tentera de questionner ici l’idée selon laquelle le Christianisme a permis l’expansion du capitalisme qui aurait lui-même permis la constitution de l’Etat-Moderne. Par cette présentation excessivement synthétique des choses on découvrirait donc un lien de causalité entre le Christianisme et la lente et laborieuse émergence de l’Etat-Moderne. Une telle approche ne se paiera toutefois pas le luxe d’omettre les particularismes historiques nationaux dans la réception de la réforme, l’importance des structures familiales, les flux démographiques, la révolution pastorienne, la question de l’impôt, la contre-réforme, etc. Toutes ces nuances, séparées parfois par plusieurs siècles, ne pourront être invoquées, n’étant pas historien je l’admets, que dans une certaine superficialité qui essaiera de rendre compte de la complexité d’une frise de temps extrêmement large, passionnante par ses bouleversements, dont nous sommes les héritiers.
Christianisme et individualisme
A sa naissance, le Christianisme est une religion subversive qui rompt avec le caractère holiste des sociétés dans lesquelles il s’insère alors, notamment en ce qui concerne l’Empire Romain. On entend par holiste les sociétés qui mettent l’appartenance au groupe, à la tribu, la communauté, comme supérieure à un individu pris en soit et indépendamment des autres. Dans les sociétés holistes, l’individu ne possède pas d’existence propre en dehors du groupe. Ce qui différencie le christianisme alors des anciennes religions polythéistes c’est la dimension de salut individuel que celui-ci met en avant, une notion primordiale qui sera l’obsession des chrétiens de toute sorte. Cet aspect du salut de l’âme est sujet dans le Christianisme à des interprétations diverses, ce qui ajoute à la complexité. Pour parler vite, certains diront que c’est un mode de vie ritualisé par l’église, couplé à une série de comportements magico-sacramentels, qui est sensé conduire à la vie éternelle, cela relève plus d’une sensibilité catholique, alors que pour d’autres on retrouve l’idée d’un salut prédéterminé par la volonté de Dieu et l’élection, ce qui relève plus d’une sensibilité protestante. Dans cet ensemble il est important d’extraire à la lumière de l’analyse un élément crucial qui est celui d’une séparation de l’individu par rapport à la société et au groupe dans un rapport individuel à Dieu à travers la prière notamment. En effet, le christianisme invite à se plonger en soi dans la relation entretenue avec le divin. Parallèlement, l’idée d’un salut individuel, d’une acquisition de la vie éternelle non-automatique mais adaptée à son particularisme personnel, en fonction de ses propres actions passées évaluées au cas par cas par le seigneur, peut permettre d’avancer l’idée selon laquelle un humus individualiste est constitutif de la religion chrétienne, comme l'affirme Alain de Benoist. On ne peut affirmer cela sans toutefois rappeler immédiatement le fonctionnement communautaire, holiste, des églises chrétiennes qui vont structurer le Christianisme à partir du moment où cette religion sera récupérée par les élites romaines de l’époque. L’intrusion, par ailleurs, du christianisme dans toutes les sphères de la vie privée de l’individu, du berceau à la tombe, en font une religion totalisante, en matière de sexualité, d’adultère, de rapport au travail, à la richesse, etc., cela impose au chrétien un mode de vie préconçu et prédéterminé par Dieu qu’il doit, individuellement, respecter pour avoir accès au salut de son âme.
Par cette rapide présentation on comprend mieux comment les rapports entretenus entre le Christianisme d’une part et l’individualisme d’autre part seront paradoxales, conflictuelles voire contradictoires. Ceci s’explique en partie par la pluralité et la richesse de la littérature théologique chrétienne qui a fourni des sources d’interprétation des textes sacrées jusqu’à proposer parfois un dépassement habile de ceux-ci face aux impasses dans lesquelles ils mettaient le pouvoir ecclésiastique face à des mutations politico-religieuses inattendues.
Il faut savoir se garder d’une vision binaire des choses mais on peut dire que la rupture entre catholicisme et protestantisme s’articule autour de cet humus individualiste. Le catholicisme se pose comme un christianisme de la conscience encadrée par l’église tandis que le protestantisme s’affiche comme un christianisme de la liberté (relative) de conscience affranchie des structures vaticanes. Le luthéranisme est un christianisme assez austère de la conscience qui réfute le déterminisme imposé par le péché originel, si l’on est chrétien on est naturellement porté vers le bien, sinon ma foi n’est pas bonne. Ceci consiste à affirmer un élément important, commun au christianisme, qui est celui de la négation du libre arbitre liée au poids du péché originel. Pour le protestant, on est un bon chrétien ou on ne l’est pas il n’y a pas de juste milieu et, de plus, notre qualité de chrétien dont dépend le salut de notre âme ne dépend pas de nous mais de l’élection et de la prédétermination voulu par Dieu. L'élection exclut dans le protestantisme puritain toute compassion envers ceux qui ne sont pas élus, on a plutôt une conscience de sa propre supériorité et un vrai mépris. De ce point de vue, le catholicisme est cependant plus ouvert à la miséricorde, au pardon et à la confession bien qu’il pose l’être humain comme salit à jamais par le péché originel. Le Dieu des catholiques n’est pas un Dieu sévère et l’existence n’en est pas une, c’est une vallée de larmes qui doit préparer l’être humain à la vraie vie, la vie éternelle. Cette négation du libre arbitre peut nous sembler, à nous, étrange. Si le protestantisme nie le libre arbitre, où est l’innovation ? Comment expliquer son succès alors qu’on entend partout, aujourd’hui, des entrepreneurs se vanter de leur réussite et décrire celle-ci comme résultante de choix qui sont les leurs, l’expression de « Self Made Man » est caractéristique d’une association entre le libre arbitre de l’individu et sa réussite, mais aussi ses échecs (le regard porté sur les chômeurs par nos libertariens contemporains et très significatif de cette mentalité).
Et bien l’innovation du protestantisme, essentiellement par le calvinisme, a été de dire aux marchands chrétiens de l’époque, à travers le concept de l’élection, que s’ils sont riches c’est là le signe qu’ils sont élus de Dieu, qu’ils sont prédestinés à accéder au royaume des cieux. On ne peut comprendre avec nos lunettes contemporaines et nos catégories culturelles actuelles ce mode de pensée très particulier de l’entrepreneur du 16ème siècle, époque que Weber décrit comme « un capitalisme héroïque » où l’entrepreneur est perçu comme un vrai aventurier. Par ailleurs, il n’est plus dit que « Dieu existe pour les hommes » mais que les hommes existent pour Dieu. Que signifie ce renversement de perspective ? Et bien que les hommes doivent travailler à la gloire de Dieu et que le sens de leur existence, la recherche du salut de l’âme, ne peut s’opérer que par la production de richesses que les calvinistes voient comme une conséquence de la prédestination. Là où les chrétiens traditionnels voyaient dans le travail une punition divine issue du péché originel, les protestants le voient comme un outil devant servir la gloire de Dieu. En réponse, l'église catholique fera passer le concept de travail d’une punition à un moyen de rédemption personnel.
On ne peut parler d’individualisme sans conclure sur le libéralisme, donnée fondamentale de nos sociétés individualistes hédonistes modernes. Comme l’individualisme, le libéralisme n’est pas le fruit d’un homme seul, d’une pensée unique, monolithe et uniforme. Cependant, on ne peut nier des points communs entre ces auteurs, des points communs qui permettent de définir le libéralisme, au-delà d’une philosophie politique, comme une école de pensée. On peut ainsi dire que le libéralisme se structure sur deux versants : un premier versant économique, qui pose le marché autorégulateur comme la donnée explicative de tous les faits sociaux, et un second versant politique qui tente de déduire de la doctrine économique des principes politiques applicables à la société, des principes qui tendent à la limitation relative ou exarcerbée de l’emprise de l’état sur la société civile. Comme l'affirme Alain de Benoist, en étant une sorte de libéral radical, on pourrait dire "qu’une politique libérale est ainsi une contradiction dans les termes". Qui plus est, le libéralisme se fonde sur une anthropologie de type individualiste défendant une vision de l’homme comme un être non-social. On a, auparavant, procédé à l’historique de la notion en montrant comment l’individualisme, par le christianisme, avait pu s’imposer face aux sociétés holistes, qui justifiaient leur existence par des valeurs héritées, transmises et partagées entre les individus. Quand le christianisme des origines cherchait à faire du chrétien « un individu hors du monde », entretenir une relation avec dieu à travers la prière impliquait de renoncer au monde, le christianisme protestant réintroduit le chrétien dans le monde. Celui-ci cherche à glorifier le divin à travers la quête d’un succès matériel qu’il interprète comme la preuve de son élection. Ce renversement fut décrit, notamment, par louis Dumont. C’est dans cette perspective globale qu’on peut comprendre comment, au sens de Constant, fut défaite la liberté des Anciens, celle de l’agir politique du citoyen dans la cité, par celle des modernes, se caractérisant par « la jouissance paisible de l’indépendance individuelle privée ». C’est autour de cet ensemble individualiste que s’intensifiera l’individualisme, notamment Hayekien, qui affirme, comme le rappelle Alain de Benoist, "que ce n’est pas la liberté qui permet l’échange mais l’échange qui permet la liberté". Dans cette mesure, "en dehors du marché il n’existe pas de liberté".
28 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON