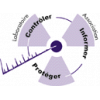Difficile de savoir si les aliments que nous achetons ont été irradiés ou non. Officiellement l’étiquetage est obligatoire, et les contrôles existent. Dans les faits, les fraudes sont courantes et l’information est rarement au rendez-vous… Technique utilisée par les industriels de l’agroalimentaire pour conserver ou même "assainir " certains produits en les soumettant à des rayons ionisants puissants avant commercialisation, l’irradiation des aliments fait officiellement l’objet de l’attention des autorités sanitaires internationales. La FAO1souligne que l’" irradiation ne doit pas se substituer aux bonnes pratiques".
Entre le discours et la réalité, la différence est grande. Il est tellement plus simple pour les industriels d’irradier des produits qui, autrement, du fait de mauvaises pratiques agricole, de transport, de stockage, de fabrication ou de conditionnement, ne seraient pas considérés comme consommables. D’autant plus, qu’il est très difficile ensuite de montrer que le producteur a eu recours à ce procédé.
En France, l’irradiation est autorisée pour de nombreux aliments ( viande de volailles, blanc d’œufs, échalotes, ail, épices, fruits secs, farine de riz, crevettes congelées décortiquées….). Ce traitement a un impact sur les produits : altération de la qualité nutritionnelle2, risque de prolifération de bactéries résistantes aux radiations faute de microbes concurrents, absence d’effet sur les toxines libérées par les bactéries, formation de radicaux libres et de produits néoformés3, ce qui pose également des problèmes de salubrité.
Des étiquetages assez flous
Les techniques d’irradiation des aliments utilisent des radiations bêta ou gamma très énergétiques. Les doses autorisées sont basées sur une valeur moyenne exprimée en KGray 4. On notera cette notion ambiguë de " moyenne ". Les produits sont convoyés sur des palettes autour d’une source de radiation fixe, ce qui implique que la partie la plus proche de la source recevra plus que la partie opposée.
Du point de vue de la réglementation, l’irradiation des aliments est assimilée à un "additif alimentaire". Le produit doit donc être étiqueté en conséquence et l’information doit apparaître sur l’emballage selon la terminologie "traité par ionisation" (le terme ionisation inquiète moins le consommateur que le mot irradiation). Aux Etats-Unis, on utilise même la mention "pasteurisation à froid", qui induit une confusion supplémentaire. Il existe même un logo "Radura" facultatif en France. En revanche aucune information n’est prévue sur la date du traitement et la dose reçue par l’aliment.
De plus, certains composés échappent à l’étiquetage obligatoire : les fruits et légumes en vrac ainsi que les ingrédients qui entrent dans des plats composés (notamment pour les épices).
Trop peu de contrôles
Au niveau européen, il faut souligner une énorme disparité dans les contrôles destinés à détecter les irradiations non déclarées ou les défauts d’étiquetage. Certains pays ne font aucune vérification, d’autres ciblent uniquement certains produits. Ce qui complique encore les choses, c’est que tous les Etats membres de l’union européenne n’ont pas la même liste de produits autorisés.
En France, quelques contrôles sont réalisés chaque année par la DGCCRF5. En 2006 par exemple, 216 échantillons ont été contrôlés, avec un taux de fraude de 14,8% et seulement 117 échantillons en 2007 pour un taux de fraude de 5,13%. Ces cas concernent surtout des importations venant d’Asie où aucune des installations d’irradiation n’est agréée par l’Europe, condition obligatoire pour l’importation de produits irradiés.
Le dépistage
Les examens révèlent beaucoup de cas incertains et, suivant les autres traitements subis par les aliments ( froid, pression, additif chimique...), les méthodes perdent encore en fiabilité. Aucun examen ne permet de déterminer la dose reçue et la date du traitement.
En France, un seul laboratoire est habilité, ce qui est nettement insuffisant, et le prix des analyses empêche la systématisation. La DGCRF a reconnu manquer d’informations pour cibler les contrôles et s’est déclarée ouverte aux conseils du collectif contre l’irradiation des aliments pour mieux cibler ses analyses.
1 - FAO : organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation.
2 - Plusieurs études ont démontré que certaines vitamines résistaient mal à l’irradiation (c’est le cas des vitamines A, B1, C, E….).
3 – Etudes de toxicologie en cour portant sur les alkylcyclobutanones. Ces molécules se forment lors de l’irradiation des lipides (ionisation des viandes en particulier). Or, il est aujourd’hui admis que ces molécules sont cancérigènes.
4 - La dose exprime la quantité d’énergie délivrée par quantité de masse. Les doses couramment utilisées pour irradier les aliments sont de l’ordre de 100 Gray à 10 KGray. Les doses les plus faibles sont utilisées pour obtenir l’inhibition de la germination des aliments type pommes de terre et oignons. Les doses les plus élevées pour la stérilisation des repas des destinés aux patients immuno-déprimés par exemple.
5 - DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.