Corps en stock
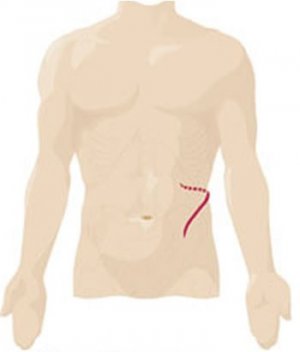
« Plutôt qu’argent amasser, mieux vaut santé posséder », énonce un proverbe anonyme ; « existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé ? », aurait dit Socrate. Sagesse populacière comme réflexion philosophique se rejoignent coutumièrement pour vanter la supériorité insigne de l’être sur l’avoir ; est misérable celui dont le corps, tout chamarré soit-il, gît sans vigueur ou se délite à mort ; est riche de la conscience et du plaisir de vivre celui qui meut le sien sans faiblesse. On ne peut acheter la santé, croyait-on autrefois. Mais au vent de notre postmodernisme échevelé, qui court plus vite que sa propre peur eschatologique, même les truismes se sont desséchés. La santé est désormais un produit comme un autre qui obéit aux exigences voraces du dieu Marché : avec une bourse bien garnie, on peut donc s’en payer une tranche, fraîchement découpée sur le corps d’autrui.
Non pas forcément un mort, qui quelles que furent ses espérances et illusions transcendantales, n’en a assurément plus besoin pour pourrir ou se consumer, mais qu’un respect de bon aloi pour l’humain qu’il fut conduit à demander, avant de lui ôter l’utilisable, permission à ses proches. Ce qui est loin d’être toujours le cas. On connaît désormais le business rouge juteux que fait le gouvernement chinois de la vente d’organes de milliers de condamnés annuels à la peine capitale, dont l’exécution est programmée en fonction des demandes d’organes et de l’arrivée des receveurs ; ce commerce est si lucratif (62 000 $ le rein, 150 000 $ le poumon, 30 000 $ la cornée) qu’il est devenu plausible qu’il puisse en grande partie motiver la sévérité des condamnations et le maintien de la peine capitale. Mais dans bien d’autres pays, la mafia internationale des voleurs d’organes se sert sans coup férir sur les cadavres, ainsi que le révèlent les travaux de l’anthropologue américain Nancy Scheper-Hugues qui s’est consacrée à enquêter sur ces trafics.
Justement non, pas seulement les cadavres. Car les morts se prêtant de manière compétente aux transplantations ne sont pas assez nombreux ou disponibles pour couvrir les besoins des malades des pays riches en attente de greffe. Et puis un mort n’est pas forcément convenable... Tant qu’à prélever sur la bête, mieux vaut qu’elle soit jeune et robuste, et non une carne usée par les travaux pénibles ou l’excès d’alcool... Au Brésil, un chirurgien a confié à Nancy Scheper-Hugues que la plupart de ses patients refusaient tout organe prélevé sur un mort anonyme. Ailleurs, elle a rencontré des receveurs qui demandaient à voir le vendeur avant l’opération ; « il était jeune, sain, fort. Il avait tout ce que je voulais », explique l’un d’entre eux à propos du paysan géorgien de 22 ans dont il achetait le rein. Au catalogue des réservoirs d’organes, le vivant est le mieux coté.
Suivant les cas, 1 000 $, 2 000 $, 1 400 €, 3 000 € sont le prix de son rein, de ses séquelles, d’un suivi médical inexistant. Car ce vivant-là est pauvre. Forcément. C’est son essence, son ontologie intime, la justification de son sacrifice : car qui se résoudrait à se faire trancher un morceau de son corps pour le vendre, s’il n’y était contraint par la misère, et autorisé par des carences législatives ou des pratiques criminelles ? « En règle générale, les organes transitent du Sud vers le Nord, des pauvres vers les riches, des Noirs vers les Blancs et des femmes vers les hommes. Aujourd’hui, des touristes de la transplantation peuvent se rendre dans des établissements médicaux haut de gamme, en Turquie, en Europe de l’Est, à Cuba, en Allemagne ou aux Etats-Unis, où l’on pratique les greffes sans délais et sans risques. Ces cliniques offrent parfois des prestations dignes d’hôtels quatre étoiles, ou ressemblent, à Cuba par exemple, à des centres de remise en forme pour vacanciers de la jet-set », explique l’anthropologue. Le sous-continent indien représente un vivier inépuisable, constitué notamment de jeunes femmes qui vendent leurs organes pour se constituer une dot ou rembourser les prêts accordés à leur mari ; les offres sont publiées dans les petites annonces des journaux, de même qu’en Amérique latine. Les pauvres de certains pays européens de l’Est ne seraient pas en reste.
Sainte Fantine, le fruit de vos entrailles est cessible ; mais Les Misérables, de nos jours, ne serait plus qu’une histoire pour la Bibliothèque Rose. Cheveux et incisives ? Bagatelle. C’est d’un rein ou d’un œil que le pauvre hère se prive pour donner du pain aux siens, et quand il n’est pas volontaire, on se passe même de son assentiment. Prospère de par le monde un trafic d’organes prélevés à l’insu des victimes (à l’occasion d’une intervention chirurgicale), ou bien de force. On kidnappe, on ouvre, on se sert, et on renvoie le fournisseur involontaire à sa géhenne quotidienne. C’est ce qu’a récemment mis en lumière le démantèlement de la florissante petite entreprise du Dr Amit Kumar, qui dans sa clinique clandestine près de Delhi prélevait des reins à des paysans, amenés sur place sous la menace, et pour 50 000 € les transplantait à de fortunés receveurs. Après huit ans de pratique, il s’était fait construire une somptueuse propriété au Canada. Il a été arrêté au Népal en février dernier.
Ses victimes mêmes ne seraient pas encore les plus malchanceuses, semble-t-il : parfois, le réservoir d’organes y perdrait même la vie ; dans le pauvre, tout est bon ; des charcutiers-chirurgiens se chargent de les éparpiller façon puzzle dans le monde des organes riches et malades. C’est ce que révèle l’ex-procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Carla del Ponte, dans son livre récemment paru La Chasse, moi et les criminels de guerre ; selon elle, des leaders du Kosovo, dont le Premier ministre actuel Hashim Thaçi, ont trempé en 1999 dans un trafic d’organes prélevés sur 300 prisonniers des deux sexes. Après avoir subi l’ablation d’un rein, ils auraient été mis à mort pour leurs autres organes. Les preuves en sont toutefois insuffisantes, admet et déplore Carla del Ponte.
Des abattoirs pour humains. Ces horreurs ne sont ni de la science-fiction ni de l’histoire, ne sont pas le fruit d’une idéologie nazifiante ; elles sont le rejeton tératologique de notre présent, de notre monde de croissance matérielle exponentielle et de logique productiviste où, dévoyant les progrès médicaux, des morceaux de chair humaine se commercialisent et génèrent du profit, par le truchement de « courtiers » chargés de mettre en relation fournisseurs, vendeurs et acheteurs. On s’indigne, évidemment. Mais jusqu’à quel point, recouverts que nous sommes par une gangue de désabusement et d’écœurement las ? On peut légitimement s’interroger, à voir par exemple les magazines féminins juxtaposer, parfois sur la même page « d’informations », une Indienne épuisée qui a vendu son rein, la somme versée pour cet organe, et un vêtement de luxe qui, sur l’échelle des valeurs monétaires, lui est nettement supérieur - trois ou quatre tissus humains pour une étoffe ou un cuir manufacturés. Serions-nous donc si peu nombreux à être heurtés, non seulement par les faits, mais par l’indécence du télescopage et ce qu’il suggère de distraite habituation ?
Les vols d’organes sont évidemment des crimes, mais leur achat, des infamies. Du point de vue phénoménologique, ces pratiques trahissent un processus de déshumanisation qui met gravement à mal l’altérité : le corps du pauvre, symboliquement déconstruit, considéré comme une réserve de pièces détachées, est dès lors objet, non plus sujet. Rampe là en outre le plus abject darwinisme social : le riche, par essence plus méritant, a davantage besoin des organes sains du pauvre que le pauvre lui-même ; le corps intact de celui-ci, dernière possession, ultime intimité, condition nécessaire de la conscience et de l’expérience, lui en est d’autant rabattue. Cette captation coûte que coûte de l’organe salvateur trahit enfin, au-delà de la crainte normale du néant, le narcissisme ravageur de nos sociétés néolibérales pour lesquelles la mort du nanti est conceptuellement scandaleuse à partir du moment où existe un moyen, aussi contraire à l’éthique soit-il, de retarder l’échéance.
Cette exploitation ultime du corps humain peut aussi se comprendre comme la radicalisation de l’écrasement des valeurs humanistes par la logique commerciale. Dans certains pays, on vend encore des enfants ou des jeunes femmes ; mais on vend également son sang, ses gamètes, on loue son utérus comme une couveuse - la stérilité paraissant de même particulièrement incongrue à qui peut payer pour y pallier. Et, partout dans le monde, on pratique la location de ses organes génitaux, parfois sous la contrainte. Certes, cette transaction-là n’a rien de neuf. Mais foisonne de nos jours un discours férocement relativiste qui voudrait que tout soit égal à tout, et le travail du sexe tout à fait similaire au travail tout court. Balourdise antihumaniste. Outre qu’elle perpétue une hiérarchisation conservatrice des sexes et des conditions - qui agit de concert avec les diverses aliénations religieuses -, la prostitution, qui assimile la femme (le plus souvent) à un sac à sperme, est ouverture et découpage symboliques du corps, et marchandisation réelle de celui-ci. A un degré moindre, mais reliée malgré tout à la même taxinomie culturelle, se place l’exploitation publicitaire du corps érotisé de la femme (le plus souvent encore), abaissé au rang d’appât commercial, maintenu dans un statut d’objet et vecteur de consommation.
On ne peut banaliser la prostitution si l’on pense que des valeurs inquantifiables, fondées sur le relationnel, sont supérieures à la logique capitaliste basée sur la recherche, quels que soient les produits et les clients concernés, du profit financier ; et si l’on adhère à l’éthique ainsi énoncée par l’OMS concernant la cession d’organes et de tissus : « Le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent faire l’objet de transactions commerciales. En conséquence, il devrait être interdit d’allouer ou de recevoir un paiement pour des organes. [...] A la lumière des principes de justice distributive et d’équité, les organes donnés devraient être attribués aux patients sur base de la nécessité médicale et non sur la base de considérations d’ordre financier ou autre ». Quant à lui, le Conseil de l’Europe précisait que seul était autorisé le remboursement des frais, pertes de revenus et dommages éventuels liés au don. Il est évidemment souhaitable que le don d’organes, sauveur de vies, progresse en toute transparence et solidarité. Mais tout justement : le corps humain s’offre et ne se vend pas, sans quoi il se perd.
A l’évidence, seule une répartition plus équitable des ressources, et non le débitage corporel des plus pauvres, peut en outre constituer un remède éthique à la misère. Mais « nous ne sommes jamais sortis du temps des négriers », écrivait le situationniste Raoul Vaneigem (Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations), les trafics d’organes actualisant cruellement cette sentence de la pensée 68, qui contrairement à ce qu’une certaine propagande officielle voudrait nous faire croire - craindrait-on qu’on ne soit tenté d’en reprendre une bonne cuillère ?... -, n’a pas produit le libéralisme sauvage, mais au contraire une critique radicale de la marchandisation du monde ; réquisitoire dont la nécessité, à plus d’un titre, n’a jamais été plus criante.
Ventes et vols d’organes sont impossibles sur notre territoire, protégé par ses lois et ses pratiques bioéthiques, pensons-nous. Voire... Au Collège de France, on discute le "pour et le contre" de la vente, avec pour le premier des arguments ahurissants du style "la rémunération des donneurs amènera la société à considérer autrement les plus pauvres, à les considérer comme ayant une participation importante au bien public"... Aux Etats-Unis, face à la quantité des besoins, des médecins militent activement pour la légalisation du commerce d’organes. Qui nous assure que l’accroissement des inégalités sociales, la paupérisation accrue d’une partie de la population, la progression d’une vision utilitariste de l’économie qui s’interdit tout jugement moral sur l’acte de consommation, ne susciteront jamais chez nous des approvisionnements illégaux, voire un changement de législation ?
J’ai fait l’autre nuit un drôle de cauchemar futuriste : après deux offres d’emploi écartées, les chômeurs en bonne santé qui refusaient en dernier recours de se faire prélever un rein étaient rayés des Assedic...
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









