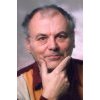Affaire Iacono : un énième Outreau à l’horizon
Le 11 mai dernier, Gabriel Iacono, dans un entretien donné à Nice-matin, a démenti les accusations de viol sur sa personne qu’il portait depuis onze ans contre son-grand père, Christian Iacono. Celui-ci, 76 ans, ancien radiologue, ex-maire de Vence et actuellement incarcéré, a déposé une demande de mise en liberté. Il maintient le pourvoi en cassation qu’il a déposé après sa deuxième condamnation, espérant que cette procédure sera plus rapide que celle d’une demande en révision.
Les dites accusations concernaient les années 1996 à 1998, époque où Gabriel était âgé de cinq à sept ans. Elles avaient été portées en 2000. C’était avant Outreau. Mais les deux procès ont eu lieu après. Le premier, qui s’est terminé par une condamnation à neuf ans d’emprisonnement, en 2009. Le deuxième, en appel, qui a abouti au même résultat, en février 2011. Autant dire qu’on s’achemine vers le constat d’une erreur judiciaire de grande envergure, réitérée, qui fait inévitablement penser à celle qui a suscité l’indignation générale en 2004.
Autant dire aussi que la même question se repose : à quoi a servi la tragédie de 2004 et les innombrables débats, travaux et commissions qui ont suivi, si la Justice reproduit les mêmes erreurs, quasiment en copier/coller ?
Pourtant, magistrats et jurés avaient de nombreuses raisons de se montrer prudents. Les agressions évoquées par Gabriel, censées s’être passées dans la maison de Christian, pendant les vacances, n’avaient pas de témoins. Mieux : les membres de la famille de Christian qui sous le même toit pendant ces périodes en affirmaient l’impossibilité.
Certes, comme à Outreau, les experts sont venus dire que Gabriel était « parfaitement crédible ». Mais comme ceux d’Outreau ont lourdement discrédité leur fonction, cela n’aurait pas dû influencer le jury.
Crédible, Gabriel ? Pourtant, il avait aussi mis en cause pour des attouchements un autre homme, qui avait ensuite été définitivement acquitté.
Certains passages de sa récente déclaration interpellent plus particulièrement :
J’y croyais vraiment. Et puis j’ai pris du recul et de la maturité. Dès la fin du second procès, j’ai commencé à me poser des questions. Cela a mis trois mois pour mûrir. (…) Cette scène, je continue à la voir, mais je ne la crois plus possible. J’ai peut-être effectué une transposition, désigné mon grand-père à la place de quelqu’un d’autre.
Ce qu’il exprime là relève très exactement de la théorie du faux souvenir. L’agression a bien eu lieu, mais la victime en attribue la responsabilité à un auteur fictif, parce qu’il lui est affectivement insupportable de l’attribuer à l’auteur réel. Il en existe une variante : l’agression n’a pas eu lieu, mais elle a été suggérée par une autre personne, à tel point que la personne suggérée croit en sa réalité.
Mais il faut un bon niveau de connaissances en psychiatrie pour connaître et dominer la théorie du faux souvenir. Qui possède ce niveau parmi les personnes impliquées ? Les policiers, les juges ? Quelques-uns, peut-être. Les jurés, qui viennent de tous les secteurs sociaux et professionnels ? Sûrement pas, et on ne peut pas le leur reprocher. Les experts ? En théorie, oui, mais à les entendre, il y a de quoi douter…
Pour rendre cette théorie opératoire dans un procès, il faut en outre y adhérer, ce qui est difficile, tant elle heurte le sens commun : comment un enfant, ou un adulte a priori sans histoire, peut-il s’inventer en tant que victime, ou inventer un bourreau qui n’est pas celui qu’il a réellement subi ? Apparemment, les professionnels de la Justice n’y adhèrent pas, et ils préfèrent d’autres croyances : l’enfant dit toujours la vérité ; la femme est toujours la victime ; l’homme est toujours le bourreau ; etc.
C’est pourquoi, en matière de mœurs, même si le fonctionnement judiciaire peut être amélioré techniquement de nombreuses manières, il a besoin avant tout d’une révolution culturelle. Il doit assimiler les ressorts profonds des nouveaux types de violence, comme les fausses accusations d’abus sexuel. Il doit moduler ses anciennes croyances : la parole de l’enfant doit être entendue mais non sacralisée ; la violence n’a pas de sexe ; le fort n’est pas forcément celui qui apparaît comme tel , le faible non plus.
Comme l’a fait avant lui une autre fausse accusatrice célèbre, Virginie Madeira, il reste à espérer que Gabriel ait la possibilité de décrire le plus précisément possible le processus par lequel il s’est fourvoyé jusqu’à détruire la vie d’un homme qui lui était cher, et comment il l’a stoppé. Cela donnera peut-être à d’autres faux accusateurs, et il n’en manque pas, le courage de mettre fin au calvaire de ceux qu’ils ont condamné pour des raisons qu’eux seuls connaissent. C’est le souhait de ce courage qu’ont déjà formulé les amis et soutiens du condamné Jean-Paul Degache.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON