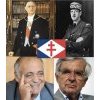Des individus et du projet de société
Anne Nivat note plusieurs fois que la conception française de la laïcité est mal comprise par les étrangers, notamment musulmans et elle essaie de l’expliquer. Sa bienveillance et son humanisme semblent la pousser vers le multiculturalisme : « notre capacité d’aveuglement et de surdité, cette propension à vivre les uns à côté des autres sans vouloir vraiment se connaître me paraissent immenses (…) Serions-nous résignés à vivre séparés et irrités ? Pour l’heure, il semblait plus raisonnable et réaliste d’accepter l’idée que notre société, par essence ‘multiculturelle’, soit de facto ‘une société sous tension’, ainsi que l’analysait avec pertinence Christophe Guilluy(…) Les Occidentaux, c’est bien connu, sont toujours prompts à célébrer la différence, mais, ils ne s’intéressent pas beaucoup à ce qui n’est pas eux ».
Dans la lignée de Guilluy, elle évoque Christophe, qui «
détaille cette peur saisissant le petit Blanc vivant au quartier, tout simplement parce qu’il s’y trouve en minorité » et ceux qui envisagent de devenir musulman «
tout simplement pour ne pas être différent : ils pensent que parce qu’ils seront musulmans, rien ne pourra leur arriver ». Pour elle «
ce phénomène de conversions, qui reflète une soif d’encadrement de la jeunesse, devrait être analysé en profondeur ». Pour elle, la religion remplit un vide en notant que les convertis ou born again sont plus extrêmes. Elle poursuit : «
je me fais la réflexion que les plus alcoolisés, les plus en détresse, les moins en bonne santé sont ‘les nôtres’, des Blancs » alors que les immigrés sont «
encore emplis d’une force qui pourrait déplacer des montagnes ».
La question du voile occupe une place importante. Elle évoque Leïla, une Tchétchène enceinte de son quatrième enfant pour qui « ce que les gens ne saisissent pas, c’est que mon voile, c’est ma différence. Il est mon identité. Donc j’y tiens. C’est tout ce qui me reste ! ». A Evreux une femme lui dit, au sujet du voile : « ces femmes sont libres et choisissent de s’enfermer ! Elles ont la possibilité de s’épanouir et elles se ferment ». Contrairement à d’autres épisodes, l’auteur prend leur défence en lui demandant si « ces jeunes filles se sentaient plus libres en portant le voile ? », soulignant que les femmes voilées des pays étrangers « sont parfois heureuses dans leur mariage, en tout cas, autant qu’on puisse l’être ». Au global, elle donne largement la parole à des femmes qui défendent le port du voile, au nom de leur liberté, évoquant une assistante scolaire qui « se voile au sortir de l’établissement, parce qu’elle assume son choix et en est fière. Ce voile l’aide à vivre ».
Elle évoque
ces quartiers où bien des femmes portent le hijab ou le niqâb, et cette jeune fille convertie en terminale, venant d’un milieu catholique, qui porte un hijab gris, qui, par le fait que cela lui donne une identité musulmane, la protège de la convoitise, la «
libérant » (sic). Pour l’auteur «
son discours, majoritaire parmi les femmes voilées, n’est quasiment jamais relayé dans les média ». Elle note cependant que «
s’il est un sujet qui fâche en France, et dont la complexité n’est pas comprise par les migrants musulmans, c’est bien celui-là ! » et note «
qu’ils peinent à accepter les lois françaises sur le sujet ».
Pour l’auteur, « on aurait jamais dû mettre les immigrés entre eux ». Mais elle dénonce aussi les propos de Valls sur « l’asservissement de la femme qui porte un burkini », s’appuyant sur la critique du New York Times, qui y voit un paternalisme et un moyen de détourner d’autres débats plus importants : chômage, croissance, terrorisme. Elle s’indigne : « comme Manuel Valls avait-il pu asséner de telles affirmations ? Comment pouvait-il se permettre de telles généralisations ? Qu’en savait-il ? ». Mais elle évoque aussi cette femme, française de souche, militante de gauche, qui dit avoir peur que ses filles tombent amoureuses d’un musulman qui leur impose une nouvelle vie. Et à Ajaccio, elle rapporte la crispation provoquée par le voile. Pour elle, « se questionner sur l’identité, c’est tester son degré d’ouverture, c’est montrer qu’on résiste à la tentation de la fermeture. En abordant l’identité corse, on s’approche du fantasme (…) L’identité française tend à se fondre dans un espace européen à faible identité, d’où cette sensation de dilution propre à générer des angoisses existentielles ».
Ce discours est connu, c’est celui de Macron, The Economist et du patronat. Réduire le débat public à un débat entre les ouverts et les fermés, par le jugement de valeur que cela représente, quand cela est fait par ceux qui se disent ouverts,
n’est-ce pas montrer qu’ils sont fermés et non ouverts aux opinions des autres, qu’ils rejettent par principe, dogmatiquement ? En outre, ce discours, probablement porté par une vision assez mondialiste de l’humanité, oppose de manière superficielle l’identité à l’ouverture. Pourquoi avoir conscience et être fier de son identité rendrait-il fermé ? Il me semble au contraire que ce sont ceux qui se sont éloignés de leur identité qui sont bien plus fermés à l’égard de l’autre, cherchant justement à l’éviter le plus possible. Dommage qu’elle n’ait pas noté ces paradoxes. En somme, son livre, s’il présente sans doute un portrait très juste de la France périphérique, reste peut être trop angélique et conformiste dans sa dimension politique,
quand celui de Gérald Andrieu savait aller beaucoup plus loin.
Source : « Dans quelle France on vit », Anne Nivat, Fayard