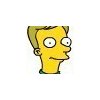De l’impossible conciliation de l’idée d’une « nature » en ville ?
A l’heure où viennent et reviennent sur le banc médiatique les questions d’ordre sociale, inhérentes aux préoccupations environnementales désormais légitimées par la déchéance écologique de notre monde, ce billet revient sur la difficile conciliation, ou réconciliation de la ville et de l’abstraite idée de nature...

Depuis le début des années 80 et a fortiori depuis le tournant du sommet pour la Terre de Rio en 1992, la question du développement durable, inhérent aux interactions mesurées et réfléchies entre les sociétés, leur économie et l’environnement, est devenu peu ou prou un enjeu commun aux peuples, aux nations, ainsi qu’aux « campagnes » et aux villes du monde.
C’est dans ce contexte favorable à la perméabilisation de la « nature » en ville, qu’est apparu le souci d’enrichir, par l’intermédiaire de la création ou de la valorisation d’espaces « naturels » urbains, un « écosystème citadin » déjà présent, mais jusque-là négligé au profit d’autres priorités (Arnould).
Marginalisés au cours des décennies 60 à 80 au profit d’une politique expansionniste de la ville et d’un accroissement des capacités fonctionnelles de la structure urbaine, souvent qualifiés à juste titre d’îlots d’artificialité superflus par une population citadine touchant peu à peu aux "lointains" espaces de nature authentique, les parcs urbains subissaient alors de plein fouet le dés-usage de leur espace et le désintérêt croissant de leur support de vie ou succombaient parfois tout simplement aux logiques des modèles d’aménagement, marqués par les valeurs de l’urbain.
Symptomatique d’une montée en puissance des questions environnementales au cours des années 90, mais également de l’accélération d’un processus de revitalisation des centres-villes qui tendent alors à se gentrifier, le retour de la "nature" en milieu urbain accompagne une vague générale de reconquête et de réappropriation de la "cité" au travers de nouvelles valeurs désormais portées à des considérations alliant avant tout les questions d’ordre social et environnemental.
Désormais modifiée, l’approche environnementale des parcs en ville ne se limite plus à la création d’un espace vert pour lui-même, en conservant le schéma d’« insularité » qui prédominait jusque-là (Boutefeu), mais tend plutôt à inscrire ces derniers, dans un système de « corridors naturels » ou biologiques. Des "voies vertes" à l’intérieur desquelles pourraient également s’inscrire de nouveaux modes de transports moins énergivores et plus doux. Des couloirs de la biodiversité en somme qui, dans la mesure de leur bonne conception (et ce n’est pas toujours le cas), participent de la fluidification ainsi que du dynamisme réciproque des écosystèmes de parcs urbains.
Si les actions directes de l’homme sur l’environnement des nouvelles formes de parcs urbains sont minimisées (utilisation d’engrais biologiques, tontes espacées des pelouses...) souvent après interventionnisme du projet de départ visant à réorienter les enjeux de l’espace en question, c’est en revanche au prix d’une augmentation des observations, des contrôles et des moyens allouées pour garantir leur intégrité écologique (Comtois & Fournier). Une intégrité qui, dans le cas des grands parcs naturels montréalais, par exemple, peut se voir mise en péril par l’introduction d’espèces invasives ou une importante fréquentation anthropique de leur milieu.
Le contexte de leur développement couplé à un pouvoir attractif sur les populations urbaines pose pourtant un souci plus large qui tendrait presque à faire des parcs écologiques urbains, mais plus généralement des espaces verts (puisque observable pour ces derniers), des « contre-modèles » de développement durable. Un modèle dont ces nouvelles formes de parcs urbains se veulent des pourtant des investigateurs...
En effet, il est établi que là où, au sein même de centres urbains denses, la proposition de "nature" en tant qu’elle s’exprime par l’intermédiaire d’espaces verts, est relativement abondante, les dynamiques foncières et immobilières s’en trouvent renforcées. Autrement dit, en s’inscrivant comme facteurs de vitalité du marché foncier, ces espaces participent qu’ils le veuillent ou non, du processus d’étalement urbain, en retranchant notamment, les populations à revenus modestes, au niveau des périphéries urbaines, là où l’offre de « nature » demeure suffisante et surtout plus abordable. Or, et cela n’est plus à prouver, l’étalement urbain dans ses fins tend à constituer un modèle de ville qualifiée de diffuse (écouter la conférence de Beaucire sur le sujet "ville compacte, ville diffuse") .
Un modèle qui apparaît dans ses formes, incompatible (sans doute au même titre que la ville compacte trop "radicale") avec l’idée d’un développement urbain durable au sens d’"équilibre" où nous pouvons l’entendre puisque la ville, par essence, est un organe durable.
La restauration d’une nature plus "sauvage", en tout cas d’une nature en apparence moins maîtrisée par l’homme pose également des questions quant aux attentes réelles des citadins. Bien sûr, la demande de nature est là, mais quelles formes prend-elle aux yeux de l’urbain ? Est-ce qu’elle se dessine en une large prairie d’herbe rase et verte à outrance, parsemée de pâquerettes ? Probablement en tout cas que cet aspect de la nature en ville apparaît plus répandu dans l’imaginaire rêvé du "Parisien", que la vue d’herbes anarchiques et sombres sur lesquelles il semble impossible de poser son pique-nique...
Au-delà des dynamiques contraires aux finalités souhaitées que pourront engendrer les parcs écologiques urbains, de nombreuses questions se posent. Quelle place donner à la "nature" en ville et sous quelles formes ? Comment redynamiser des écosystèmes urbains dont nous avons trop longtemps fait l’économie de la considération ? Faut-il se diriger vers un nouveau modèle urbain plus "environnemental", à l’image du modèle de la ville polycentrique (Ewing, Sénécal) avancé par certains ?
Et les modèles d’urbanisation ne sont-ils finalement q’une utopie ?
Et la question reste posée, ne trouvant finalement de réelle réponse. Peut-on concilier la ville à l’idée de nature (dans ce qu’elle sous-tend de représentations multiples) ?
5 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON