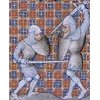Emploi du temps des enseignants et vrais problèmes des institutions françaises
Les élections présidentielles approchent, et les périodes pré-électorales se prêtent à des incidents mettant en évidence des doubles langages. Ségolène Royal n’aurait sans doute jamais parlé, dans une réunion de travail, d’imposer aux enseignants une présence de 35 heures hebdomadaires dans leur établissement, si elle avait su que ses propos seraient divulgués dix mois plus tard. Pourtant, à supposer que le débat électoral puisse encore avoir un sens après ving-cinq ans d’alternances de façade, c’est bien sur ce que les candidats pensent vraiment et comptent faire. La charge contre les enseignants ne paraît pas globalement fondée, mais le sujet mérite réflexion, à condition : a) de considérer l’ensemble du secteur public et de ses partenaires privés b) de ne pas concentrer l’analyse sur les agents « de base », mais sur les mélanges de fonctions, passerelles intersectorielles, emplois du temps... de coupoles, hiérarchies et corps réputés « d’élite ».
Il y a apparemment tout un tollé parce que Ségolène Royal a évoqué en janvier 2006 la question de la présence effective des enseignants sur leur lieu d’affectation. Son entourage s’est plaint du « coup bas » qu’a représenté dans son esprit la diffusion d’une vidéo où l’intéressée déclare notamment : "Comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient le temps d’aller faire du soutien individualisé payant et ils n’ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit dans les établissements scolaires ? " François Hollande a « rectifié le tir », mais rectifier n’est pas effacer. D’autant plus que le sujet est intéressant, que le monde politique ne tient pas à l’aborder en profondeur et que l’auteure de ces propos n’a pas forcément mesuré jusqu’où le débat pouvait mener. Encore, il convient de ne pas traiter une telle question de manière partielle, partiale, partisane... ou démagogique.
Rappelons d’abord que, dans les administrations comme dans le secteur privé, il a toujours été admis que des professions dont l’activité est censée se caractériser par un travail créateur et être jugée d’après des résultats individuels ne doivent pas se voir imposer le même type de contraintes de présence que celle des agents réalisant un travail de production, d’assistance administrative ou technique, d’attention au public... Un enseignant est censé assister à des séminaires, suivre des cours, rencontrer des collègues, participer à des colloques, rédiger des textes, lire et réfléchir calmement aux questions scientifiques et méthodologiques de sa discipline... Cette composante de l’exercice de ses missions exige une sérénité et une liberté de mouvements difficilement compatibles avec des règles rigides et des horaires administratifs.
De surcroît, il a été reconnu, après la diffusion des propos de Ségolène Royal, qu’en réalité les établissements scolaires ne disposent pas de moyens permettant d’accueillir leurs enseignants, lesquels se plaignent d’ailleurs d’une surcharge d’heures de cours et de copies à corriger. Et si on cherche à « compenser » un manque de moyens de l’Education nationale par un travail « à la chaîne » des enseignants, le risque d’une catastrophe éducative sera très grand. L’enseignant resté en permanence sur le site de son établissement se verrait à terme reprocher son « immobilisme », son « manque d’interaction et d’esprit novateur », etc. Quoi qu’il fasse, il sera toujours « mal vu ».
La liberté de mouvements et d’initiative des enseignants, comme celle de bien d’autres corps de fonctionnaires, est indispensable pour satisfaire aux exigences de qualité du service public. Le problème déontologique apparaît si cette souplesse est utilisée à d’autres fins et dénaturée au bénéfice d’intérêts personnels ou privés. Ségolène Royal évoque les risques de cumul injustifié, voire mal déclaré, d’activités professionnelles. Mais elle en parle uniquement pour les enseignants et dans le secteur scolaire public : pourquoi, alors que par sa nature, ce risque existe forcément dans un cadre beaucoup plus général ? La « précandidate » oublie également d’évoquer les dangers de détournements de la liberté de l’emploi du temps dans un vaste éventail de professions, pas uniquement dans l’éducation et dans le secteur public, au profit d’activités politiques ou parapolitiques. Des abus susceptibles de revenir, dans la pratique, à un véritable financement déguisé.
Et pourquoi ne pas avoir abordé la question de la « simple » dispersion d’activités, parfaitement légale et autorisée, mais susceptible d’affaiblir des services publics stratégiques ? Pas seulement pour des agents « de base », mais aussi et surtout pour des responsables et des fonctionnaires haut placés.
Juge administrative au début de sa carrière à la sortie de l’ENA, Ségolène Royal est bien placée pour savoir qu’en dehors des audiences et des réunions indispensables des formations de jugement, les contraintes de présence imposées aux magistrats ne sont pas sévères. Si un justiciable en litige avec une administration se présente soudain au tribunal et demande à consulter son dossier, il peut se trouver devant un greffier de section ou de chambre qui ne sait pas comment l’aider, car « les magistrats ne sont pas là » et « c’est eux qui ont le dossier ». Or, il semble bien qu’au moins une partie de ces absences soit due à l’exercice d’autres fonctions. La plus connue, traditionnellement, est celle de professeur ou maître de conférences associé à une université. La juridiction administrative n’est d’ailleurs pas la seule concernée.
Des juges enseignent également dans des établissements privés qui organisent des préparations à des concours. En toute légalité, explicitement autorisés ou nommés par les ministres compétents. De même, l’Etat n’a jamais objecté à ce qu’un président de juridiction à haut niveau puisse être en même temps professeur d’université. Y compris pour un président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat (le lien d’archive concerne la personnalité ayant exercé cette fonction jusqu’en septembre 2004) ou pour le Premier président de la Cour de cassation.
Avec tout le respect qui leur est dû, pourquoi des magistrats, dont la présence à temps plein auprès des tribunaux peut paraître si nécessaire, deviennent-ils, entre autres, des enseignants à temps partiel, alors que de nombreux universitaires sont au chômage et finissent par quitter le pays au bénéfice du tissu professionnel des Etats-Unis qui se nourrit de la « fuite des cerveaux » d’autres pays ? Et comment peut-on vraiment concilier la liberté académique, qui comporte celle de critiquer le fonctionnement des institutions dans le domaine de compétence de l’enseignant ou du chercheur, avec l’obligation de réserve qui s’impose à tout magistrat ou avec les intérêts qu’il peut incarner en tant que membre d’une corporation ? De surcroît, les universités et les organismes de recherche sont des justiciables, ce qui devrait faire obstacle à de tels mélanges de fonctions. Les tribunaux, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat... pourraient, à l’instar du Collège de France, organiser directement des enseignements et des conférences à l’adresse de tous les citoyens, et diffuser de manière autonome les travaux de recherche et d’analyse de leurs magistrats.
La Justice n’est qu’un exemple, mais la crise qu’elle traverse devrait faire réfléchir à ces questions pour l’ensemble de l’Etat, des administrations et du secteur privé partenaire de l’Etat. La magistrature peut, avec la bénédiction institutionnelle, se disperser dans d’autres fonctions à l’extérieur de ses institutions, mais on nous parle d’encombrement des tribunaux, de « jeunes juges seuls »... Sous prétexte qu’il y aurait de plus en plus de recours, les gouvernements de toute tendance politique ont contribué à mettre en place, depuis les années 1990, des procédures de plus en plus expéditives et sommaires, permettant d’éliminer rapidement les actions intentées par des « petits justiciables ». Ce que des internautes signalent depuis quelque temps, et que l’article d’Isabelle Debergue du 6 novembre rappelle, mais qui à présent a même donné lieu à un communiqué de plusieurs organisations s’inquiétant de l’imminence d’un nouveau tour de vis. Ce style de travail, et de relations avec les citoyens, de plus en plus « rapide », n’est pas spécifique à la Justice. Il s’est installé dans toutes sortes d’administrations et de services publics, au bénéfice des plus riches et influents, et au détriment, non seulement des plus démunis ou des salariés à revenus modestes, mais même d’une prétendue « classe moyenne » dont le statut social connaît une véritable dégringolade.
Il arrive souvent, d’ailleurs, que l’application de contraintes de présence plus sévères aux fonctionnaires qui ne font pas partie de la hiérarchie ni de corps dits « recrutés par la voie de l’ENA » ou via des filières analogues cache une souplesse croissante pour ces dernières catégories, qui cumulent de plus en plus d’avantages et ont joué un rôle essentiel dans l’évolution institutionnelle récente. On n’évoque guère, par exemple, le développement incessant de passerelles et de « partenariats » qui permettent à la coupole de la fonction publique d’accéder à des activités très bien rémunérées liées au secteur privé.
Quant à l’indépendance des institutions publiques, elle semble fondre à vue d’œil. La fondation Bettencourt-Schueller, créée par Liliane Bettencourt, principale actionnaire de la multinationale des cosmétiques L’Oréal, devrait financer à compter de janvier 2007 une chaire du Collège de France déjà officiellement annoncée avec l’intitulé : « Chaire d’innovation technologique -Liliane Bettencourt ». Comme par hasard, au moment du débat politique sur la question des autorisations des recherche dans le domaine de la génétique humaine, atteint depuis un an par le scandale de la falsification de résultats sur les cellules souches à l’Université de Séoul. La Fondation Bettencourt-Schueller accorde également, entre autres, des prix à des laboratoires de recherche publics. Cerise sur le gâteau, Dominique Strauss-Kahn, auteur avec Claude Allègre de la Loi sur l’innovation de 1999, a récemment déclaré qu’il trouverait normal le financement par EDF d’une chaire de physique nucléaire à l’Université Paris VI... La belle « apparence d’impartialité » pour les experts du XXIe siècle !
Et que penser du cumul, par Pierre Mauroy en 1981-1984, des fonctions de premier ministre et de maire de Lille, avec le danger évident de confusion d’intérêts dans une affaire comme le lancement de l’opération Eurotunnel, ou par Jacques Chirac qui fut à la fois premier ministre et maire de Paris ? Et comment Pascal Clément peut-il exercer à la fois deux fonctions aussi prenantes que celles de garde des Sceaux et de président du Conseil général de la Loire, avec également des risques de confusion d’intérêts ? Ce ne sont que quelques exemples, pas plus frappants que beaucoup d’autres.
Ségolène Royal est plus récemment devenue avocate, comme d’autres membres de la coupole politique. Il serait intéressant qu’elle dise aux militants de son parti et aux électeurs ce qu’elle pense de la double mission d’auxiliaire de justice et de « conseil » d’entités privées (notamment des banques, des multinationales...) que s’attribuent les corporations d’avocats. Lire, à ce sujet, un article d’Indymédia du 24 avril dernier, celui du 30 avril paru sur le même site ou encore celui d’Isabelle Debergue du 19 juin paru sur AgoraVox.
Bref, Ségolène Royal en a trop dit, ou pas assez. S’il faut s’attaquer à ces problèmes, ce qui serait la moindre des choses, alors, que chacun commence par balayer devant sa porte et qu’un état des lieux global sur la situation de l’ensemble de l’Etat, des administrations, des services publics, des professions proches de leurs missions, des grandes entreprises partenaires de l’Etat... soit dressé dans la transparence.
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON