Hubertine la suffragette
Le 21 avril 1944, la France accordait le droit de vote aux femmes. 65 ans plus tard, cet évènement majeur dans la vie démocratique de notre pays a été largement occulté par les conflits sociaux et la tragi-comédie des « excuses » de Ségolène Royal. Quelques jours plus tôt, je prenais un verre à la terrasse d’un café parisien rue de la Roquette (11e arrondissement). Juste au-dessus du bistrot était apposée une plaque à la mémoire d’une de ces « suffragettes » qui vous ont permis, mesdames, d’entrer dans l’isoloir…

Hubertine découvre le féminisme en juin 1872 au cours d’un banquet organisé par Léon Richer sur le thème de l’émancipation de femmes. Impressionnée par les conférenciers et par une lettre de Victor Hugo qui compare la condition des femmes à celle des esclaves, Hubertine décide de monter à Paris et de s’engager dans la lutte. Cette même année, Maria Deraisme jette les bases d’un féminisme structuré en France en créant l’Association pour les droits des femmes avec Louise Michel, Paule Minck et…Léon Richer. Ce combat inspire Hubertine, mais il ne va pas assez loin pour elle car il se limite à des revendications de reconnaissance de la condition féminine, mais sans aborder la question électorale, jugée trop sensible pour l’époque.
Pour un boycott des impôts !
Hubertine veut pourtant obtenir le droit de vote pour les femmes. En 1875, elle fonde l’association Le droit des femmes pour soutenir cette revendication, une association qui deviendra de manière plus explicite Le suffrage des femmes en 1883. Mais ses amies et elle restent isolées dans cette lutte comme le montre le Congrès International pour le droit des femmes : réuni à Paris en 1878, il n’aborde même pas le sujet. Entretemps, elle multiplie les courriers aux élus, aux ministres, aux généraux – et même au pape ! – pour faire avancer sa cause. Les courriers et les pétitions : grâce à l’une d’elles, elle obtiendra le droit pour les vendeuses des grands magasins de s’asseoir, ce qui leur était formellement interdit jusque là.
Soutenue par l’avocat Antonin Lévrier – qu’elle épousera en 1887 –, Hubertine tente d’organiser en 1880 une révolte des contribuables pour faire avancer sa cause : puisque les femmes n’ont pas le droit de vote, elles devraient également être dispensées d’impôt ! La République ne donne évidemment pas suite, mais l’affaire est montée jusqu’au Conseil d’État. Nullement découragée, Hubertine fonde alors le journal La Citoyenne afin de donner une tribune médiatique à ses revendications. Elle reçoit le soutien de la journaliste libertaire Séverine (Caroline Rémy) et de la grande artiste (hélas disparue à 26 ans) Marie Bashkirtseff qui publient des articles dans ses colonnes.
Outrée par la loi sur le divorce de 1884 qui avantage outrageusement les hommes, Hubertine milite pour la création d’un contrat de mariage instaurant la séparation des biens. Une idée trop avancée pour l’époque. Suit une parenthèse de quatre ans durant laquelle Hubertine, affectée par l’échec financier de La Citoyenne, suit son mari, Antonin Lévrier, en Algérie où il a été nommé juge de paix. Elle revient en France au décès de celui-ci et reprend sa lutte pour la cause des femmes. En 1900, elle fait partie des fondatrices du Conseil national des Françaises qui fédère la majeure partie des groupes féministes du territoire. Leur combat majeur : le vote des femmes.
L’urne brisée
La cause est juste, mais le combat est rude. Ces dames n’en obtiennent pas moins des avancées réelles, et notamment celle de 1908 qui voit enfin la loi reconnaître aux femmes le droit de gérer leur propre salaire ! Ce n’est toutefois pas suffisant pour Hubertine qui continue inlassablement de se battre pour le droit de vote. Après avoir symboliquement brisé une urne en 1908 pour protester contre la ségrégation électorale, elle fait scandale en se présentant en 1910 aux municipales du 9e arrondissement en compagnie d’une autre figure de proue du fénimisme : Marguerite Durand. Des candidatures aussitôt rejetées par le préfet de la capitale, mais qui n’en ont pas moins marqué les esprits.
Documents joints à cet article

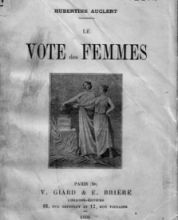
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









