Le droit complet à l’existence
"La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence." - Constitution de 1946, alinéas 10 et 11.
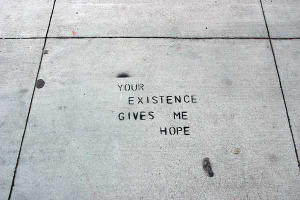
A cette époque, c'est dans la foulée d'un Welfare state plus généralisé que la France s'ancre un peu plus dans une révolution sociale débutée au XIXème siècle. L'État entre alors plus franchement dans des dimensions d'assistance et d'assurance sociale. La sécurité sociale se généralise et on voit entrer dans le champ politique des volontés majeures de redistribution sociale. Le principe est de reconnaître à chacun un droit à la ressource, indépendamment des cotisations. En finançant cette redistribution sur le revenu primaire des acteurs économiques, c'est un lien entre le travail, une économie socialisée et le droit qui est mis en œuvre. D'un point de vue économique, c'est aussi un soutien global et solidaire à la consommation et par ce biais un outil de relance.
Dans les conditions de notre temps, on ne résonne plus tout à fait de cette manière. A force de s'accorder aux volontés de l'époque, le taux de profit s'est décroché du taux de croissance, la part des revenus du capital progresse dans le PIB et celle des salaires diminue. Si la redistribution suit la croissance du PIB, elle ne fait plus vraiment partie des facteurs moteurs de la richesse globale.
Il est alors aisé de critiquer la redistribution ; Keynes n'a qu'à retourner dans sa poussière. Mais on détruit bien plus en faisant cela. La fondation des missions de l'État est d'autant plus facilement oubliée qu'elle s'établit sur un principe non local, et qui gène de sucroît profondément homo economicus. C'est dans ce sens historique que l'on a vu prétendre au poste suprême un Mr Fillon, après un Mr Sarkozy, réclamer la diminution du nombre de fonctionnaires au nom de celle des "prélèvements obligatoires", ou que l'on voit plus quotidiennement les JT recadrer sur le boulanger payant trop de "charges", et dont on sait qu'il se lève tôt. Les anecdotes sont immensément nombreuses. La sémantique de la solidarité économique et du salaire différé, elle, glisse peu à peu dans l'oubli.
Les mots sont parfois comme des petits moteurs. On peut les retrouver dans un dictionnaire, mais lorsque la société les chasse des praxis sociales, la voiture ne peut plus avancer. C'est ainsi que l'esprit du petit préambule de la Constitution de 1946 (solidarité, socialisation, droit) fuit dans le lointain au nom d'un principe de réalité bien étrange.
Un élan minoritaire pour une seconde révolution sociale
On a beaucoup entendu parler du revenu de base. Je n'ai pas envie de discuter de la façon dont il a été amené dans le mainstream, tant il est certain à mes yeux que les propos à ce sujet relevaient de l'arnaque. J'ai par contre conséquemment plus envie de souligner de quoi il retourne réellement chez les gens qui le conçoivent.
Il existe plusieurs modèles des revenus de base. Ce que je constate c'est que plus le trait est grossier, caricatural et peu crédible, et plus il est diffusé. C'est plutôt agaçant. L'occasion donc ici de parler de la teneur de la proposition, en partant des propos de Bernard Stiegler et de Yann Moulier Boutang.
C'est parce que les mots sont mal traités sous le temps rapide que la pensée disparaît. Il est important de considérer avant tout de quoi on parle. Si l'expression "revenu de base" indique qu'il s'agit d'un minimum, il ne dit rien de ce à quoi il se réfère. Stiegler et Boutang préfèrent parler de revenu d'existence : si chacun sait ce qu'on entend par base RSA, il invite un peu plus à se demander en filigrane ce qu'est, une existence. Une question au passage : qu'est-on censé défendre quand on défend une économie ou une politique ?
Sans en dire plus, le RE permet déjà de deviner qu'il s'agit de remettre en question le salaire, c'est-à-dire la notion de travail quotidien et à vie. Il s'agit donc d'abord d'une remise en question du travail. Personne n'échappe à notre temps, le plein emploi est terminé, l'égalité face à la qualification (nième héritage de notre constitution) est en passe d'être perdue au profit des marchés (loi Vidal) : Mr Macron fait lui aussi sa révolution.
En parler vraiment ?
Mais Macron n'est pas le seul. Si presque tout le monde a entendu parler des revenus de base, c'est parce que les capitalistes, qui ont compris que le rabotage Thatcherien des économies sociales pouvait conduire à un échec important de leurs positions, sont très intéressés par les solutions permettant de garantir une stabilité sociale. C'est Mr Villepin qui parlait déjà d'un revenu minimum de 900€ au temps contestataire du CPE (2006), lorsque étudiants et lycéens manifestaient (le feront-ils contre la loi Vidal en cours ?).
On sait aussi que qui tient l'outil détermine à quoi il sert. Les évolutions technologiques sont en passe d'approfondir la transformation. Les tableaux prédictifs dessinent une fourchette de 25 à 45% de chômage en plus avec l'arrivée des technologies dans le travail. Une situation politique ingérable, même pour des capitalistes puissants.
 A gauche, la tradition est aussi forte qu'elle a permis congé payé, assurance chômage, retraite et sécurité sociale. Un silence plane ; comment redéfinir la lutte alors que la classe sociale défendue est celle qui donne sa vie au travail. On voit aussi venir l'arnaque d'un revenu de base RSA avec suppression définitive du modèle social. Des moins que rien figés pour la vie. Quand on a tant tenu à la république sociale, on a du mal avec les idées qui prennent acte du délitement.
A gauche, la tradition est aussi forte qu'elle a permis congé payé, assurance chômage, retraite et sécurité sociale. Un silence plane ; comment redéfinir la lutte alors que la classe sociale défendue est celle qui donne sa vie au travail. On voit aussi venir l'arnaque d'un revenu de base RSA avec suppression définitive du modèle social. Des moins que rien figés pour la vie. Quand on a tant tenu à la république sociale, on a du mal avec les idées qui prennent acte du délitement.
La droite, elle, assise comme d'habitude sur ses valeurs d'ordre sociale, prêche la valeur travail. S'échiner toute sa vie pour trois sous. Même avec des ménages éclatés, même avec une mobilité urbaine qui clôt la filiation, même avec le devoir de se former à 50 ans. Pour un smartphone ou un compte facebook, proposition de la modernité. D'autres s'enrichiront, comme le montrent tous les chiffres de la croissance des inégalités.
Quand un modèle social est oublié, on reste stupéfait, mais le monde continue de tourner. En 2016, la Chine a investi dans 100 millions de robots. Le processus est déclenché.
Le revenu d'existence
Face au constat, la proposition de Stiegler et Boutang, qui ne sont pas des amateurs, est simple. Un revenu d'existence calé sur le PIB et le principe de salaire minimum (1000 - 1200€ actuellement). Pas de tergiversation : pas de pauvres dans les rues quand le champagne coule à flot. C'est un point barre.
Voici les conditions du revenu d'existence qu'ils proposent :
- le revenu d'existence est un revenu universel national, perçu de la naissance à la mort ;
- c'est un revenu individuel, qui s'adapte donc aux diverses mobilités dans le souci de l'autonomie de chacun ;
- il est structurel : il ne dépend pas du marché du travail ;
- il est cumulable avec un revenu (voir plus bas le revenu contributif) ;
- il est partiellement substituable (APL et Allocation Familiale seraient supprimées mais les fondamentaux telles que la sécurité sociale, la retraite et l'assurance chômage seraient conservées) ;
- son objectif n'est pas simplement d'assurer une stabilité sociale politique mais de contrer dans les faits la pauvreté : il doit suivre le PIB et le salaire minimum.
Financer
La question est posée à des gens qui ne sont plus ceux de l'après-guerre. Pourtant elle reste la même et elle est très simple : on décide que le coût de la pauvreté est économique ou qu'il est humain. Tournez la question dans tous les sens, vous en reviendrez toujours à ce point.
Pas de miracle donc, mais des idées pour ceux qui ont du bon sens.
Alors que le coût médian de la redistribution par individu et par mois est actuellement de 800€, il faudrait, pour financer un revenu d'existence tel qu'exposé, un transfert de 1200 à 1500€ par personne et par mois. La population accepterait-elle le coût économique ? Peu de chances. En premier angle, il faudra alors continuer de lui rappeler que son entêtement la conduit à préférer le coût humain, précisément ce dont une partie est victime, et précisément ce dont l'autre a peur.
 En second angle et réduction drastique - voir complète - de ce coût économique, l'idée selon laquelle il ne faut plus seulement taxer l'immobile, comme c'est le cas actuellement. Cette histoire remonte à la révolution française, lorsque la classe bourgeoise soutenait la population, contestant en fait l'ordre de la noblesse et préférant à cela le commerce, le flux, le mobile. Si le capital fluctuant échappe à l'impôt, c'est parce que la bourgeoisie a gagné, du XVIIIème à aujourd'hui. Les classes populaires, elles, sont toujours les perdantes de ce type de révolution.
En second angle et réduction drastique - voir complète - de ce coût économique, l'idée selon laquelle il ne faut plus seulement taxer l'immobile, comme c'est le cas actuellement. Cette histoire remonte à la révolution française, lorsque la classe bourgeoise soutenait la population, contestant en fait l'ordre de la noblesse et préférant à cela le commerce, le flux, le mobile. Si le capital fluctuant échappe à l'impôt, c'est parce que la bourgeoisie a gagné, du XVIIIème à aujourd'hui. Les classes populaires, elles, sont toujours les perdantes de ce type de révolution.
Quiconque vit un peu dans le monde du travail sait que les entreprises les plus riches payent environ 11% d'impôts, quand la loi oblige toute entrepreneur à en payer 33% (ce qui est traditionnellement des PME et TPME – quand elles n'optent pas pour inscrire leur siège sociale à Londres). Pourquoi ? Parce que les gens les plus riches ont compris que la richesse ne devait pas être du stock. La durée de propriété d'un titre financier est en moyenne de 21 jours (22 secondes dans le domaine du trading haute fréquence).
Le PIB mondial représente près de 80 000 milliards de dollars. Le mobile, les transactions financières, les flux représentent 10 fois plus : 700 000 milliards. Il suffirait de taxer entre 3% et 5% les transactions nationales pour que le revenu d'existence soit concret. Au premier janvier 2017, cette taxe était de 0.3%, et elle est appliquée uniquement aux sociétés dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros.
Voilà exposé simplement ce que peut être le coût économique contre le coût humain. D'une manière positive, on peut aussi imaginer la contribution de la BCE pour financer la partie européenne du RE (les inégalités de PIB). Mais les détails sont inutiles. Il faut répéter que la technique économique n'est pas le problème. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de TINA : chacun devrait pouvoir comprendre que la question est celle de l'éveil. Contrairement aux apparences, nous sommes simplement très loin de vivre dans une société du désir.
Le revenu contributif
Quiconque aura fait l'expérience de la précarité et de l'isolement n'oublie pas sa chance quand il va tous les jours au travail. Le travail rapporte un salaire, certes ; mais il est aussi une structuration fondamentale de l'individu. Homo est homo faber, et s'il ne construit pas, c'est lui qu'il détruit.
Stiegler et Boutang sont des gens sérieux. Une société de consommation est simplement stupide. Leurs réflexions sur le revenu contributif portent sur le travail, ses conditions actuelles et les perspectives imaginables. Détaché de l'emploi et de la subordination, le travail est pour eux une activité sociale constructrice. Loin de le dégager, ils veulent au contraire le remettre en perspective, avec la qualification, le savoir, le devenir et le sens de la construction.
Ils s'inspirent pour cela du modèle de l'intermittence. Un artiste est aussi payé lorsqu'il n'est pas employé. Il continue de travailler à quelque chose, il anime et nourrit une pratique et un savoir, avant de les réaliser sous forme contractuelle, rétribuée. Cette remarque est simple mais son impact est pourtant considérable.
 Le revenu d'existence couplé au revenu contributif, c'est la garantie de l'évaporation des contraintes immenses et mortifères qui pèsent dans le jeu social des tensions de marché. Sécurisé par le filet du RE, c'est le temps retrouvé pour soi par le plus grand nombre. C'est une individualisation libérée de la subordination au travail. C'est aussi un savoir de production et un savoir d'achat éminemment nécessaires à notre époque. Une appropriation plus concrète, parce que rendue possible, de la vie culturelle et sociale. Savoir créatif de l'artiste, savoir-faire de l'ouvrier, savoir conceptuel de l'ingénieur, tout cela dans l'énorme potentiel technologique de ce siècle. Voilà le projet. Les conditions de possibilité d'un réel qui permet de redonner place à la valeur.
Le revenu d'existence couplé au revenu contributif, c'est la garantie de l'évaporation des contraintes immenses et mortifères qui pèsent dans le jeu social des tensions de marché. Sécurisé par le filet du RE, c'est le temps retrouvé pour soi par le plus grand nombre. C'est une individualisation libérée de la subordination au travail. C'est aussi un savoir de production et un savoir d'achat éminemment nécessaires à notre époque. Une appropriation plus concrète, parce que rendue possible, de la vie culturelle et sociale. Savoir créatif de l'artiste, savoir-faire de l'ouvrier, savoir conceptuel de l'ingénieur, tout cela dans l'énorme potentiel technologique de ce siècle. Voilà le projet. Les conditions de possibilité d'un réel qui permet de redonner place à la valeur.
"La raison est ce qui invite à une vie meilleure" dit Bernard Stiegler face aux temps de confusion. En proposition, la seconde révolution gagnante après celle du Welfare state. Je passe sur les détails de cette revalorisation économique, sociale et culturelle, car ils sont un peu techniques. On peut simplement en retenir que le fond est aussi de savoir évaluer autrement la valeur. Une quantité de PIB ne révèle que peu de choses, surtout de nos jours. Mais il ne manque pas seulement des lignes au journal comptable. Stiegler développe cette idée - un axe de recherche, d'une économie non essentiellement calculatoire dans le cadre d'un rapport à la production non entropique (non destructrice).
C'est donc bien un changement radical de point de vue et d'objectif.
Pour conclure
Quand on connaît Stiegler, on perçoit parfois un intellectuel un peu hors sol. Je n'ai pas la place de développer, mais même si certains de ses propos s'opposent à quelques-unes de mes convictions les plus chères, il y a toujours quelque chose de profondément neuf chez lui. Quelque chose qui est en avance sur le temps. Un espoir, c'est aussi cela. Avec Boutang à ses côtés, le couple est solide. Le chemin de pensée vaut le détour.
Un peu de lumière dans cette époque. L'idée est presque évidente. Bien sûr, ce sont des gens suivis par les puissants, pour les raisons que je citais ; ils sont contactés par des banques, des multinationales, des institutions de prestige et sont financés pour des projets pilotes (par exemple le projet "Pleine commune" à Seine Saint-Denis qui vise à répondre aux échecs de la société libérale).
On peut se douter que l'intérêt du grand capital est d'absorber le travail de recherche que mène ce petit groupe, et de nous laisser avec un futur vague débat sur un revenu de base RSA, reste d'un modèle social en fin de non recevoir. Un choix de société et des forces contraires puissantes. Voilà pourquoi il me paraissait important d'en dire quelques mots.
Merci pour votre lecture !
___
Cet article est issu de cette présentation.
Pour référence : Ars Industrialis, Multitudes.
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










