Le naufrage des intellectuels conduit-il la société vers sa ruine ?
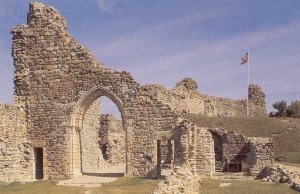
Marcel Gauchet est l’un des rares philosophes conjuguant une notoriété médiatique et le respect de ses pairs qui voient en lui un penseur préoccupé de son siècle. Il vient d’accorder un entretien fort intéressant au quotidien québécois Le devoir, qui célèbre son siècle d’existence. Les thèmes abordées concernent le sort d’un journalisme qui s’est cannibalisé, selon les termes de Gauchet, en se noyant dans l’écume des dépêches et autres brèves, sans prendre le recul nécessaire pour une analyse des faits. Bien évidemment, je ne peux que partager cet avis, notamment après avoir scruté la couverture de la grippe par des médias peu soucieux de livrer les éléments nécessaires pour forger une opinion éclairée. Au détour de l’entretien, Gauchet aborde brièvement la question des savoirs, des intellectuels et de l’université. L’occasion de réagir à ces propos plutôt détonants.
Marcel Gauchet : L’université ne m’apparaît pas en meilleure forme que le système éducatif en général ou que les médias. C’est toute l’évolution de l’université qui est en cause. De quel type de production intellectuelle parle-t-on ? Quatre spécialistes parlent au cinquième. Selon la bonne formule, il s’agit de tout savoir sur presque rien ! À ce compte, qui voulez-vous que ça intéresse ? Chacun a deux lecteurs, et encore, à 10 000 kilomètres l’un de l’autre.
Quatre spécialistes parlent à un cinquième. J’aime bien cette idée renvoyant à cette célèbre formule selon laquelle le spécialiste sait tout sur rien et le généraliste sait rien sur tout. N’étant ni l’un ni l’autre, je ne me sens pas concerné, sauf en évoquant une autre formule de mon cru. Spécialiste, bon à rien qui réussit tout. Généraliste, bon sur tout qui réussit rien. Tout ça pour dire que le spécialiste sait jouer de l’entregent et des réseaux spéciaux pour se faufiler vers un parcours promotionnel aussi sûr qu’une route nationale. C’est en quelque sorte le prix à payer qu’un spécialiste exige pour passer à côté des frissons de la connaissance et s’emmerder dans son métier de professionnel des savoirs spécialisés. Le système est d’ailleurs adapté à ces pratiques, avec des revues spécialisées et des colloques tenus tel des conclaves où seuls les spécialistes peuvent entrer et se prêter à ces joutes intellectuelles où la coquetterie exige qu’on examine les moindres détails d’une interprétation afin de marquer son appartenance au cénacle.
Le temps des honnêtes hommes cultivés, ouverts sur leur époque, semble révolu. Il y a trente ans, la systémique était prisée des intellectuels. On louait la transversalité, l’interdisciplinarité. Dans les programmes présidentiels de 1995, les trois principaux candidats avaient mis la priorité sur la connaissance de la complexité. Edgar Morin était un pape. Il existait même une revue internationale de systémique. Puis, toute cette effervescence intellectuelle née des années 1970 a fait pschitt. Le généraliste est une espèce presque disparue, car non adaptée au milieu universitaire. Les livres de vulgarisation sont devenus vulgaires et ennuyeux, écrits comme une suite de lieux communs servis pour un public peu exigeant.
M.G. Il y a un phénomène d’ésotérisation et de spécialisation qui marginalise la production intellectuelle et universitaire par rapport à la vie sociale. C’est d’ailleurs un mouvement très encouragé par les autorités qui nous gouvernent. Elles trouvent ça très bien. C’est moins d’emmerdeurs pour eux…
Là, je dis, bien vu Marcel ! L’ésotérisation des spécialités finit en effet par couper les producteurs de savoir de la société civile. J’ai le vague souvenir d’une émission, animée par Alain Finkielkraut, consacrée à la place de la sociologie, en présence de l’éminent Luc Boltanski. Le débat a porté sur l’engagement, ou à défaut, l’investissement du sociologue dans la société, un peu comme éclaireur du peuple, avec comme figure emblématique récente Bourdieu. Là aussi, on a pu sentir qu’une époque était révolue alors qu’une universitaire présente défendit la place du sociologue comme serviteur de l’Etat et producteur de rapports et autres expertises pour solutionner des problèmes bien diversifiés et donc, la compétence requise du spécialiste. Quoi de scandaleux ? Il n’y a pas de mal à servir votre employeur.
Futé, Marcel Gauchet, soupçonnant les autorités de trouver très bien cet éloignement entre les intellectuels et la société civile. Moins d’emmerdement penseraient-ils, encourageant cette tendance. Une mise en miroir historique s’impose. J’ai un souvenir assez précis d’un texte situant le contexte dans lequel évoluaient les grands professeurs allemands du néo-kantisme ou de la phénoménologie, pendant la belle époque, sous le second Reich et même plus tardivement. L’Etat allemand de l’époque avait signé un pacte non écrit avec les universitaires à qui les autorités accordaient d’énormes crédits pour cogiter en cercle fermé sur des questions métaphysique, à condition que ces intellectuels n’interviennent pas dans les problèmes de société, domaine réservé de l’Etat. Les historiens pensent que cette coupure entre les penseurs et la société n’est pas étrangère aux événements convulsifs que connut l’Allemagne entre 1914 et 1945.
Qu’en est-il de la France de 2010. On ne peut pas dire qu’une coupure existe entre les intellectuels et les Français, ne serait-ce qu’en écoutant les médias qui face à cette tâche de pénétration des idées, assurent un service minimum. Mais ce n’est pas comme au temps d’Aragon, Gide, Sartre, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard et cette cohorte de penseurs qui s’exprimaient avec d’autant plus de verbe qu’on ne leur demandait rien. Un joyeux spontanéisme d’idées agitait la vie intellectuelle sociale. En 2010, que tout paraît terne. On semble face un consensus mou. Les intellectuels de gauche n’ont plus rien de corrosif. Cynthia Fleury ? Ennuyeuse et conventionnellement bcbg dans son expression strictement encadrée, Vincent Cespedes ? Drôle, épigone d’Onfray et poil à gratter gauchiste mais Christophe Alevêque ou Didier Porte font tout aussi bien l’affaire. Mais pourquoi alors cette défaite de la pensée ? Ecoutons Marcel, il a encore un constat pertinent à faire valoir !
M.G. Par ailleurs, les intellectuels ne sont pas moins déboussolés que les citoyens par rapport à l’évolution du monde, qui leur échappe comme au reste. Malheureusement, le nombre de réflexions pertinentes et efficaces par rapport à la marche du monde tel qu’il va n’est pas très grand. Nous sommes dans un changement tellement brutal que personne n’en a la mesure. Je m’acharne d’ailleurs à faire cette revue, à diffusion modeste, pour tenter d’entretenir une petite flamme vivante autour de cette exigence de comprendre le monde. Je ne suis d’ailleurs pas pessimiste parce qu’il existe maintenant des moyens très grands de diffusion des idées. Nous sommes à la croisée des chemins. Le règne de la bêtise et de la confusion universelle n’est pas une fatalité.
Les intellectuels n’auraient plus de prise sur les évolutions de la société selon Gauchet. C’est bien possible et si c’est avéré, l’explication vient d’être donnée pour une bonne part. A force d’être spécialiste, on cale son intellect vers un réglage particulier où la rationalité n’est efficace que dans un secteur limité. Du coup, le spécialiste n’a pas les bons réglages pour « voir » les phénomènes de société qui se présentent et qui demandent à être analysés. On peut carrément parler de myopie sociale. Le monde est flou pour le spécialiste. Et nos intellectuels médiatiques, qu’ont-ils à dire ? Eux nous ont habitué à entendre des avis plus ou moins éclairés sur ce qui se passe dans le monde. Les BHL, les Attali, avaient des choses à dire mais eux aussi sont devenus myopes à force de fréquenter leurs cercles, leurs éditeurs, leurs interlocuteurs et surtout leur intérêt propre, si bien que leur vision est globale certes mais quelque peu tronquée et souvent déconnectée de la société civile.
Deux problèmes s’entrelacent, celui des médias de masse qui ne transmettent plus les innovations intellectuelles et les rapports éclairés sur le monde, et celui des intellectuels qui ne savent plus établir ces rapports éclairés et qui du reste n’ont aucune inclinaison à le faire parce que les médias leur fermeraient les colonnes. C’est bien là le signe d’une société qui risque de partir en ruine spirituelle. Et quand l’esprit s’effondre, la machine sociétale n’a plus de pilote et se laisse mener par le vent des caprices et des émotions. Peut-être qu’une nouvelle société s’invente mais si tel est le cas, une chose est sûre, cette société ne pourra venir des élites qui pourtant, tentent de créer un monde ajusté à leurs desseins. Si la partie n’est pas achevée, elle risque d’être passionnante. Nous verrons bien si une reconstruction est possible à partir des ruines.
24 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON












