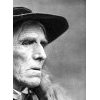Le travail à l’ordre du jour dans les têtes
Au moment où chacun va extrapoler sur le slogan frauduleux « travailler plus pour gagner plus » ; il faudrait peut-être faire un tour d’horizon « du travail ».
Au XVIIIe siècle il se travaillait jusqu’à 18 heures journalières. A ce régime certains vont être milliardaires. Sauf qu’un employeur anglais de l’époque dont j’ai oublié le nom s’est rendu compte qu’en faisant reposer ses ouvriers ceux-ci étaient plus productifs. Il a proposé 8 heures de repos et a failli se faire lyncher par ses pairs de l’époque.
Les pendus de Chicago l’ont été parce qu’ils réclamaient les trois huit, pendus le premier mai 1882 en reprenant la revendication de la « National Labor Union » qui réclamait les trois huit. Donc être libéral serait revenir au XVIIIe siècle ? Avant que des hommes meurent pour ne plus mourir au travail.
Nous pouvons donc dire que la relation affective des individus a contribué à créer des « filiations variables » dans une organisation domestico-économique sédentaire qui accommode la sociabilité des individus au travers d’un lien de dépendance à la réciprocité inégale. Le développement de la pensée humaine, favorisé par l’éducation, a conceptualisé les notions égalitaires et antinomiques de liberté individuelle et de droit de propriété. Le tout dans le cadre d’une prégnance historique de méritocratie, fondée sur l’exercice d’une discipline guidée par des échelles de valeurs subjectives établies par le fait majoritaire qui se reconnaît dans une culture judéo-helléno-chrétienne.
Les progrès de la pensée libérale n’en restent pas moins limités par la condition humaine qui peut conduire tout individu (suivant l’observation que nous avons pu en faire depuis plus de quatre mille ans) à la tyrannie s’il n’est pas borné par la pensée des autres. Ignorant de la « réalité » des raisons de leur condition, les hommes ont développé la socialisation qui organise l’intrication de leur existence dans celle des autres.
Notre aptitude à la créativité a produit une multitude de biens et de services dont l’accès n’est rendu possible que par une activité participative régulée par une appréciation subjective de nos relations. Ces dernières fixent à leur tour la valeur d’échange de ces biens et de ces services, avec pour objectif la recherche permanente d’un hédonisme à géométrie variable qui est fonction d’une désidérabilité sans limite.
Cette désidérabilité ne prend corps que grâce à l’usage de la raison qui en délimite les contours et concourt de ce fait à son accessibilité réelle ou imaginaire. Cette aptitude à la créativité, qu’elle soit intellectuelle ou physique, ou les deux à la fois, le plus souvent en la qualifiant et la quantifiant, nous l’appelons le travail.
L’histoire du travail apparaît à la suite des besoins biologiques nutritionnels de l’homme, mais sa définition sous notre regard hiérarchisant ou « méritocratique » commence à prendre forme lorsque, d’une appréciation qualitative de l’observation de l’exercice d’une activité économique humaine diversement organisée et désignée, s’élabore la quantification d’une valeur d’échange commune, après n’avoir été qu’une valeur d’usage liée à la fonctionnalité des productions. C’est avec l’œuvre de Petty William (1623-1687) que se situe la transition avec les mercantilistes et les libéraux. Sa théorie de la valeur corrèle une unité de monnaie avec une journée de travail et une acre de terre (elle valait en France 52 ares environ). Elle est à l’origine de la théorie de la « valeur/travail » qui ancrera définitivement ce mot comme la clé objectivée d’une mesure de référence universelle de l’activité productive de la civilisation industrielle permettant l’intégration d’un individu dans une société dite de « libre-échange ». Sa consécration se caractérise par le nombre de sciences particulières qui lui ont été consacrées, et desquelles sortent des modèles, comme les techniques de rationalisation qui sont appliquées dans d’autres domaines que ceux du travail, et notamment de nombreux secteurs de la vie sociale, certains services de l’État, le sport, et pour une bonne part la gestion du temps de notre existence. Ceci n’a été rendu possible que par une praxéologie mathématique au travers d’un raisonnement « logicomathématique » nécessitant une tactique et une stratégie d’acteur devant la nature de l’action industrielle qui appelle le calcul de procédures et la quantification des données.
Ainsi s’affine et s’affirme une virtuosité tactique dans une pensée stratégique d’anticipation qui vise à l’optimisation du choix des moyens qui sont devenus saisissables. Nous avons donc fini par parler de « sciences économiques » qui regroupent certes les progrès de la théorie économique, mais qui sont source d’une certaine illusion des vertus de la rationalité de l’action économique. Le travail, soumis à cette rationalisation, entraîne de fait la rationalisation de ses exécutants qui se la transmettent dans tous les lieux où ils agissent.
Ils ne se comptent plus que comme unité quantitative au service de laquelle ils mettent leurs qualités, et les individus s’étonnent d’avoir des exigences biologiques humaines coûteuses.
Ainsi le travail rationalisé oriente aujourd’hui notre société, la rend intelligible pour fixer une stratégie d’existence qui nous laisse imaginer que nous pouvons maîtriser toute notre histoire.
Pour ne pas être victime de cette illusion il faut prendre conscience, comme le note Dominique Méda, que le travail n’est pas une donnée anthropologique, il est devenu une valeur de référence. (Référence à Méda).
4 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON