Masculin/Féminin : la loi du genre partie IV
Séminaire placé sous la direction de Françoise Héritier, anthropologue, Collège de France.
XX, XY, comment devient-on un homme ou une femme ? Qui gouverne la construction de notre identité sexuelle : nos gènes ? Nos hormones ? La société ? La famille ? ... Simone de Beauvoir avait-elle raison lorsqu’elle écrivait : « on ne naît pas femme, on le devient » ? Les hommes d’aujourd’hui ne s’interrogent-ils pas sur leur identité profonde ? Sauf accident, tout individu obéit aux lois de la génétique et de la physiologie qui créent, dans notre espèce, des mâles et des femelles. Mais au-delà, le regard de nos parents, de la société tout entière, nous façonne dans notre intimité. Et si la différence des sexes structure la pensée humaine, peut-on changer les rapports du masculin et du féminin ? Que disent désormais les sciences sociales, humaines et les sciences du vivant de cette construction ?
Ce séminaire tentera de démêler les fils de notre masculinité et de notre féminité.
Partie IV : "D’un sexe à l’autre"
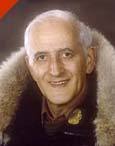
Séminaire, mercredi 2 juin 2004, 18 h 30
Bernard Saladin d’Anglure, anthropologue, université Laval, Canada.
Cette séance ayant été interrompue après l’intervention de M. Saladin d’Anglure, la discussion s’est poursuivie à travers un forum en ligne durant l’été 2004 Forum Texte.
Le troisième sexe chez les Inuits
« À l’heure où l’Occident est confronté aux revendications des homosexuels pour le droit au mariage et à l’adoption, et aux demandes d’intervention chirurgicale et de modification d’état civil, par les individus désirant changer de sexe, il paraît opportun de jeter un regard sur les pratiques sociales et les représentations symboliques d’une petite société de chasseurs-cueilleurs de l’Arctique canadien, les Inuits que j’ai pu étudier depuis le milieu des années 1950. L’équilibre démographique de ce peuple était alors très précaire ; un enfant sur deux mourait avant un an. Mais la reproduction simple des générations, des familles domestiques et du sex-ratio s’opérait néanmoins, grâce à une conception subtile de l’identité de genre, de la division sexuelle des tâches, de la filiation parentale et de l’alliance matrimoniale. C’est sur un fond de dualisme cosmologique sexualisé, à la frontière bien déterminée, qu’ont été pensés les mythes d’origine, le cycle de la reproduction humaine et celui des saisons. Le chevauchement de la frontière des sexes était cependant possible avec la croyance en une transsexualité néo-natale, la pratique du travestissement infantile et la médiation tierce des chamanes.
Pour comprendre ce système complexe et flexible, il faut se départir du point de vue de l’adulte ordinaire et adopter celui du chamane, capable d’évoluer entre l’échelle infra-humaine (celle du fœtus et de l’enfant) et l’échelle supra-humaine (celle des esprits). »
Patricia Mercader, maître de conférences en psychologie sociale, membre du Groupe d’études des relations asymétriques et responsable pédagogique pour le Centre Louise Labé (mission pour l’égalité entre hommes et femmes, université Lumière-Lyon 2).
Téléchargez le texte de la conférence. Document PDF (370 Ko).
Texte Diapositives : cliquer ici
L’illusion transsexuelle
« Depuis Margaret Mead, nous admettons que les comportements de genre ne sont pas biologiquement déterminés. Depuis les années 50 et les études de John Money sur les effets psychiques des ambiguïtés génitales, nous admettons que l’identité de genre ne l’est pas non plus, mais dépend du sexe assigné au sujet par son environnement. Depuis les années 60 et les travaux de Robert Stoller sur le transsexualisme, nous admettons que l’identité de genre peut se développer à l’inverse du sexe d’assignation, en fonction d’éléments discrets, de « bruits » qui infiltrent le processus d’assignation de genre et qui témoignent de la problématique inconsciente des parents. Et dès lors, se produit un vacillement : pour les ethnométhodologues, être homme ou femme est essentiellement équivalent à se faire admettre comme (passer pour) homme ou femme : depuis 1992, pour la Cour de cassation française, à la suite de la Cour européenne des droits de l’homme, le genre de l’état civil doit refléter l’apparence de la personne ; dans la mouvance « queer », le genre est essentiellement autodéterminé... Nous tenterons d’éclairer, avec le double regard de la psychologie et de la sociologie, les enjeux complexes de ces glissements dans la façon dont notre société pense la différence des sexes. »
Auditorium
Ressources
P.-S.
Source : Cité des sciences.fr
Autres journées du séminaire :
 Partie I "Mâle/femelle : pourquoi deux sexes ?"
Partie I "Mâle/femelle : pourquoi deux sexes ?"
 Partie II "Garçons/filles : quelles différences ?
Partie II "Garçons/filles : quelles différences ?
 Partie III "Construction de la sexualité"
Partie III "Construction de la sexualité"
Documents joints à cet article


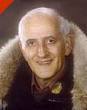


2 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









