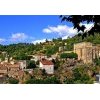Tyrannie victimophile et terreur judiciaire
Un texte de jeunesse écrit, dans un style un peu ronflant et abstrait, à la fin des années 90, à la suite d’une épidémie de procès faits à des gens irréprochables, accusés de ne pas avoir été capable de prévoir... l’imprévisible dans des accidents corporels.
Ce texte est aussi une réflexion sur trois types de crimes, le crime ordinaire, le crime judiciaire (sacrilège) et le crime victimaire (abomination). Il dénonce une inversion des rôles où la « victime » autoproclamée exerce son terrorisme contre un coupable désigné d’office.
On peut lire cet article comme un aperçu de philosophie du droit.
Un retraité, un professeur, un jardinier, un simple particulier peuvent bien commettre des violences lourdes indépendamment de leur fonction, ou même à l’occasion de leur fonction. Mais quelles professions autres que les professions répressives peuvent commettre de lourdes violences qui définissent la fonction elle-même ? Qui d’autre que les magistrats et leur subordonnés peuvent séquestrer, tuer ou tourmenter en tant que ces actes sont la définition même de leur travail ? Car enfin toute arrestation, tout interrogatoire, toute incarcération, toute exécution même (là où la peine de mort existe) s’apparentent bien à de lourdes violences infligées à des gens qui, de toute évidence, ne sont pas consentants, - et même si cela peut se justifier, - et même si l’on en reste à la répression la plus épurée et la plus humaine, abstraction faite, donc, des abus et des débordements liés à la cruauté éventuelle du droit ou des hommes.
Tout cela mène à dire que la pire menace pour un peuple, même dans la démocratie la mieux réglée, c’est en définitive, plus encore que son gouvernement, sa magistrature, et aucune philosophie du droit ne peut s’élaborer sans la claire conscience de ce mal récidivant. Mais, sans doute, plus encore que sa magistrature, le pire ennemi d’un peuple c’est, au bout du compte, lui-même. Les magistrats sont loin d’être les seuls responsables de la cruauté officielle ; comme toujours, il faut se demander si la racine de la servitude ne serait pas volontaire, si, en d’autres termes, lorsqu’un peuple est opprimé, il ne l’aurait pas fortement cherché par sa complaisance et son aveuglement. La cruauté des magistrats suit celle du peuple plus qu’elle ne la précède. Du reste, qui chérissait autrefois les supplices publics, si ce n’est la populace, y compris la canaille directement menacée par ces supplices ? Il n’y a pas si longtemps, Robert Badinter faisait remarquer, au cours d’un débat houleux, qu’un certain particulier - qui deviendrait plus tard un criminel notoire - participait à une manifestation saluant l’exécution de deux meurtriers, et que ce quidam ne comptait pas parmi ceux qui criaient le moins fort : à mort ! à mort les assassins ! Actuellement, de simples particuliers se pressent à la porte des prisons américaines pour fêter l’exécution des condamnés (innocents ou coupables, peu importe). Gluante obscénité de ces souriants enthousiasmes ! Demain, ce sera peut-être l’un d’eux qui, accusé sans aucune preuve sérieuse, se retrouvera incarcéré, puis exécuté au terme de longues années de torture, le tout au nom d’une politique sociale inefficace et terrible qui favorise la guerre de tous contre tous au lieu de l’éradiquer. Mais qu’importe ! la populace se réjouit... Curieux lien social, du reste, que ces manifestations fusionnelles exaltant un système judiciaire fondé sur la haine et la suspicion généralisées.
Crime, sacrilège et abomination : les trois figures du mal
La criminalité liée aux institutions s’en trouve donc dédoublée : outre la criminalité judiciaire existe aussi la criminalité victimaire, et les deux travaillent de concert pour bafouer l’innocence et la vertu. On écrit bien criminalité judiciaire et non pas seulement policière ou carcérale, parce que les crimes commis par les forces de l’ordre ou dans les prisons n’existeraient pas s’ils n’étaient pas largement couverts par les autorités judiciaires, sur lesquelles reposent, en définitive, toute la criminalité et tout le sacrilège institutionnels. Mais on écrit aussi criminalité victimaire, puisque, outre les criminels ordinaires, et outre les criminels-sacrilèges qui représentent la loi, existe une race encore plus terrible de scélérats : ceux qui se font passer pour des victimes et utilisent les institutions répressives pour harceler les malheureux qu’ils ont décidé d’abattre. Pourquoi s’agit-il alors de la plus terrible famille de scélérat ? Parce que, même si le crime ordinaire régnait assez peu, même si les institutions étaient régies par de sages magistrats et par de consciencieux fonctionnaires, même si, donc, on avait réussi à comprimer le plus possible le crime proprement dit (crime ordinaire) et le sacrilège (crime judiciaire), il resterait encore l’abomination (crime victimaire) de ce que font subir les pseudo-victimes à de pseudo-coupables. Or, même avec la plus grande sagesse institutionnelle possible, il se trouvera toujours des scélérats pour inventer le mal là où il n’existe pas, et pour tromper les magistrats eux-mêmes, fussent-ils des plus scrupuleux. La criminalité victimaire ne peut ainsi se combattre véritablement qu’avec le concours de toutes les ressources de la sociabilité et de la convivialité générales. Combattre le crime est un problème juridique, combattre le sacrilège est un problème politique, mais combattre l’abomination est un problème éthique. Précisément, dans un véritable État de droit, ce sont les magistrats (et leurs subordonnés) qui luttent contre le crime, mais ce sont les gouvernants qui luttent contre le sacrilège, et, pour finir, ce sont les gens de culture, intellectuels, lettrés, ou même simples particuliers éclairés, qui luttent contre l’abomination, soit publiquement par des livres, ou des écrits, soit en privé en éduquant leurs enfants ou leur entourage par une attitude dignement appropriée face aux malheurs humains qui ne sauraient trouver réparation. Malheureusement, il se produit bien souvent dans les populations une atrophie générale de l’esprit qui donne à tout un chacun la tournure intellectuelle d’un magistrat, à savoir la préoccupation unique de la répression du crime. Tout un chacun a son mot à dire sur le crime, magistrats (cela se comprend), gouvernants (cela devient démagogique) et particuliers (cela tourne à l’obsession victimophile). Le crime ordinaire attire et repousse, fascine les peuples de la base aux élites, et personne ne se préoccupe plus des deux autres problèmes, à de rares exceptions près. Ces exceptions en deviennent d’ailleurs suspectes, et pourtant il faut qu’elles trouvent le courage d’affirmer, encore et toujours, le plus sain des principes du droit : chercher la réparation du crime à tout prix est le pire des crimes - et c’est même un crime contre soi-même.
Il n’est pas un crime qui n’ait été un jour commis par les représentants de la loi ; il n’est pas un forfait qui n’ait été un jour couvert par les institutions répressives. Outre les terribles "erreurs" judiciaires qui jettent chaque année l’opprobre sur d’honnêtes familles, des abus juridictionnels multiples immolent de prétendus responsables d’accidents fortuits sur l’autel des victimes, sans compter l’éventuelle scélératesse de bon nombre de lois, ou encore le contraste hideux, parfois chez le même magistrat, de la démence laxiste et de la démence terroriste, en fonction de la sympathie ou de l’antipathie que lui inspire le coupable ou la situation. On ne le répète jamais assez : des gens qui n’ont pas commis une seule faute, ni du point de vue de la moralité, ni du point de vue de la loi positive, peuvent subir toutes les foudres d’une justice qui fabrique des responsables, alors que des criminels notoire et reconnus, prévaricateurs, violeurs, meurtriers et sadiques de tout poil, s’en sortent parfois pratiquement indemnes (quand il ne reçoivent pas les félicitations de l’institution). On ne le dit jamais assez : certains délinquants ou criminels, qui agissent au grand jour, et contre lesquels on possède toutes sortes de preuves, continuent de vivre sans se voir opposer un seul reproche de la part des institutions répressives, alors que des personnes radicalement impeccables se trouvent inquiétées, parfois incarcérés, parfois condamnées, sans aucun élément pouvant justifier ni le début ni le dénouement de telles procédures.
La chose médiatique, immense instrument de propagande, présente chaque jour au téléspectateur aveugle des séries démagogiques, remplies de policiers lucides et de magistrats consciencieux, lesquels "recherchent des preuves", manifestent une grande ouverture d’esprit, voire beaucoup d’humanité, et ne prennent pas leurs décisions à la légère... La réalité va à l’inverse de la fiction. On pourrait presque affirmer que - dans la réalité - plus on accumule, contre quelqu’un, preuves et reproches, moins il risque d’être inquiété ; du reste, les pessimistes caricaturent à peine (et parfois pas du tout) lorsqu’ils disent que la police et la justice n’ont pas d’autre mission que d’arrêter les innocents pour protéger les coupables... "J’ai confiance en la justice de mon pays... " : on n’imagine pas l’obscénité de ce genre de poncif. Mais cette obscénité, plus encore que celle de l’institution, est celle de la complaisance des populations à leur propre déchéance.
La confusion du dommage et de la lésion
Cela posé, ces impasses ont un principe, dont on peut les déduire intégralement, à savoir : la confusion du dommage et de la lésion. La notion de dommage englobe et dépasse en réalité le simple concept de la lésion. Il peut très bien exister des dommages sans lésion, lorsque le hasard est le seul responsable du préjudice, ou encore lorsque la victime ne peut s’en prendre qu’à elle-même, bref : lorsqu’aucun tiers ne peut-être décemment tenu pour coupable de quelque faute. Le simple bon sens aperçoit cette vérité peu difficile à trouver : hélas ! les idéologies ambiantes pivotent souvent sur la négation du simple bon sens.
Notamment, il existe bon nombre de dommages qui sont imprévisibles, c’est-à-dire, pour être précis, prévisibles à titre d’éventualité abstraite, mais impossible à prévenir en particulier. On peut bien prévoir, dans l’absolu, que, s’il pleut, des gens pourront glisser sur la pavé mouillé de la rue, et se tuer ou s’invalider gravement. Mais nul ne peut prédire ce qu’il adviendra vraiment : il existe des jours de pluie où personne ne glisse, et l’on peut même glisser alors qu’il ne pleut pas. Cette imprévisibilité de fait suffit, dans une justice raisonnable, à innocenter le maire de la commune de toute imputation de coups et blessures ou d’homicide involontaires. Malheureusement, une justice délirante excitée par d’odieuses victimes cherchera toujours des prétextes pour condamner : on dira, par exemple, au maire qu’il n’avait qu’à faire poser des écriteaux signalant le caractère glissant de la chaussée en temps de pluie, comme s’il s’agissait là d’un mystère. Et même s’il a fait poser des écriteaux, on inventera bien autre chose, l’imagination des magistrats n’ayant pas de frein. A la limite, un simple gravillon isolé déposé par la semelle d’un passant anonyme, entraînant quelques temps après la glissage mortelle d’un autre piéton, et notre bon maire sera incarcéré pour homicide involontaire par négligence et défaut de balayage sur la voie publique ! La justice contemporaine en est là... Bien évidemment, la situation n ’aurait rien d’alarmant s’il s’agissait de simples procès civils. Civilement parlant, le principe d’une responsabilité sans faute est admissible ; il n’est que la traduction d’un autre principe du droit démocratique, selon lequel toute victime d’un préjudice doit être indemnisée. Les compagnies d’assurances sont là pour couvrir l’indemnisation, et le responsable civil, en ces matière, n’est qu’une sorte de prête-nom, ne déboursant aucune somme de sa poche. Les ennuis commencent lorsqu’une assurance refuse de payer, lorsqu’il y a conflit entre deux assurances, ou lorsqu’il n’y a pas d’assurance du tout ; mais, là encore, le conflit peut se régler au civil. Tout au plus, l’un sera obligé de payer des dédommagements de sa poche - ce qui est déjà une sanction énorme, mais qui reste dans la limite du droit civil. Par contre, que le conflit se règle au pénal - et, qui plus est, devant une juridiction pénale cumulant des fonctions civiles et répressives - c’est là ce qu’on ne peut admettre. Que le "responsable sans faute" devienne en plus un "coupable sans faute", qu’il soit contraint, outre l’indemnisation civile, de purger une peine financière ou carcérale, il y a là un véritable scandale judiciaire. La responsabilité (civile) sans faute reste un principe raisonnable ; la culpabilité sans faute est un monstre conceptuel qu’il faut bannir à jamais de toute législation.
Voilà en tout cas où mène la confusion du dommage et de la lésion, voilà vers quoi dérive une société où tout le monde se sent lésé tout le temps, à commencer par les plus perverses et les plus odieuses des pseudo-victimes. C’est dans un tel contexte que le proverbe "les vrais malheureux ne se plaignent jamais" prend un sens caricatural, mais tout à fait juste.
Le terrorisme judiciaire
Le terrorisme judiciaire pénal tient tout entier en quelques "principes" qu’on a déjà suggérés dans les développements antérieurs.
Tout d’abord, il comporte deux degrés. 1) Le terrorisme de l’instruction peut se formuler de la manière suivante : moins il y a de preuves contre un suspect, plus il court le risque d’être mis en examen, et moins il y a de preuves contre un prévenu, plus il court le risque d’être placé en détention provisoire (au moins proportionnellement). On n’imagine pas le nombre de criminels notoires qui agissent au grand jour, et le nombre d’innocents incarcérés sur simple accusation ou sur simple soupçon, sans le moindre indice déterminant. 2) Le terrorisme de la condamnation est du même ordre : plus la faute est grave, plus la peine est légère (au moins proportionnellement). On a vu des abusifs et des dangereux avérés sortir au bout de dix-huit mois ; on a vu des femmes, battues et torturées, condamnées à de très longues peines pour avoir tué leur bourreau un jour que la douleur de vivre était trop forte. En matière de criminalité financière, la disproportion est énorme ; très souvent l’amende à laquelle est condamné celui qui détourne des fonds immenses lui laisse, de toute manière, un bénéfice colossal, pendant que, dans le même temps, des voleurs de poules croupissent en prison des mois ou des années.
Des exemples de ce type, il en existe des milliers, et dans à peu près tous les domaines du droit pénal. Ce serait une tâche immense que de les recenser, tâche qu’on ne peut réaliser ici. Mais ils se ramènent tous à cette même logique hallucinante de la disproportion ou même de "l’antiproportion", si l’on peut se tolérer le néologisme, qui semble gouverner les décisions des magistrats. Les deux principes fallacieux quoiqu’implicites qui guident l’acte judiciaire peuvent d’ailleurs s’unir en une seule et même maxime de la terreur : moins tu as à te reprocher, plus on te reprochera. La rationalité judiciaire, on le voit, fonctionne au rebours du simple bon sens comme de l’entendement scientifique : il ne faut pas (pas toujours ) s’attendre à trouver chez nos dignes et lettrés magistrats la logique élémentaire qu’on exige pourtant des moins cultivés parmi les hommes. De toute manière, l’honnêteté, l’innocence, la vertu leur apparaissent, dans un contexte de victimisation généralisée, comme les attitudes les plus suspectes qui soient. Si tout le monde est victime, alors celui qui se fait un principe de ne causer de tort à personne ne peut être qu’un menteur ou un fou. Dans un monde où il n’y a plus que des salauds anomiques ou des salauds puritains - ce qui, au bout du compte, revient au même - l’innocent, l’honnête et le juste apparaissent comme les derniers grands déviants. Cela explique aussi qu’à côté de l’impunité grandissante dont jouit la grande et la petite racaille, il y ait autant d’âmes irréprochables qui pourrissent au fond des cachots.
Du chef totalitaire aux sous-hommes démocratiques
Il serait fascinant pour un sociologue d’étudier quelle est la part de la criminalité directement induite par les institutions chargées de réprimer le crime, un peu comme on étudie parfois quelle est la proportion d’électricité nucléaire dilapidée pour le fonctionnement global (risques compris)... des centrales nucléaires ! On parle d’auto-consommation nucléaire ; ne peut-on parler d’auto-consommation juridique ? Car enfin, on gaspille une phénoménale quantité d’énergie et de frais juridiques à gérer le fonctionnement (aberrations comprises) de la chose juridique. Certes, rétorquera l’économiste amusé, mais cela crée des emplois répressifs et cela fait la fortune des avocats ; alors de quoi se plaint-on ? On se plaindra pourtant d’une chose. C’est que le crime, la méchanceté, l’abjection sont également des choix de société, des priorités politiques, si l’on peut dire. Le déluge de violence implicite et explicite que la chose médiatique déverse chaque jour devant les yeux fasciné du téléspectateur moyen le prouve assez. La mise à mort ou le détournement des institutions (notamment l’École) chargées de transmettre des valeurs d’intelligence, de convivialité, de citoyenneté et de solidarité le prouve également. Bref : la violence est voulue et désirée, orchestrée et organisée par les élites, bien qu’elle semble se propager à partir des bas-fonds. Elle est, comme le chômage de masse, un système de gestion politique. Elle est, comme le chômage de masse, l’instrument de la Terreur. Quel différence peut bien alors séparer les totalitarismes anciens de ces nouvelles terreurs démocratiques ? Matériellement assez peu de choses, car, si cette logique est poussée à son terme, elle fera sans doute aussi mal que la logique totalitaire, quoique d’une autre façon. Idéologiquement, par contre, il existe un fossé. Les totalitarismes anciens pivotaient sur une idéologie salvatrice, messianique, conquérante, optimiste au bout du compte ; on massacrait les vies et les corps pour sauver le monde, pour promouvoir une utopie, pour installer l’Idéal. Les terreurs démocratiques fonctionnent au contraire selon une idéologie victimaire. Comme les totalitarismes anciens, cette idéologie repère, fabrique et réprime des "méchants", des "indésirables", des "déviants". Mais l’attention a été déplacé du chef capable de sauver le monde à la masse croulant sous le poids des préjudices qu’on lui ferait subir. Il s’agit d’une idéologie frileuse, défensive, d’un pessimisme vicieux et mesquin. De la terreur appliquée par le sur-homme, le chef totalitaire, on est venu à la terreur des sous-hommes, à l’hystérie de la réparation, à la tyrannie massive des victimes.
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON