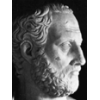Ça plane pour Volaticotherium, mammifère « volant » du Jurassique nouvellement exhumé
Hou-OÛ-ou-ouh ! eût dit Plastic Bertrand en se trémoussant, mais pas seulement lui : on peut imaginer que la réaction des paléontologistes chinois découvrant cet extraordinaire petit contemporain des dinosaures géants du Jurassique dut être sensiblement aussi euphorique. Cette trouvaille excitante eut même les honneurs du prestigieux mensuel Nature de décembre 2006.

Il faut dire que Volaticotherium antiquus, comme le baptisèrent Jin Meng et ses collègues, vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue de mammifères du Mésozoïque, ou Ere secondaire, battant en brèche l’idée selon laquelle nos ancêtres mammaliens survivaient difficilement dans l’ombre des dinosaures géants, qui prospérèrent durant le Jurassique et le Crétacé, à tel point que le Secondaire est souvent nommé "ère des dinosaures".
Ere des dinosaures, le Mésozoïque le fut sans aucun doute, mais il fut aussi celle des mammifères. Comme je l’exposais dans un précédent article, non seulement les mammifères existaient bel et bien du temps des dinosaures, mais leur lignée (ou plutôt, leur plan d’organisation générale) leur est même antérieure. Leur relative rareté dans les archives fossiles est essentiellement liée à la rareté des conditions nécessaires à la fossilisation d’animaux de petite taille, tout comme pour d’autres groupes, tels que reptiles volants ou oiseaux. Le matériau se fossilisant le plus facilement chez les mammifères, la dent, ne permet pas toujours de se rendre compte des adaptations morphologiques de l’individu qui la possédait, en dépit du fait que cet organe soit d’une complexité pratiquement inégalée dans le règne animal (à l’exception sans doute de quelques dinosaures herbivores ornithischiens).
En l’occurrence, c’est un squelette complet, assorti d’une empreinte de patagium, qui mit en évidence le fait que Volaticotherium occupait une niche écologique comparable à celle des écureuils volants, ou plutôt des phalangers volants actuels. Le patagium est la membrane de peau qui relie les quatre membres, parfois les doigts, et bien souvent la queue, chez les mammifères planeurs ou volants. Et Volaticotherium en était indubitablement pourvu, son fossile très fin ayant conservé jusqu’aux traces des poils que portait cette membrane.
L’apparition du vol plané chez les mammifères dès le Secondaire n’est pas si étonnante en soi, si l’on songe que chez les mammifères actuels, il a été développé indépendamment par plusieurs lignées : d’abord les écureuils volants, bien sûr, pétauristes ou polatouches , proches parents des écureuils vrais ; ensuite, les phalangers volants, petits marsupiaux arboricoles cousins des kangourous et des koalas ; enfin, moins connus mais sans doute meilleurs planeurs : les colugos, encore appelés galéopithèques ou lémurs volants, apparentés aux chauves-souris mais aussi aux primates, et qui transmettent jusqu’à nous le plan d’organisation qu’avaient probablement les premiers organismes évoluant vers les chauves-souris. Trois lignées constituant un bel exemple de ce qu’on appelle une convergence évolutive, à laquelle on peut adjoindre deux cas de "parallélisme". D’une part, une lignée proche des écureuils, mais légèrement différente, celle des anomalures, a développé indépendamment le vol plané à l’aide d’un patagium. D’autre part, tout comme pour les écureuils, les phalangers peuvent être soit volants, soit non volants (le plus célèbre de ces derniers s’appelle couscous, comme le fameux plat nord-africain). Parmi les premiers, au moins deux groupes, classés dans des familles différentes quoiqu’apparentées, ont acquis chacun de son côté la faculté de voler : les pétaures, plus connus sous leur nom anglo-saxon de "sugar gliders" (= "planeurs du sucre") et dont, soit dit en passant, le succès en tant que NAC (nouveaux animaux de compagnie) est explosif, et les "grands-phalangers" du genre Petauroides (= Schoinobates), de la taille d’un chat, qui présentent la particularité d’être les seuls mammifères planeurs dont le patagium ne va pas du poignet à la cheville, mais du coude au genou. Ce qui donne à l’animal en vol une silhouette trapézoïdale tout à fait caractéristique, le membre antérieur étant replié au niveau du coude .
Aucun de ces animaux planeurs n’est réellement capables de vol battu, mais les plus habiles (pétauristes, colugos) sont réputés capables d’utiliser des courants ascendants pour couvrir des distances de plusieurs centaines de mètres, et sont même capables de changer de direction. Il n’en est pas moins étonnant que de toutes ces tentatives de l’évolution mammalienne en direction du vrai vol, une seule est allée jusqu’au bout, celle des chauves-souris, et ceci en un laps de temps si court que les squelettes des premières chauves-souris (Icaronycteris) semblent surgir subitement dans les archives fossiles vieilles d’une cinquantaine de millions d’années, franchissant presque instantanément toute une série d’intermédiaires dont les paléontologues cherchent encore vainement les traces.
15 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










 Et bien évidemment , ça explique aussi pourquoi certaines d’entre elles existent encore de nos jour sous la même forme qu’il y a des millions d’années (singes, poissons,requins, crocodiles,etc...) les autres espèces ayant tout simplement disparu...
Et bien évidemment , ça explique aussi pourquoi certaines d’entre elles existent encore de nos jour sous la même forme qu’il y a des millions d’années (singes, poissons,requins, crocodiles,etc...) les autres espèces ayant tout simplement disparu...