Des bactéries modifiées par de l’ADN de mammouth. Nouveaux éléments sur l’impact des OGM ? Ou alors sur le règne procaryote ?
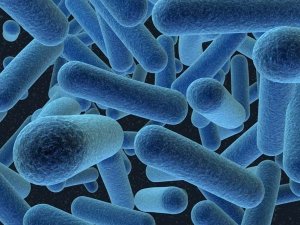
Une collaboration entre équipes de plusieurs nations a permis d’aboutir à une découverte importante concernant le fonctionnement des bactéries et leur évolution (S. Overballe-Petersen, PNAS, novembre 2013). Commençons par un état des lieux. Les organismes finissent par mourir. Leurs cellules se décomposent et les grosses molécules sont dégradées pour être digérées ou bien souvent libérées dans le milieu. C’est le cas de l’ADN mais comme la dégradation est rapide, avec la présence de nucléases, les morceaux d’ADN rejetés dans l’environnement ne sont pas de la dimension d’un gène. Leur taille ne dépassant pas en effet la centaine de paire de bases. Cet ADN paraît alors bien démuni, d’autant plus que des processus d’hydrolyse ou d’oxydation risquent d’altérer la séquence, transformant une cytosine en une thymine. On pourrait penser que ces fragments d’ADN compris entre 20 et 100 paires de bases finissent à la « poubelle ». Or, comme le mentionnent les auteurs de l’article paru dans PNAS, ces petits fragments de matériel génétique sont loin d’être éphémères et peuvent même, si les conditions s’y prêtent, subsister des milliers, voire des centaines de milliers d’années. Rien que dans les rivières du globe, la quantité de matériel génétique rejeté se chiffre en milliers de tonnes. Vu le poids moyen d’un fragment d’ADN faites le calcul et vous verrez le nombre de molécules « peuplant » les rivières.
Mais au fait, si ces molécules sont très répandues et de plus persistent, sont-elles perdues pour le règne vivant ? Pas tout à fait car comme n’importe quelle molécule organique, un fragment d’ADN peut être encore dégradé, ingéré, servant de nutriment aux micro-organismes. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans cette nature où rien ne se perd. De ce fait, ces fragments d’ADN rejetés se comportent comme de banales molécules servant de sources organiques pour recréer d’autres cellules. Ce qui n’a pas empêché les scientifiques de s’interroger sur une possible intégration de ces fragments mais cette fois, en tant que support de l’information génétique. Et de trouver qu’en réalité, le transfert est tout à fait possible. Les bactéries sont capables d’insérer des petits fragments dans leur génome, ce qui constitue (avec les virus) un mécanisme de transfert horizontal de matériel génétique. Et donc cet ADN circulant dans la nature contribue à la transformation des génomes bactériens.
Les études réalisées ont notamment découvert que des bactéries environnantes du genre Acinetobacter ont pu intégrer dans leur génome des morceaux d’ADN présents dans les os de mammouth et vieux de 43 000 années. Ces résultats enrichissent la théorie de l’évolution concernant les bactéries. L’intégration de fragments génétiques vieux de centaines de milliers d’années ressemble à un recyclage de l’information et constitue un mécanisme supplémentaire et inattendu de modification génétique pour les bactéries. Les auteurs de l’article osent un nouveau concept, celui d’évolution anachronique (en se basant sur cette insertion de morceaux d’information génétique séparés par des temps presque géologiques). Mais il n’est pas certain que la conception de l’évolution en soit bouleversée, pour autant qu’on puisse vraiment parler d’évolution bactérienne au sens où l’on l’entend pour les espèces animales.
Par contre, cette découverte pourrait avoir des implications imprévues sur l’impact des OGM ingérés par les animaux et les humains. Selon les données actuelles, il ne peut pas y avoir d’effet génétique lorsqu’on ingère des OGM, l’ADN étant dégradé par les enzymes du système digestif. Mais avec les éléments de cette découverte, il devient envisageable de concevoir une récupération du matériel génétiquement modifié, sous forme de fragments de 20 à 100 pb, par les bactéries de la flore intestinale sans lesquelles la digestion serait impossible. Ces bactéries qui possèdent des spécificités telles qu’elles permettant d’assigner une signature aux flores intestinales des animaux et des humains. De là à penser que les OGM en seraient plus toxiques, il y a un pas que je ne franchirai pas. L’intérêt de cette découverte se place plutôt dans le champ de la compréhension du sort de l’information génétique au sein du règne vivant. Les auteurs de l’article n’évoquent pas la question des OGM mais plutôt la question des résistances bactériennes aux antibiotiques, notamment dans les hôpitaux qui se focalisent sur le contrôle des organismes et qui compte tenu des éléments nouveaux, pourraient être amenés à déployer des dispositifs supplémentaires pour étudier ces problèmes de bactéries dans le milieu hospitalier.
Mis à part ces questions de santé publique, cette découverte suscite tout de même quelques interrogations que je vais exposer en usant d’un crescendo épistémologique. La première chose à laquelle on pense serait une sorte d’artefact, ce qui rendrait les résultats non interprétables. Deuxième stade, cette intégration de matériel génétique ancien serait une singularité du règne procaryote, autrement dit une curiosité phénoménale qui ne représente nullement la logique du monde bactérien. Troisième hypothèse, plus forte, celle de la « digestion d’informations » comme fonction essentielle du monde bactérien. Auquel cas on notera une contradiction seulement apparente avec l’existence du système de réparation SOS qui avec la protéine RecA corrige les lésions importantes de l’ADN. Une intégration de matériel génétique n’est pas alors considéré comme une lésion mais une insertion dont le rôle global reste à préciser. Finalement, on arrive à une vision de la bactérie comme organisme gérant la composition biochimique d’un milieu moyennant le cas échéant une gestion informationnelle conçue comme une sorte de dialectique entre le génome et les morceaux d’ADN circulant librement. Ce concept d’évolution anachronique laisse alors penser que les bactéries n’évoluent pas vraiment, du moins pas comme les espèces animales.
Lien vers l’article Avec un libre accès du texte complet en pdf
http://www.pnas.org/content/early/2013/11/12/1315278110.abstract
16 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









