La science se morfond dans les carrières de spécialistes, la recherche désintéressée n’a plus de place.
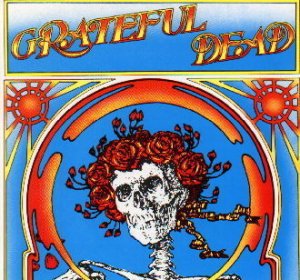
La recherche scientifique a sans doute perdu le sens de sa vocation originelle qui était de produire des savoirs fondamentaux sur les choses étudiées. Si ça se trouve, la recherche s’est pervertie progressivement en instaurant des règles et des pratiques étrangères à sa vocation première. Le grand public ignore comment fonctionne la science. Quant aux chercheurs, ils ne savent pas forcément dans quel système perverti ils évoluent, étant éduqués, formatés depuis les études universitaires pour baigner dans un environnement aux pratiques déviés et viciés dont ils ignorent les limites et les tares. Ils obéissent à ce qu’on leur demande, sans aucun recul critique. Ce sont de simples travailleurs, d’ordinaires exécutants obéissant aux hiérarchies, accomplissant des tâches techniques pour recevoir un salaire et si possible, avancer dans leur carrière. Bref, quoi de plus culturel en somme. L’homme est devenu un fonctionnaire sur terre, un opérateur, un joueur qui cherche à obtenir un revenu. Le métier de chercheur est un travail comme un autre, enfin, disons qu’il est devenu une profession rémunérée ordinaire après avoir été une activité conçue comme l’artisanat, motivée par des intentions humanistes, pratiquée comme un art de l’esprit et la matière, alliant l’invention expérimentale et l’idée théorique.
La science s’est spécialisée depuis la fin du 19ème siècle. Heidegger s’était intéressé à l’apparition des sciences particulières, lesquelles ne seraient pas la conséquence mais la raison du progrès de toute recherche. Et donc, ce n’est parce que le chercheur avance dans ses connaissances qu’il se spécialise. Bien au contraire, c’est en se spécialisant, en travaillant sur des objets de plus en plus circonscrits, avec des techniques de plus en plus fines et particulières, qu’il progresse en ajoutant des éléments de savoir au champ spécialisé qu’il explore. La recherche n’est pas un processus organisé parce qu’elle se développe dans différents instituts. C’est l’inverse, la recherche comme processus indéfini qui avance à grand pas dans l’exploitation de la « nature connaissable » et qui pour aller plus vite et plus loin dans les détail, se scinde en disciplines spécialisées menées dans des laboratoire dédiés, avec leurs publications attenantes et leur congrès réguliers. Un véhicule de course qui veut aller plus vite doit bénéficier d’avancées techniques dans la transmission, la direction, le freinage, la motorisation, la suspension. Une recherche qui veut aller plus loin dans la complexité doit progresser dans des instituts spécialisés. Elle utilise les progrès technologiques utilisables dans le domaine où elle avance. Mais contrairement au véhicule qui nécessite le montage de ses éléments, la science spécialisée se suffit à elle-même si bien que les chercheurs peuvent faire progresser leur discipline en ignorant pratiquement tout ce qui se fait dans des spécialités connexes.
Le processus de spécialisation est arrivé à un point tel que les gestionnaires de la recherche ont fini par constater les impasses disciplinaires, tout en concevant des options différentes. Ainsi ont été lancées les recherches inter ou transdisciplinaires censées palier à l’autisme de chaque spécialité et des pratiques qui finissent par passer à côté de découvertes importantes subordonnées à la coopération de scientifiques issus de plusieurs disciplines. Des mesures ont été prises dans les années 1980 mais elles se sont heurtées très tôt à cette question fondamentale qui anime les autorités de la recherche. Si les recherches sont transdisciplinaires, comment évaluer le travail des chercheurs alors que les revues les plus prestigieuses sont organisées autours de pôles de spécialité et que les travaux combinant plusieurs disciplines, voire systémiques, peinent à trouver une destination dans les meilleures revues et n’ont pas de lieu de publication qui leur est dédié ? Ces interrogations furent posées par les instances dirigeantes du CNRS alors que les sciences cognitives, spécialité transdisciplinaire par excellence, figuraient dans la cible des disciplines à développer, ne serait-ce que pour suivre les avancées produites aux Etats-Unis.
La recherche ne se résume pas à l’activité de chercher. Elle suppose qu’on réfléchisse, pense, et détermine le chemin que doit parcourir le savant en quête de connaissance. Le chercheur doit chercher ce qu’il veut savoir de la chose. Il doit aussi se demander dans quelle recherche transdisciplinaire il peut apporter sa contribution. Justement, ce qui semble un détail anodin vient d’être souligné dans un article de Science où sont évoqués des travaux mettant en commun un même système de traitement de l’information conçu pour analyser les images de galaxies et qui s’est révélé utile dans un autre domaine, celui de la cancérologie et l’imagerie médicale. Nicolas Walton qui a mis au point le logiciel pour les études astronomique a collaboré avec les cancérologues mais il souligne que son agenda étant extrêmement chargé, il peine à trouver assez de temps pour s’investir dans les collaborations interdisciplinaires. Il faut rappeler en effet que le chercheur passe une bonne partie de son temps à remplir des formulaires pour obtenir des crédits lui permettant de faire fonctionner son laboratoire et de l’équiper avec les appareils les plus récents, car la technologie est déterminante dans la production des données, lesquelles constituent la matière pour publier et engranger ainsi une notoriété qui permettra de justifier de nouveaux crédits. Et aussi de motiver l’avancement des chercheurs. Ainsi, on a assisté à une inversion de finalité au cours des dernières décennies. La quête scientifique n’est plus la finalité première. L’ensemble que constitue la « chose naturelle scientifique » est devenue un moyen pour être analysée par le dispositif technologique que l’équipe de scientifique utilise pour avancer dans la croissance du laboratoire et des revenus. La recherche scientifique a perdu de vue son objectif initial. Elle est devenue un processus de transformation et de croissance des laboratoires et instituts. Le chercheur tend à se recentrer sur un domaine de plus en plus réduit du savoir. Il devient peu à peu inculte et d’ailleurs, le système éducatif encourage la formation de jeunes chercheurs incultes, très doués pour manipuler les instruments, comprendre la mécanique de croissance des publications et du laboratoire, mais complètement ignorant de ce qui se fait en dehors de son champ, privé de surcroît des savoirs de l’honnête homme qu’on appelait les humanités il y a un demi-siècle. En caricaturant, on dira que le futur scientifique doit se préparer à amputer son esprit et à atrophier sa pensée. On comprend que dans un tel contexte évolutif, le président Sarkozy avait l’intention de transformer les grands organismes de recherche, CNRS en tête, en agence de moyens pour se mettre au service de projets qu’on peut penser pilotés pour servir non plus les savoirs fondamentaux mais les impératifs pragmatiques, liés notamment à l’innovation technologique, pour renforcer la compétitivité à l’époque des nouveaux pays industrialisés.
La recherche semble se concevoir comme une utilisation de moyens, accordant une place plus importante aux travaux qui, à défaut d’être authentiquement pluridisciplinaires dans la l’esprit, sont pluritechnologiques, c’est-à-dire organisés comme une combinaison d’activité émanant de plusieurs laboratoires. Par exemple, un institut de biologie fournira des souches cellulaires particulières, un laboratoire de génétique exécutera une cartographie des gènes et un centre de calcul pourra le cas échéant apporter ses compétences en traitement des données. On peut imaginer le processus sans fin de la recherche de nouveaux résultats dans les sciences du vivant. Tous les indices, tous les critères sont valides, pour peu qu’ils apportent des résultats chiffrés inédits. Par exemple des corrélations. La médecine industrielle en arrive même à traiter non plus des malades mais des statistiques. Une réduction de 50% d’un risque de pathologie pourra faire l’objet d’un traitement préventif. Signe des obsessions contemporaines. Maîtriser l’avenir, tendre au risque zéro, prévention du terrorisme, du réchauffement climatique, des insurrections, des pathologies, surtout celles générées dans des sociétés à haute solvabilité, là où les systèmes de santé et les patients peuvent payer. La recherche biologique produit de moins en moins de connaissances sur la nature mais de plus en plus de données techniques pouvant être utilisées à des fins de maîtrise de l’intégrité physiologique. Le chercheur navigue dans un champ de données réduit, connaissant ce qu’il faut faire et les règles permettant de décréter qu’un résultat est inédit et donc, susceptible d’être publié, ce qui suppose qu’on sache parfaitement ce que les laboratoires concurrents ont livrés dans les journaux spécialisés et les congrès dont l’objectif est autant de favoriser les échanges entre chercheurs que de servir de tribune pour placer des résultats le premier et se réclamer de l’antériorité d’une découverte. Le jeu des publications s’est substitué à la quête des savoirs. Et comme ces publications sont les seuls critères permettant de financer le laboratoire, recruter des chercheurs, acheter des appareils, offrir des promotions aux patrons, eh bien la recherche est devenue une course à la publication, certains n’hésitant pas à scinder les résultats en deux ou trois pour augmenter le nombre de publications.
Après avoir lu ces constats, le lecteur pourra penser à une science dévoyée. En fait, la science est devenue une organisation technicienne et surtout un immense dispositif de moyens dont les finalités sont triples. Offrir des salaires et des carrières à des chercheurs. Offrir des instruments de pouvoir aux dirigeants publics et des Etats au sein duquel ils oeuvrent pour sa puissance et aussi pour leurs carrières. Enfin, et ce n’est pas un secret, la recherche sert les intérêts privés quand elle est un instrument permettant de créer des produits innovants écoulés sur le marché par les industriels. Dire alors que la science est dévoyée, c’est émettre un jugement de valeur tout en assignant à la science une tâche noble, celle de produire des « savoirs de la nature » pour la « culture des sociétés ». Produire des disques durs ou des médicaments est tout aussi utile que connaître les ressorts de l’évolution. Par contre, il est assez clair que les règles de fonctionnement de la recherche « intéressée » et d’une recherche plus fondamentale (désintéressée) doivent être établies distinctement. Le temps accéléré des publications est incompatible avec la durée d’une recherche parsemée d’aléas et nécessitant un travail de réflexion soutenu. Darwin a mis 20 ans pour publier une version aboutie de son livre sur l’évolution. De plus, la recherche désintéressé ne peut entrer dans la grille d’évaluation conventionnelle, étant donné qu’elle ne produira pas forcément des travaux cadrés pour entrer dans le schéma rigide des revues scientifiques prestigieuses ou de bon niveau. La recherche désintéressée s’appuie sur la science mais elle produit un ensemble de savoirs qu’on peut espérer inédit. En ce sens, elle s’inscrit dans un autre univers, nécessitant des institutions spécifiques et des financements publics accordés sur la base d’une relation de confiance entre les autorités de tutelle et les chercheurs s’impliquant dans des aventures scientifiques inédites dont on ne peut piloter les résultats, ni les évaluations, ni n’assigner aucun objectif excepté celui d’avancer dans les méandres de la connaissance.
On l’aura compris, à l’ère de l’hyper intéressement, la recherche désintéressée n’a aucune place ni aucune chance. L’homme est un prédateur. Les mécènes et les honnêtes hommes ont disparu.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










