Les mystères de l’ARN ne sont pas prêts d’être dévoilés. Que peut faire la philosophie ?
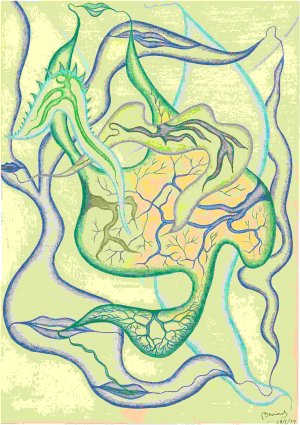
(a) Les ARN non codants sont-ils silencieux ou fonctionnels ?
La génétique moléculaire a accumulé des résultats colossaux qu’elle ne peut traiter et qui parfois sont interprétés dans des sens opposés. Cette situation n’est pas destinée à perdurer car la science progresse de certitudes (dérivé de certus, décision) en certitudes et quand deux interprétations d’une même chose sont contradictoires, il est logique de penser que l’une est exacte et pas l’autre. Le monde des ARN non codants est au centre d’une controverse qu’il faut expliciter en exposant les avancées scientifiques depuis les années 1970.
Depuis la fin des années 1950, la question des ARN non codants était considérée comme classée, avec la découverte des ARN ribosomaux et des ARN de transfert comme acides ribonucléique non codants pourvus d’une fonction biologique précise. Pendant quelques décennies, les biologistes ont pensé que la plupart de l’ADN était silencieux, autrement dit, non codant car ne contenant aucune séquence susceptible d’être transcrite puis traduite en protéine. Depuis, les technologies utilisant le séquençage et l’informatique (projet Encode) ont établi qu’au contraire, une « fonction biochimique » peut être assignée à 80% de l’ADN. On suppose aussi l’existence d’une fonction pour la plupart des ARN non codants, bien que cette fonction ne soit pas précisée. Cette idée résultant du programme de recherche ENCODE est controversée car des scientifiques pensent qu’en raison du faible niveau détecté, il n’est pas légitime d’attribuer une fonction à la plupart de ces ARN. La situation est confuse. La distinction entre un ARN non codant fonctionnel et un ARN silencieux (junk) apparaît comme incertaine, voire vague, comme le disent les auteurs d’une étude théorique sur cette éminente question (A. Palazzo ; E.S. Lee, Non-coding RNA, Frontiers in genetics, 6, 2015).
La question des « fonctions » génétiques ainsi qu’épigénétiques est centrale en biologie. La conjecture des ARN silencieux se pose aussi pour l’ADN avec la découverte des éléments génétiques transposables (TEs) constituant une bonne partie du génome des vertébrés dont la présence s’expliquerait comme un avantage adaptatif, ce qui suppose que ces éléments ont une fonction dans la cellule. Cette hypothèse ne fait pas consensus ; quelques groupes de scientifiques ont une position plus contrastée, articulée avec l’interrogation contemporaine sur l’évolution moléculaire. Rappelons que la question fondamentale concerne le rôle d’un élément génétique dont on a établi la présence dans la cellule. (i) La réponse peut alors être directe lorsqu’un mécanisme a été identifié. C’est le cas de tous les ARN messagers dont on connaît les traductions dans le protéome mais aussi de quelques classes d’ARN non codants qui peuvent se lier à des protéines nucléaires ou alors à l’ADN. (ii) Une réponse indirecte est accessible en comparant la présence de ces éléments dans des espèces ayant des signatures évolutives différentes. Si un élément est conservé, on suppose alors qu’il a permis un avantage adaptatif et donc qu’il exerce une fonction précise. (iii) Il existe enfin une troisième possibilité, celle de la quantification de l’élément d’ARN en question. Si la présence de cet élément est tangible, alors une fonction sera soupçonnée mais pas dans le cas où cet élément n’existe qu’en très faible quantité, voire en un seul exemplaire, comme le signalent les auteurs de cette revue mentionnant les ARN non codants de grande taille (lncRNA) dont on connaît entre 5000 et 50000 types dans les cellules humaines mais dont seulement un millier sont exprimés en plusieurs copies.
Le monde des ARN offre l’image d’une boîte transparente avec les mécanismes établis, puis une boîte grise avec les ARN non codants jouant un rôle établi ou supposé et pour finir la boîte noire des ARN non codants considérés comme silencieux parmi lesquels on trouve nombre d’ARN de longue taille ainsi que la plupart des éléments épigénétique répertoriés en types. La liste est assez longue, par exemple, hnRNA, circular RNA, snRNA, snoRNA, miRNA, 7SL, Xist ainsi que les lncRNA, chaque ensemble ne représentant qu’une infime fraction du total des ARN dont l’essentiel (en masse) est due aux ARN ribosomaux, de transfert et messagers, autrement dit, la machinerie cellulaire qui traduit le génome en protéome (Palazzo). Autant dire que le monde des ARN reste assez vague. La classification des ARN permet de s’y retrouver mais ne doit pas être prise comme un levier pour établir des règles biochimiques. Par exemple la longueur d’un élément épigénétique n’est pas associée à une fonction ou une interaction spécifique. Pas plus que la longueur d’un mot ne signale si c’est un sujet, un verbe ou un adverbe.
(b) L’épissage improductif
L’analyse des génomes de différentes espèces laisse apparaître des séquences considérées comme ultraconservées. Souvent, ces éléments d’ADN codent pour des ARN jouant des rôles régulateurs bien précis. C’est le cas des protéines riches en arginine et sérine qui se lient à l’ARN pour réaliser le mécanisme d’épissage qui est déterminant dans la mesure où il permet de générer à partir d’un ARN des copies alternatives en très grand nombre. Ces protéines interviennent également dans la circulation des ARN messagers ainsi que la traduction. D’autres séquences ultraconservées ont été trouvées et contrairement à toute attente, elles ne codent pas pour des protéines. Elles sont à l’origine d’un processus de dégradation des ARN messagers désigné comme épissage improductif (L. Lareau, S. Brenner, Regulation of splicing factors… Mol. Biol. Evol, 32, 1072, 2015).
La nature réserve ainsi d’étranges surprises. L’épissage improductif est un processus par lequel une protéine se fixe sur le pré-ARN qui permet sa production afin de le rendre inactif. C’est comme si un fichier que l’on ouvre dans un ordinateur allait se placer sur la mémoire vive pour en effacer ou perturber le contenu. Ce mécanisme d’épissage peut s’interpréter comme du gaspillage d’information. Pourtant, ce mécanisme est fortement conservé dans l’évolution. D’après les études génétiques, ce mécanisme aurait été présent chez les animaux il y a des centaines de milliers d’années, dès la divergence avec le règne des champignons qui ont gardé eux aussi les gènes codant pour l’épissage improductif. Si ce mécanisme a été conservé, c’est qu’il n’a rien d’un gaspillage mais au contraire, joue un rôle précis dans la machinerie épigénétique.
(c) L’ARN non codant reste une boîte noire
Le dernier congrès du Pacifique tenu en 2016 et consacré au computing en biologie confirme la situation indécise dans le domaine des ARN non codants dont l’expression dans les cellules humaines est comparable à celle des ARN messagers (précision, il s’agit de l’expression en nombre de séquences et non en poids moléculaire). Un article consacré à ce symposium fait état d’avancées dans l’étude des interactions entre ARN et protéines tout en signalant le déficit d’interprétation sur le rôle précis de ces interactions censées réguler la machinerie qui permet de passer du génome au protéome. Quelques conclusions sont néanmoins acquises sur de supposées fonctions de ces ARN dans les régulations pré et post transcriptionnelles de l’expression des gènes de l’ADN dans les cellules eucaryotes mais aussi les bactéries et les virus. Ces ARN non codants interviennent dans le développement des organismes et sont également les témoins de diverses pathologies. Je crois qu’on peut les considérer comme un génome dérivé dont le fonctionnement n’est pas élucidé malgré les résultats fournis par les analyses. Les scientifiques pensent tirer quelques enseignements en utilisant les méthodes informatiques mais je reste perplexe et pessimiste sur les déductions. Les biologistes tentent de capter le langage des ARN en le capturant dans la grille des logiciels à la manière des phénomènes sensibles capturés par les concepts de l’entendement dixit Kant. Cela dit, la quête scientifique ne doit se priver d’aucune méthode et les acteurs de ce symposium paraissent plus optimistes que Palazzo pour qui un élément non codant doit être considéré comme silencieux tant qu’aucun indice ne permet de lui assigner un rôle dans la machinerie épigénétique.
Ces ARN non codants sont énigmatiques. Ils interagissent avec des protéines, de l’ADN et même d’autres fragments d’ARN. Les capturer dans l’expérience n’est pas aisé et les généticiens déploient une batteries d’outils et de protocoles avec le risque d’être submergés par les résultats, y compris lorsque les logiciels informatiques tournent à plein régime pour tracer des signatures épigénétiques aussi ésotériques que la pierre de Rosette avant le déchiffrage de Champollion. Les méthodes les plus perfectionnées utilisent des outils récursifs basés sur le principe des machines qui apprennent à traiter les informations. A l’instar des outils utilisés en conception assistée dans l’architecture.
(d) La philosophie entre en scène
Sur ces questions, la philosophie scientifique que je développe a des choses à dire. Pour commencer, une incise de Aristote sur la nature qui ne fait rien en vain. Ces ARN non codants ne doivent pas être considérés a priori comme silencieux ainsi que le suggère Palazzo qui se refuse à emprunter le sillage de cette emblématique figure de Pangloss inventée par Voltaire pour moquer Leibniz. Je n’hésiterai pas à jouer les Pangloss en supposant que tous ces ARN non codants ne sont pas des résidus génétiques et ont un rôle précis même si on ne le connaît pas. Un rôle qui s’exerce dans l’ontogenèse des organismes, autant que dans la plasticité épigénétique de ces organismes matures et enfin dans les processus évolutifs.
La philosophie permet de jeter un regard sur les méthodes scientifiques. Elle pointe un problème fondamental occulté dans les sciences génétiques et biochimiques. Les concepts et notions utilisés sont élaborés à partir de l’expérience macroscopique et ne sont pas transposables sans précaution dans le champ des mécanismes moléculaires du vivant qui relèvent du domaine mésoscopiques. Ainsi, parler de fonction pour les ARN non codants n’a pas de légitimité, pas plus que d’évoquer un éventuel gaspillage d’information dans l’épissage improductif. Ces notions primitives n’ont pas forcément cours dans le domaine moléculaire ou du moins faut-il les employer dans un contexte sémantique retravaillé. La situation ressemble à ce qu’ont vécu les physiciens lorsque la mécanique quantique fut élaborée avec des notions complètement étrangères à celles utilisées par la physique classique, ces notions étant définies comme primitives, avec une signification ayant cours dans notre monde macroscopique.
Un second obstacle s’oppose à l’intelligibilité des ARN non codants détectés par les analyses génétiques. Cet obstacle est vieux de deux siècles au moins. C’est la science mécaniste. Les ARN codants entrent dans la grille de capture mécanistique. Alors que les ARN non codants en sortent pour la plupart et devraient peut-être définis comme ARN non fonctionnels. La science mécaniste fonctionne avec un principe devenu universel, le réductionnisme. Doctrine qui suppose qu’on peut comprendre un système en étudiant les parties. Ce qui revient à remonter le système en assemblant les parties en supposant que chaque composant est doté d’une propriété ou plus, voire d’une fonction. En croyant qu’un système se compose d’une addition de fonctions et de propriétés. Bien évidemment, la plupart des scientifiques contemporains n’adhèrent plus à ce réductionnisme strict pour voir les choses mais ils continuent à l’utiliser pour analyser les choses.
La science utilise des méthodes et dit ce qu’il faut faire ou plus généralement, elle dit ce qu’il est possible de faire. La philosophie trace des chemins et s’il y a lieu, elle dit ce qu’il faut voir ou du moins, elle incite à regarder les choses d’un autre point de vue et signale ainsi ce qu’il est possible de voir ; à chacun alors de décider du regard. En philosophie, regarder, c’est choisir. L’étrange monde des ARN a encore bien des choses à nous dévoiler. Il faut juste éviter le piège du réductionnisme et ne pas chercher à attribuer à chaque ARN une fonction mais considérer chaque fragment épigénétique comme un élément de langage ou un signal dans un champ permettant à la cellule de réaliser des opérations cognitives à l’échelle mésoscopique.
Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Ce billet est expérimental et s’insère dans une recherche de chemin. Philosophie de la technique ou de la biologie ou encore théologie du temps. La biologie ouvre vers des applications thérapeutiques, la technique vers la politique et la théologie vers la pensée et le sens de l’existence.
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










