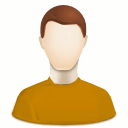
Le Zélateur
Un citoyen lambda, aujourd'hui retraité. Tout au long de ma carrière, un fervent défenseur du Développement durable, de manière concrète et pragmatique.Tableau de bord
- Premier article le 27/09/2017
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2 | 2 | 99 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
La lutte contre le « wokisme » : une peur fantasmée ou un prétexte racial ?
4976 visites 16 oct. 2021 | 90 réactions |
Démocratie, disiez-vous ?
1596 visites 27 sep. 2017 | 9 réactions |
Derniers commentaires
LES THEMES DE L'AUTEUR
Société Racisme Réseaux sociaux Féminisme Jean-Michel Blanquer Politique Démocratie Elections Abstention
Publicité
Publicité
Publicité









