Bob Dylan, un monde perdu pour le monde
Ou comment l’avant-garde de la tradition disparut sous le poids de l’ego et la pression sociale.
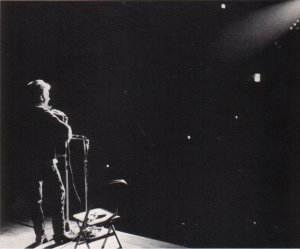
« Qu’est-ce que cette merde ? », interrogeait Greil Marcus dans sa critique renommée du « Self Portrait » de Bob Dylan paru en 1970. Une question, certes importante, mais qui a totalement fait oublier tout le reste du texte, où Marcus discute surtout de la vocation de Dylan, de sa place dans la musique américaine, et insiste sur le fait que si Dylan ne revient pas « sur le marché » après cet album jugé calamiteux, il restera figé à tout jamais au regard du public comme l’homme derrière « The Times They Are A’Changin’ » (dont les Beach Boys firent une reprise mémorable sur « Party ! » en 1965), « Highway 61 Revisited », « Blonde on Blonde » et les « Basement Tapes » qui circulaient alors sous le manteau. Et le drame, c’est que Dylan est revenu sur le marché en 1975 avec son album « Blood On The Tracks », tout aussi estimé que ses albums des années 60 mais pour d’autres raisons. Alors qu’Adam West avait arrêté d’incarner « Batman » depuis des années et joué un dur dans un film de Francis Lyon, Bob Dylan abandonnait de son côté le désintéressement et le plagiat de ses premières œuvres pour commémorer son récent divorce en toute originalité.
En 1962, Dylan pompait un vieux gospel pour créer « Blowin’ In The Wind », la première d’une longue série de chansons qui toucheraient l’âme de la planète et le porteraient presque au statut de prophète. Sur la même formule, il bâtirait « A Hard Rain’s A-Gonna Fall », « Masters Of War », « Chimes Of Freedom ». Trouvant une inspiration dans des antiquités regroupées dans la célèbre anthologie d’Harry Smith, il en moderniserait le discours, irait puiser dans le folklore irlandais, noir ou tout simplement américain pour chanter les droits civiques, le pacifisme et l’amour sans y penser deux fois. Il passa au blues électrique au entonnant « Maggie’s Farm », puis au rock n’roll garage avec « Like A Rolling Stone ». Il absorba du Rimbaud pour écrire « Mr Tambourine Man », de la Bible pour « All Along The Watchtower » (repris par Hendrix dont il imitera l’interprétation par la suite), composa « Sad Eyed Lady Of The Lowlands », un bouquet de métaphores inspirées des plus beaux poèmes impressionnistes pour sa femme. Il se lancerait dans la country music avec « Lay Lady Lay », il rendrait hommage aux Eskimos sur « The Mighty Quinn », aux Indiens sur « Wigwam », à Gilbert Bécaud sur « Let It Be Me ». Bob Dylan faisait feu de toutes parts grâce à une ouverture d’esprit hors du commun.
Et puis soudain, ce fut la débâcle. Le barde oublia de regarder autour de lui et se focalisa sur son nombril. Il se ferait mégalo avec la « Rolling Thunder Revue », il monterait un mauvais film de quatre heures, il écrirait et jouerait avec Eric Clapton. Il hurlerait « Idiot Wind » à la face de son ex, vendrait son idée de Dieu aux foules avec « Slow Train Coming » et mettrait des synthétiseurs horribles dans tous les coins sur « Empire Burlesque ». Une accumulation d’évènements décevants qui ne sont arrivés que parce que le gars a voulu jouer au jeune, abandonner sa famille et repartir sur la route. Et parce que la mode des années 70, avant la drogue et le disco, c’était d’abord le divorce.
Bob Dylan était génial quand il ne pensait pas au marché, quand il pensait à sa vie, quand il écrivait de belles choses inspirées de vieilles choses dont il ne sauvegardait que le meilleur. Bob Dylan restera figé comme le musicien qui abandonna le capharnaüm joyeux de « Self Portrait » pour toutes ces inepties, et ne reviendrait au folklore qu’au début des années 90 alors qu’il était sur le point de sortir de la conscience collective, trouvant sa seconde jeunesse dans une solitude faite de tournées sans fin autour du monde. Il irait jusqu’à publier un album de reprises de chansons de Noël pour faire croire qu’il était revenu à la raison, alors que là-dessus comme sur tout ce qu’il fait depuis vingt ans, il imite le cri du corbeau à la perfection. En un seul élan, Bob Dylan est parvenu simultanément à briser la tradition et à parodier l’avant-garde.
Or, la tradition et l’avant-garde sont une seule et même chose. Dans « avant-garde », il y a deux mots encore plus conservateurs, pour ne pas écrire réactionnaires, que « tradition », « avant » et « garde ». La vénérable techno et l’institution du rap, domaines que Bob Dylan n’a pas explorés, existent parce que la nature fournit traditionnellement de la foudre et que par un bienheureux hasard qu’il n’a pas su ignorer, l’humain a été doté de la possibilité d’en faire de l’électricité. Et à force de s’y frotter, on se grille le cerveau, on se grille la mémoire, on finit comme un corbeau sur un arbre perché pendant que Batman part à la chasse au Pingouin.
Bob Dylan, pendant sa première période acoustique, est parvenu à rendre la tradition attrayante aux oreilles de fans de rock n’roll électrique. Pendant sa deuxième période électrique, il s’est saisi de ce qui était à l’époque une avant-garde et il l’a introduite dans le grand palais des traditions déjà existantes. Il s’apprêtait à devenir âgé en 1970 en réalisant ce double album de standards que Greil Marcus désigne cruellement sous le substantif de « merde ». Dylan s’est défendu en affirmant qu’il avait sorti ce disque par cynisme, pour se défaire de la casquette de « porte-parole d’une génération » qu’il ressentait comme une pression, alors même qu’elle avait tout d’une chance. Mais la loi du marché était plus forte que lui, elle était aussi plus forte que le public. Morale Spiderman, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » ; et Dylan, qui par son charisme et son syncrétisme pouvait porter de belles valeurs pour mener une alliance, pour asseoir une voie historiquement originale et sans rupture de continuité avec le passé, a tout laissé tomber. Il fallait célébrer le sang sur les pistes.
La société se débarrasse de son histoire comme elle jette ses téléphones portables bourrés de métaux précieux à la poubelle. Adam West n’a pas obtenu le rôle de Batman en 1989, Tim Burton a préféré le donner à Michael Keaton, un comique. Tout un pan de la vieille culture a disparu. Bob Dylan a abandonné sa mission trop tôt, et l’a reprise trop tard. La génération des années soixante n’a pas su vieillir. Elle a refusé les exemples. Elle a refusé de se montrer en exemple aux générations suivantes. Obsédée par les ruptures, par les déchirures, elle n’a laissé qu’un champ de ruines morales. Heureusement, elle est parvenue à stabiliser le prix du baril.
Deucalion et Pyrrha eurent besoin de faire rouler des pierres pour recréer l’humanité, Bob Dylan en attrapa une, en fit le sujet d’une de ses meilleures chansons, et connut le plus grand de ses succès grâce à elle. Sa « rolling stone » est un être perdu, un monde perdu dans un monde perdu, noyé sous un déluge permanent d’informations contradictoires et d’exploitations continues. Libre de rouler, sans direction, sans maison. Or, pierre qui roule n’amasse pas mousse. Pour stocker ses nombreux biens, il faut un toit au moins. Quand on a deux familles, c’est plus compliqué, à moins d’avoir plusieurs toits. Le poids du malheur est l’apanage de la richesse. Bob Dylan a fait le choix de la difficulté en retournant sur la route.
Bref, tout ça devient trop complexe, le rêve, le mythe, l’idée, la réalité, anticipation impossible de l’avenir, et Bob Dylan qui sert d’excuse. Rendez-moi mon Batman sixties, mon twist, et Mary Poppins. Et puis, non, ne me rendez rien, débarrassons-nous de tout ça. Créons notre propre nounou. Je la vois bien avec un sac sans fond.
17 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON












