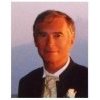Jeu surréaliste dans la tragédie
Identité d’horizon, couleur de ciel, de feu, de terre, de sueur et de sang. Profonds sanglots, magma infernal, étranges et bruyantes épopées, terreurs débordantes, cruelles épouvantes.
Mémoires paysannes de terre labourée, creusée, retournée, battue, éclaboussée de paroxysmes humains.
Souvenirs historiques tenaces, s’engloutissant inexorablement et douloureusement dans les entrailles du temps, comme l’étrave d’un navire gigantesque dans l’immense océan de l’oubli.
« Titanic » de gloire et de confusion pour que s’alimente la tragédie.
Terre gorgée de multitudes boueuses vivantes, fantomatiques et fantasmagoriques, rendue virginale aux espérances vaines.
Aux enfants insouciants et incertains, pour des lendemains souverains qui chantent encore et toujours effrontément.

A la terre de nos ancêtres, aux histoires paternelles, toujours pareilles et toujours différentes, aux accents épiques et lyriques, aux gestuelles appuyées dans l’espace du souvenir attendri, aux emportements mémorables, aux grands yeux exorbités qui magnifiaient le récit, à la voix émue et tremblante qui résonne encore dans ma tête.
En mémoire à l’écrivain surréaliste dont le rôle d’artiste, fut de ne pas vivre avec son temps mais à printemps et
à contretemps. A Joseph Delteil qui me montra le monde sous un angle plus joyeux et plus créatif.
Delteil répond à une exigence de révélation des personnages enluminés et déformés par l’histoire. Le lecteur est invité à repenser les clichés que la légende amplifie et que la tradition ne conteste pas.
Le narrateur sollicite de la part des lecteurs une faculté de remémoration en cultivant les zones d’ombre.
Son époque surréaliste se veut férocement et naïvement révolutionnaire. C’est l’avènement de S. Freud et de la psychanalyse, l’époque des consciences à géométries variables. Le rêve et la réalité se conjuguent et s’entrechoquent en un concert facétieux. Delteil invente non seulement des épisodes mais aussi des êtres chimériques et pourtant bien réels. C’est une vision caricaturale mais attendrissante du héros.
On apprécie ses audaces si l’ on connait les modèles de ce début de siècle et le climat passionné qui règne à cette époque.
A paris, c’est la révolution artistique, tout bouge, fermente, explose. La guerre de 14-18 avait rompu toutes les amarres, disloquées les vieilles structures, tracé une véritable coupure dans le temps.
Après le délire de finalité monstrueuse, soufflait réactivement un vent de douce folie et de frivolité sans égal.
La perception de l’évènement exige alors une appréciation de ce qui est plus que de l’anticonformisme et, simultanément, une acceptation du défi que l’écrivain semble s’être lancé et qui ne se limite pas au "sensationnalisme" qui lui est coutumier.
Voilà donc le lecteur dérangé," pris au piège", selon l’ expression de Delteil . Il est surtout mis en position inconfortable. Car, outre que l’auteur s’attaque à la figure héroïque, il s’attaque aussi à la littérature ; les deux démarches sont inséparables. En somme, le lecteur doit se soumettre au double inconfort. Classique et psychorigide, il subit de plein fouet une analyse sauvage.
Même André Breton, le tyran domestique du langage et de l’écriture automatique dut l’exclure de son mouvement. Joseph Delteil débordait du cadre de l’imaginaire collectif. Il fréquentait les anges, ce qui, pour les marxistes bretonnant était le comble de l’insulte et de l’infamie...il eut ainsi sa vision personnelle de la " dernière guerre"
"Les Tranchées. Là, règne un homme qu’on appelle le Paysan. Les Tranchées, c’est affaire de rumeurs de terre, c’est affaire de paysans. C’est l’installation de la guerre à la campagne, dans un décor de travaux et de saisons. Les Tranchées, c’est le retour à la terre.
En fait, il restait surtout des paysans dans les tranchées. A la mobilisation, tout le monde était parti gaiement. Se battre, le Français aime ça (pourvu qu’il y ait un brin de clairon à la cantonade). L’offensive, la Marne, la course à la mer, un coup de gueule dans un vent d’héroïsme : ça va, ça va ! Avec un sou d’enthousiasme, on peut acheter cent mille hommes. Mais après les grandes batailles, dès qu’on s’arrêta, lorsque vint l’hiver avec ses pieds gelés, et la crise des munitions aidant, l’occasion, la chair tendre, les malins se débinèrent. Chacun se découvrit un poil dans les bronches, un quart de myopie, et d’ailleurs une vocation chaude, une âme de tourneur. Les avocats plaidèrent beaucoup pour l’artillerie lourde. Les professions libérales mirent la main à la pâte. Ce fut un printemps d’usines.
Le paysan, lui, resta dans les Tranchées.
Il se tient là, dans son trou, tapi comme ces blaireaux, ces fouines qu’il connait bien. Creuser le sol, ça le connait, n’est-ce pas ! Il creuse, de Dunkerque à Belfort, des lignes profondes. De l’époque des semailles jusqu’au mois des moissons, il creuse. A l’heure où le raisin murit, à l’heure où le colza lève, il creuse. Il creuse, dans la longue terre maternelle, des abris comme des épouses, des lits comme des tombes. Chaque tranchée est un sillon, et chaque sape un silo. Ces boyaux, ils sentent la bonne cave. Mille souvenirs champêtres fleurissent dans les entonnoirs. La terre est une grande garenne. Les copains soufflent comme des vaches à l’étable. Le flingot a un manche de fourche. Et toutes ces armes industrielles, ces engins nouveaux comme des étoiles, ces crapouillots à quatre pattes, ces lance-mines et ces tas d’obus fauves, tout a un grand air animal, un air d’animaux à cornes. La lune est toujours la lune des prairies. Il y a un merle sur une gueule de canon. De la pluie, de la pluie qui fait germer les avoines. Et le vent des tuiles passe sur les hommes de chair."
extraits des Poilus (1926), , Grasset, réédition Cahiers rouges 1987
"La Deltheillerie", Grasset
13 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON