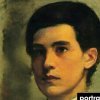La photographie comme remède à l’insensibilité générale ou de la nécessité de redécouvrir le monde qui nous entoure
En manque d’inspiration pour le traditionnel « Secret Santa » du Lycée [x] de Toulouse, j’ai pris le parti d’offrir, en version papier, quelques photos tirées de mon portfolio sur Shutterstock (plus grande banque d’images au monde), et de l’accompagner du texte qui suit. C'est sans doute anodin dit de la sorte, mais une image peut avoir toute une histoire (voire toute une Histoire). Telle est, globalement, la thèse que je développe modestement. Je dirais néanmoins, comme avertissement au lecteur, que le ton parfois grave ou magistral de ce papier n’a pas vocation à être lu trop sérieusement : il s’agit avant tout d’un texte que j’ai pris plaisir à écrire, dans le cadre d’une occasion somme toute festive. Ce texte est publié avec la permission de son destinataire initial. Joyeux Noël !

Toulouse, le 19 Décembre 2019
Au lecteur audacieux qui s’attaque à ces lignes,
et en la présente occasion,
à la lectrice audacieuse qui en entreprend la lecture,
Voici quelques-unes des images qui j’ai mises en ligne (et en vente) sur la banque d’images Shutterstock, sur laquelle je suis dit « contributeur » depuis l’été dernier. Que libre usage en soit fait, pourvu que le recyclage attende. J’espère qu’on ne verra pas dans ces quelques photos un simple échantillon publicitaire ou une pure démarche commerciale : il est vrai que pour ma part, j’apprécie toujours de pouvoir figer en images les lieux que je fréquente et l’environnement qui m’entoure, dans sa banalité quotidienne ou dans la fugacité d’un extraordinaire. Il est vrai aussi que la traduction concrète de cette traque de l’image produit la caricature du Japonais (ou Chinois, quelle importance) qui bombarde, avec fureur, ou flegme, la moindre futilité d’une rafale de clic-clacs – caricature et rapprochement sans doute facilités par la physionomie qui est la mienne. Non moins vrai est le constat que je fais d’une apparente indifférence ou désintérêt de beaucoup de mes compatriotes pour les richesses simples qui nous entourent. Et parce qu’un monde peut sembler séparer le Français supposément cartésien du photographe au déclencheur facile, il faut bien que je me défende : et voilà donc trouvé le prétexte de ma dissertation.
"... Recevoir en héritage ce qui nous rend sensibles à l'infinie beauté de la réalité la plus ordinaire… "
François-Xavier Bellamy, Les Déshérités
Une apologie du photographe ; une apologie d’un certain état d’esprit
Entendons-nous bien, c’est ma propre apologie que j’entreprends ici, et je ne prétends pas parler au nom de tous les photographes. D’ailleurs certains traits apparaîtront peut-être si grossis dans ce qui suit qu’ils pourraient difficilement s’appliquer à mon cas. Et s’ils paraissaient présomptueux à l’excès, il faudrait les dissocier de ma personne et ne considérer que la généralité du propos – propos d’ailleurs qui ne prétend ici à aucune vérité : il n’est que l’exposé d’une certaine vision des choses. Et d’abord, pour échapper au soupçon de l’imposture, il me faut préciser qu’en ce qui me concerne, parler d’un « amateur de photographie » est déjà excessif. Rien ne me vaut en effet le privilège d’être apparenté à la sphère des « photographes » : aucune formation en la matière, un appareillage d’une valeur dérisoire face aux équipements avec lesquels, pourtant, je me retrouve en concurrence sur le marché mondialisé de la vente d’images, aucun projet de professionnaliser ce faible pour la photographie (c'est-à-dire d'en faire un travail). En revanche, j'ai le loisir de prendre des photos, un plaisir simple et une certaine conscience que prendre une photo n’est peut-être pas si banal. Je suis d’ailleurs d’avis que les professionnels du secteur tendent probablement à perdre une partie de l'état d’esprit qui devrait animer tout amateur de photographie : c’est sans doute le drame de tout loisir qui devient source de subsistance.
Le photographe, un regard renouvelé sur le monde
Il est souvent reproché au photographe de ne pas profiter du moment présent, de ne pas regarder de ses propres yeux, bref, de ne pas vivre l’instant. Car, comment du verre inerte et une électronique inanimée pourraient-ils se substituer au vécu de l’instant, vécu tout à la fois physique et émotionnel ? Ce reproche a du vrai. Bien malin le photographe, qui, entendant le son majestueux d’un Beluga passant dans le ciel de Toulouse, se précipite avec frénésie sur sa sacoche, en extrait son appareil, l’actionne et enfin le pointe vers sa cible, pour seulement la voir disparaître derrière la silhouette des immeubles … tandis que le badaud, mieux avisé, qui aura simplement levé les yeux, pourra raconter à ses proches : « J’ai vu voler le nouveau Beluga d’Airbus. Très impressionnant. »

Ce reproche a du vrai, mais seulement lorsque la personne qui la formule a su trouver un intérêt au spectacle qui s’offrait à ses yeux. Car le monde qui nous entoure constitue un spectacle permanent, joyeux ou triste d'ailleurs. Force est de constater qu’en vérité, l’insensibilité générale gagne le commun des mortels. A tel point que le photographe serait en réalité enchanté de s’entendre dire : « Mais regarde donc avec tes yeux ! », car plus personne ne regarde plus rien. Combien de Toulousains, Toulousaines doublement enfermés dans leur écran et leurs écouteurs, en pleine rue, ont soudain levé la tête, l’air ingénu et vaguement hagard, au moment où je viens de dissiper toute l’énergie cinétique de mon vélo dans mes patins de freins pour éviter ces ovnis qui marchent en diagonale dans les passages étroits de la Ville Rose ou qui traversent sans regarder ! Vous êtes juste passé à deux doigts de faire un tour à l’hôpital, me dis-je à chaque fois, frappé du flegme imperturbable de l’extraterrestre. Mais la personne a déjà dépassé mon vélo, qui est à l’arrêt, le regard à nouveau vissé sur l’écran et les oreilles englouties par la musique. Et je repars péniblement, il faut fournir du couple aux pédales. Quotidien classique du cycliste à Toulouse.
Certes, l’exemple est caricatural. Le photographe a peu à voir avec ces histoires, jusqu’ici. Ce que je veux souligner, c’est ce triomphe si contemporain de l’insensibilité générale. Les Parisiens peuvent bien passer tous les jours devant la Tour Eiffel, ils n’en ressentent plus rien. Un Toulousain passe devant le Capitole comme il sortirait ses poubelles pour le ramassage des déchets. Mais c’est bien normal d’être blasé par ce qui est devenu notre environnement de tous les jours ! D’accord. Mais être insensible à tout, tout le temps, n’est-ce pas le moyen de vivre une vie plus triste ? Il a fallu que Notre-Dame brûle pour que les Français se souviennent combien cette cathédrale leur est chère. Les Américains, lorsqu'ils visitent la France, font le constat que tout est si ancien dans le Vieux-Continent, ce véritable musée à ciel ouvert. La moindre bâtisse est antérieure à la fondation de leur Etat.

Quand le passant ne fait que passer et repasser, le photographe, qui est un observateur de tous les instants et qui sollicite donc plus activement son regard que les autres, est lui sensible aux variations de lumière, ou à la tonalité des couleurs. C'est donc avec une passion presque égale que l'Albigeois que je suis, à chaque fois que je me retrouve au pied de la fameuse cathédrale Sainte-Cécile, renouvelle les prises de vue que je possède déjà en des dizaines d'exemplaires.

Ainsi le photographe, au moment où il déclenche, n’est pas qu’un fanatique du déclencheur. C’est bien vrai qu’il a quelque chose d’anachronique, ce personnage qui s’arrête pour figer un cliché. Mais s’il capture un moment de vie, c’est qu’il accomplit ce prodige paradoxal qui consiste à figer dans l’image un instant vivant (une tranche élémentaire de vie, un dt !). Personne ne conteste la puissance de l’image, tout ce qu’elle peut véhiculer de souvenirs, de sentiments ou de sensations. Le photographe, en parcourant ces tranches de vie qu’il aura capturé, cultive une mémoire vivante des passages qui lui ont été chers. S’il vient à présenter l’image à quelqu'un qui aura partagé l’instant avec lui, sans l’avoir figé par l’optique : « Tu te souviens ? – Bien sûr ! » Et tout à coup cette personne se retrouve replongée dans un passé redevenu si présent, submergée des rappels de ces moments qu’elle avait totalement oubliés la minute d'avant.
Le photographe, un témoin éveillé de son époque
A regarder les photos que je joins à ce texte, on pourra se demander ce qu’il en est du droit à l’image, vis-à-vis des personnes ou des lieux privés qui apparaissent. Je ne suis pas un expert du droit, et je répondrais simplement que ces contenus sont acceptées par la banque d’images, qui dispose de ses propres équipes juridiques, au titre du contenu éditorial : l’auteur perçoit toujours la rémunération liée à la vente de l’image en question, mais le client qui l’achète est interdit, lui, d’en faire un usage commercial.

J’accorde une importance particulière à cette notion de contenu éditorial, car elle fait pour moi la jonction avec le journaliste – mieux, avec l’historien. Par analogie, on peut penser aux disclaimers des YouTubers qui citent des dispositions légales liées au fair use des contenus mis en ligne, lorsqu’il peut y avoir ambiguïté sur la propriété des droits intellectuels. J’invoque par ma part la valeur informative des images, comme défense personnelle, pour justifier de la publication d’images de personnes, ou de biens privés. Toutefois en parlant de personnes, je ne pense pas vraiment au premier inconnu rencontré que j’aurais l’idée de fixer sur mon capteur, mais plutôt d’individus porteurs d’un certain symbolisme au moment de la prise de vue. De même des bâtiments, qui constituent les vestiges les plus évidents de l’Histoire.

Le photographe est un témoin de son époque, et parce ce qu’il en a conscience, il en est un témoin éveillé. Ici ce n’est plus seulement par plaisir personnel qu’il réalise des clichés : c’est parce qu’il sait que son image s’inscrit dans l’Histoire, témoigne de l’Histoire, fait l’Histoire. Cette Histoire qui a des millénaires ou des siècles, celle des cathédrales, des palais, des hôtels particuliers ; ou celle qui s’écrit sous nos yeux, celle des grands aménagements qui transforment la face de nos villes, celle de la France frappée par le terrorisme ou celle de la France secouée par la crise sociale.

Tout prend son sens, et l’éveil du photographe se renforce d’une conscience citoyenne, ou politique. Il est intéressant de noter que dans notre pays, l’exercice d’une activité de journalisme (notion vaste qui couvre la production de contenus pour la presse écrite ou numérique ou la réalisation d’interviews, en passant par la réalisation de vidéos ou d’images fixes) est libre, et n’est conditionnée à aucune qualification. Cette liberté est plus grande aujourd’hui encore, car tout un chacun est techniquement apte à la production d’images. Il faut naturellement accepter, en contrepartie, la production massive de contenus à très faible valeur informative (à moins de les considérer comme représentatifs, indirectement, de la superficialité de nos époques). Mais je n’ai pas l’intention de faire la critique de la technologie qui nous entoure, car mis à part les inconvénients qui leur sont inhérents, ils nous ouvrent, en particulier à nous qui nous destinons au noble métier d’ingénieur, un immense champ des possibles.
Et l’ingénieur (ou futur ingénieur) amateur de photographie ?
Il porte un regard émerveillé sur la technologie qui l’entoure : non pas d’ailleurs pour faire l’éloge aveugle de la technicité, mais pour mesurer l’étendue du génie humain dans ce qu’il peut avoir de foncièrement créateur, ou créatif, de beau et de bon.
Si je ne craignais de passer pour la caricature asiatique que j’évoquais en introduction, je prendrais volontiers des clichés dans les stations de métro toulousaines. Non seulement parce que certaines présentent un intérêt architectural ou esthétique certain, mais parce qu’elles constituent la partie accessible d’une merveille de technologie dont les Toulousains ont oublié la valeur. Il m'arrive, lorsque je prends notre VAL (Véhicule Automatique Léger), de penser à la prouesse technique des ingénieurs qui ont permis l’installation de ce qui constituait une innovation majeure au moment de la mise en service. (Aujourd’hui encore, seule une petite partie du réseau parisien, par exemple, est automatisée ; il est probable, du fait des conditions d’exploitation, que l’automatisation reste très localisée.) Un sentiment admiratif et reconnaissant à l'égard des équipes municipales qui ont eu la présence d’esprit de projeter ainsi Toulouse dans l’avenir me traverse alors (mais il exclut au passage l’équipe en place de 2008 à 2014 - parenthèse politique refermée).
Et lorsque je prends le train, et que je croise un TGV, c’est un peu de ma fierté nationale qui est flattée. Le record de vitesse sur chemin de fer conventionnel reste détenu par la France. Des déclinaisons de notre TGV équipent le monde entier, et même les lignes états-uniennes achètent des trains Alstom. Alstom, Latécoère, qui sont les victimes, parmi les nombreuses autres, de l’indifférence de nos compatriotes. Si le sort de nos fleurons industriels leur importait davantage, on assisterait moins souvent à leur dépeçage… Tout est lié.

L’avion constitue un autre sujet d’émerveillement pour l’amateur de photographie. On ne se lasse pas de photographier les paysages vus du ciel. Un cliché diffère toujours de l'autre, par le lieu, vu à des milliers de mètres d'altitude, la luminosité ou encore la disposition et l'épaisseur des nuages. Les vues aériennes contiennent en soi un message si fort que je le qualifierais de message civilisateur : 1- elles sont rendues possibles par ce miracle que constitue l’aviation ; 2- elles existent grâce à l’excellence du matériel photographique, et à la possibilité d’un traitement numérique pour améliorer encore l’image brute. Ces points-là supposent en arrière-plan un immense travail humain. 3- Enfin, notre Terre est belle, et c’est le message ultime que porte la photographie aérienne. Nombre d’astronautes, dont Philippe Perrin et Thomas Pesquet, tous deux intimement liés à la ville de Toulouse, ont été frappés par le point de vue exceptionnel qui leur a été offert depuis leur orbite. Mais n’oublions jamais que cette planète est celle de l’humain, et que si elle est déjà belle en soi, elle l’est d'autant plus qu’elle abrite l’humanité. Elle est la Terre des Hommes, et c'est ce qu'écrivit avec une infinie beauté l’aviateur Antoine de Saint-Exupéry (encore une personnalité liée à la Ville Rose).

« La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce ce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. Mais, pour l’atteindre, il lui faut un outil. (…) L’avion, l’outil des lignes aériennes, mêle l’homme à tous les vieux problèmes. »

« L’avion est une machine sans doute, mais quel instrument d’analyse ! Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre. (…) Nous voilà donc changés en physiciens, en biologistes, examinant ces civilisations qui ornent des fonds de vallées, et parfois, par miracle, s’épanouissent comme des parcs là où le climat les favorise. Nous voilà donc jugeant l’homme à l’échelle cosmique, l’observant à travers nos hublots, comme à travers des instruments d’étude. Nous voilà relisant notre histoire. »

« Mais le plus merveilleux était qu’il y eût là, debout sur le dos rond de la planète, entre ce linge aimanté et ces étoiles, une conscience d’homme dans laquelle cette pluie pût se réfléchir comme dans un miroir. Sur une assise de minéraux un songe est un miracle. »
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes
« … Indifférence solitaire à autrui, indifférence relativiste au vrai et au faux, au bien et au mal … »
« Il faut que tout ne soit pas identique pour que mon attention trouve de quoi s’étonner. Cette expérience n’est permise que par la culture, qui fait apparaître à nos yeux toutes les variations du réel. Découvrir que cette médiation de la culture est nécessaire, c’est comprendre ce paradoxe que l’on ignore trop souvent : la curiosité ne naît pas quand on ne sait rien. En fait, il faut beaucoup de connaissances pour s’étonner. L’expérience se répète dans chaque domaine de recherche : plus on apprend, plus on s’émerveille. L’ignorance ne s’étonne de rien, et la science admire chaque chose. L’habitude blasée ne vient pas d’un excès de connaissances ; et la passion de voir et de savoir ne naît pas de la neutralité d’un regard encore vierge de toute culture.
Découvrir une autre culture, une science, une littérature, c’est voir peu à peu le monde s’animer d’une infinité de significations encore insoupçonnées ; c’est lire dans le réel encore méconnu les singularités qui y dormaient en attendant d’être découvertes. C’est s’étonner soudain de ce qui jusque là paraissait banal, voir de l’unique dans l’ordinaire, sentir du relief, là où, pour les fausses certitudes de l’ignorance inconsciente d’elle-même, tout est uniforme et plat. Il faut un cours d’histoire, un exercice de physique, un tableau ou un poème pour contempler avec un regard neuf le monde autour de moi, pour considérer authentiquement ce que je vois, ce que je vis. (…) Apprendre, c’est recevoir en héritage ce qui nous rend sensibles à l’infinie beauté de la réalité la plus ordinaire ; c’est gagner, pour nos yeux ouverts, ce par quoi la singularité de chaque chose apparaît. »
François-Xavier Bellamy, Les Déshérités
Voilà pour mon apologie du photographe, cet être suspect au milieu de la foule des gens qui ne comprennent pas l’intérêt de s’attarder sur telle ou telle banalité, monument, plante, animal ou objet technique. Ce qui guette le photographe pourtant, c’est un émerveillement de tous les instants, un certain état d’esprit où la vie prend une teinte différente. Observateur de son époque, il prend conscience de l’Histoire qui s’écrit sous ses yeux. Les joies enfantines de la redécouverte permanente sont modérées par le poids d’une certaine conscience politique, susceptible de l’amener à des constats parfois amers.
L'appareil photo n’est donc qu’un boîtier noir, doté de quelques lentilles, mais c’est une arme et un instrument de civilisation au même titre que la plume, ou le pinceau.
Quant à cette insensibilité générale, tentaculaire, on peut l'attribuer à la paupérisation de la culture : non pas que la culture doive être élitiste, au contraire ; la culture démocratique, ou démocratisée, devrait cependant être autre chose que la culture bas de gamme, celle d’un certain prêt-à-consommer, ou prêt-à-penser. Elle est un bien précieux qui ne nécessite, pour être cultivée, pour trouver un développement autonome, qu'une initiation, une première introduction, un élan initial. Cet élan ne peut être inné, il doit être transmis par autrui. Il s’entretiendra ensuite de lui-même par curiosité intellectuelle ou simple ouverture d’esprit. Le mouvement a donc quelque chose d’une démarche socratique : la culture n’est peut-être pas tant de savoir : s’intéresser au savoir, c’est déjà s’être approprié la richesse de cette connaissance. Tel est, je crois, l’objet de la transmission, dont nous perdons aujourd'hui le sens et l'ambition. Nous ne croyons plus en l'Universel. Et à bien des égards, Noël, en dépit de ses déclinaisons mercantilistes, est porteur de cette part d'universalité qui fonde notre socle civilisationnel.
Joyeux Noël !

Toutes les images sont issues de mon portfolio, sauf la photo de l'Airbus A380 (pas encore en ligne).
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON