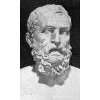Le péché, une transgression morale, sociale, dont nous serions responsables...
... aujourd’hui sans doute pour les juristes et les religieux encadrés par leurs textes mûris pendant des siècles, avec le pardon une mansuétude chrétienne néanmoins possible jusque dans nos tribunaux. Pour certains penseurs c'est moins sûr, avec leurs réflexions attachées à leur conception de Dieu, leurs connaissances et la raison.
L'affaire commence tôt avec la Bible hébraïque (Siracide) "C'est avec la femme qu'a commencé le péché, c'est à cause d'elle que tous nous mourrons"
/image%2F2064230%2F20230923%2Fob_242686_adam-et-eve-croque-la-pomme.jpg)
Les chrétiens compteront sept péchés capitaux et les musulmans jusqu'à soixante-dix (1).
D'où ces questionnements à propos de cette contravention.
L’Apôtre Jean plante le décor avec le péché inéluctable de son épître aux Hébreux ; « L’homme tant qu’il est dans la chair ne peut éviter les péchés tout du moins les péchés légers. » Alors, sommes-nous pleinement responsables de ce que nous pensons et de nos actes reprochables s'ils sont inéluctables ? Cette question traverse les siècles au gré de réflexions qui se croisent, flirtent ou divergent. Des réponses ont été apportées par ceux qui y ont réfléchi depuis l’aube des temps. De ce que nous accepterons de leurs postulats dépendra l’appréciation de nos fautes et donc de notre responsabilité.
L’unanimité reste à faire.
Pour remonter à la source possible de notre responsabilité, des porteurs de la foi ont contribué chacun en leur temps, aux variations de cette réflexion. Au cœur du sujet se pose la question du libre arbitre qui pour les uns conditionne notre responsabilité.
Dès le IVe s. Pélage (ascète breton) pose que « toute personne peut choisir de résister à la grâce de Dieu ou de lui céder. » Pour lui nous avons le choix de demander ou non l’aide de Dieu miséricordieux, ce qui induit un premier choix possible pour chacun. Considérant que sans la « grâce divine » l’homme ne peut être sauvé, il nous rassure aussi avec l'absolution possible du péché inéluctable, si nous la sollicitons.
Dans les pas de Pélage, pour Saint-Augustin à la même époque « on ne peut pas reprocher à Dieu ce que nous faisons de mal », ce serait en effet disculper l’homme de la responsabilité de ses fautes. A chacun d’assumer le choix de pécher, sinon les fautes ne nous seraient pas imputables. Tous les tribunaux jugent depuis toujours sur ce fondement.
Thomas d’Aquin va plus loin et introduit le doute qui doit être abordé avant de donner entièrement raison à Saint-Augustin quant au choix possible devant le péché ; la volonté dispose-t-elle de la liberté d’arbitrer ?
Au tournant du XVIe s. deux théologiens universitaires protestants s’affrontent sur ce sujet brûlant à l'université de Leyde - Hollande. Arminius « remontrant » fait suite aussi à Pélage et soutient la thèse du libre arbitre de l’homme, quand Franciscus Gomarus « contre-remontrant » défend la théorie de sa prédestination, elle s’imposera en 1618.
Spinoza devenu hollandais, ne peut avoir échappé à cette effervescente controverse qui a partagé les intellectuels quelques années plus tôt. Pour lui on ne peut pas dissocier le corps et l’esprit composants d’une « substance » unique d’un Être infini englobant tout, qu’il appelle aussi « Nature » et incluant l’homme ; Dieu ou la Nature. Il déconstruit l’idée du Dieu des croyants de son temps. Il invente une autre voie qui exclut la prédestination et pondère l’écrasante responsabilité de l’homme face à ses actes et donc à ses péchés, au motif que l’homme n’a pas conscience de ce qui est à l’origine de ses pensées parce qu’il ignore l’origine de ce qui le conduit à faire ses choix. Ainsi notre liberté de choisir serait une illusion en ce qu’elle est la conséquence d’événements enfouis dans notre inconscient qui commandent à notre conscience. Il répond ainsi à Thomas d’Aquin qui se demandait si la volonté choisit librement. Une doctrine qui ressemble au fonds de commerce de la psychanalyse et aux circonstances atténuantes de nos tribunaux.
Descartes et son inspiration chrétienne du libre arbitre pense que la volonté est indépendante de la matière. Pour qu’il y ait liberté, il faut que l’esprit puisse se déterminer indépendamment du corps. Son « je pense donc je suis » découle de ce qu’il considère avec raison, que les sens ne sont pas fiables et ne justifient pas à eux seuls la réalité. Il apporte un élément de compréhension avec son animal machine qui obéit à un instinct dont il n’a pas conscience ; quand l’homme a lui, conscience de son instinct.
Dotés de la vertu du doute cartésien et de la suspicion qui conduit au libertinage de la pensée, les sceptiques de l’Antiquité et du XVIIe s, repensent ce que l’on croit abrupto. Les libertins érudits refusent de se ranger derrière des vérités dogmatiques.
Dans cette forêt de présupposés, où se trouve le chemin qui conduit à nous rendre responsable ?
Spinoza dévoile un trait de nous-même qu’il désigne comme l’affirmation dynamique de notre être, la nature humaine avec ses désirs qui sont en nous. S’il n’en donne pas le siège, il les décrit ; la persévérance dans notre être pénétré de cet appétit devenu conscient, les désirs qui peuvent être modifiés par l’intervention de causes extérieures. Il souligne l’interpénétration intime du corps et de l’esprit qu’il voit liés.
Il explique là, la naissance du désir, mécanisme diffus submergeant. Si le péché naît ici, s’il se mélange davantage à l’instinct qu’à l’intellect, alors comment lui résister ? Et le faut-il ? Il touche du doigt cette dualité de la concupiscence avec ses attirances condamnables mais d’essence profondément humaine, naturelle. Spinoza place l’importance des affects avant l’argent et la notoriété. On voit la place de la sexualité qui rejoint pour lui la nécessité de développer le corps pour ce qu’il apporte au bien-être physique qui doit accompagner celui de l’intellect. Nous serions donc un tout.
Avant de poursuivre avec Spinoza, l’approche augustinienne du pêché complique la perception du mal (la faute) qui ne peut être réduite à une interprétation simpliste. Saint-Augustin voulait connaître le sentiment apporté par la faute avec « le vol des poires ». Il les a volées dans un verger sans nécessité, dans le seul but de jouir du larcin, pour le plaisir de faire ce qui était défendu et sans gourmandise pour ces fruits sans beauté qu’il savait sans saveur. Cet épisode le travaillera toute sa vie. Ce mal auquel il se réfère, relève d’une perversité instructive ; faire le mal pour le plaisir de le découvrir. Il ne dira pas si sa conscience l’aurait travaillé autant si le vol avait été guidé par la gourmandise (le désir de Spinoza) pour des fruits qu’il aurait devinés exquis et dont il aurait voulu goûter la saveur, même au prix du mal.
Il pose là les limites de notre interprétation face à l’éventail des possibilités du mal et du bien. Un seul mot ne suffit pas à tout embrasser. Peut-on appeler mal, ce qui repose sur la volonté de faire du bien ? Est-ce le même mal que celui qui repose sur la volonté de faire du mal ?
Saint-Augustin apporte des distinctions qui l’éloignent de la perception univoque du bien et du mal, malgré l’influence de ses années passées chez les manichéens. Il médite au bien qu’on voudrait faire et qu’on ne fait pas et au mal qu’on ne veut pas faire et qu’on fait. Il suppose que le bien et le mal ne peuvent se mélanger. Pourtant la réalité nous conduit parfois à donner le bien, partager le plaisir, en faisant mal. Si le bien, conduit par la franchise des sentiments est destiné à un être qui le recevant s’en réjouit, quel mal peut-il y avoir à cela ?
Un bonheur s’il est partagé, même en ce qu’il est conséquence du mal, mérite-t-il cette épithète ? Si le mal prive d’un bonheur qu’il remplace par un manque cruel, ce mal mérite-t-il qu’on l’écoute, si ce délice fruit du mal peut aussi rendre heureux ? Et s’il n’en rend pas d’autres malheureux est-ce toujours le même mal ?
Il ne s’épand pas sur la sincérité d’un bonheur trouvé dans l’intimité de sa conscience, et s’il est partagé. En l’absence de douleur pour autrui où est le mal ?
Revenons à Spinoza qui découvre les subtilités qui conditionnent la culpabilité.
Il distingue l’étape primordiale naturelle de l’instinct qui précède la conscience. Se pose alors la question de l’ordre des choses ; n’est-il pas préférable d’écouter son instinct innocent par nature, à toute réflexion conduite par une conscience culpabilisante ?
Si une rencontre soudaine réveille une attirance, n'est-ce pas là le constat de l’action instinctive d’un être et non le résultat d’une volonté, émanation de la conscience. Si la raison, produit de la conscience, dicte de ne pas suivre son instinct c’est faire obstacle à la nature. Or pour Spinoza, Dieu et la nature se confondant, ne pas suivre son instinct serait-ce faire obstacle à Dieu ?
Spinoza déculpabilise l’homme dont la conscience active cache l’essence de sa conscience derrière l’expérience, l’éducation, les convictions… de son temps. Le mal n’est pas constant selon les siècles qui façonnent la sociabilité des individus. Doués de la même conscience ils l’ont pourtant interprétée différemment.
Doit-on comprendre le mal à la lumière de doctrines ou des valeurs des sociétés humaines élevées dans des contextes si différents ? Voyait on le mal au moyen-âge, lorsque le plus éminent rabbin Maïmonide expliquait que " les rapports avec des petites filles de moins de 3 ans et des garçons de moins de 9 ans sont sans signifiance juridique... le viol d’une enfant de trois ans ne peut pas être retenu au motif que la nature reforme son hymen…" Ou lorsque « Mahomet qui s'est marié alors qu'Aïcha n'avait que 7 ans et a consommé son union quand elle eut 9 ans » ?
Régis Debray se pose aussi la question de la causalité ; « Dieu ne tient que de Lui-même, ce qu’il sait Il ne l’a pas appris… Nous nous produisons du neuf, oui, mais à partir de ce que nous avons reçu. » Pour lui aussi nous agissons en conscience, orientés par la multitude d’effets produits par l’environnement dans lequel nous avons vécu et dont nos certitudes seraient dépendantes.
Plus généralement Ovide nous dit, « je vois le bien et je le connais et pourtant c’est le mal que je fais » ? Il associe ici le bien à la connaissance qu’il en a, qu’elle part vient de sa volonté ?
Platon ne nous aurait pas simplifié la vie avec sa conception d'un "esprit indépendant du corps", car comment être sûr qu'en condamnant un corps on jugerait la conscience qui l'aurait guidé à faire le mal ?
...
Quelles qu'en soient les sources, ces débroussailleurs nous laissent face au péché, devenu faute devant les tribunaux. Plutôt qu'un avocat notre conscience sollicitée pourra trouver parfois nos circonstances atténuantes et prononcer le cas échéant à la place du juge, l'acquittement (cas du mal sans faire de tort) ou le pardon si le remord est sincère.
(1) Tous réclament l'obéissance à la morale, ce guide indispensable à une vie sociale. Robespierre qui avait senti cette nécessité placera les lois de la République "sous les auspices de l'Etre suprême", où elles sont toujours.
Illustration XIIIe s. Un chevalier prêt à combattre les sept péchés capitaux.
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON